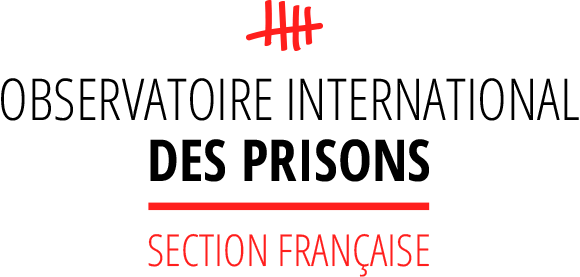La croisade contre les activités « ludiques ou provocantes » en détention, lancée par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, est un cas d’école de la dangereuse démagogie qui semble désormais tenir lieu de politique pénitentiaire : des mensonges amplifiés au lieu d’être démentis, une circulaire prise à des fins de communication, un engrenage administratif kafkaïen – et au bout du compte, des personnes détenues livrées à un système toujours plus punitif et vide de sens.
« Arrêter désormais totalement ces activités dont personne ne comprend qu’elles existent » : c’est avec cette annonce martiale, le 17 février, que Gérald Darmanin enfourche la polémique allumée par un syndicat de surveillant·es au sujet d’une activité de socio-esthétique à la prison de Toulouse-Seysses. Si le garde des Sceaux réagit au quart de tour, ce n’est donc pas pour rétablir les faits : à savoir qu’au lieu de la « séance de massage aux frais du contribuable pour la Saint-Valentin » décrite par la rumeur, des étudiantes n’ont fait que prodiguer bénévolement des conseils en soins du visage à une vingtaine de personnes détenues – sur les quelque 1300 que compte cette prison occupée à plus de 200 %. Non, ce dont le ministre se dit « choqué profondément », c’est bien que « cette activité gratuite, qui avait été proposée localement, [ait] été acceptée ».
La formulation est étudiée : Gérald Darmanin présente la chose comme une initiative isolée, malheureusement rendue possible par les « habitudes prises avant [son] arrivée place Vendôme » – tout sauf une pratique avalisée, voire promue, par les autorités. Peu importe si, quelques mois plus tôt, la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap) vantait encore les mérites de la socio- esthétique pour favoriser l’estime de soi et les démarches d’insertion des personnes détenues, et annonçait son intention de la développer le plus largement possible. En dénonçant tout ce qui ne relève pas du « soutien scolaire », de « la langue française », du travail et du sport, le garde des Sceaux s’en prend en réalité à de nombreuses activités déployées par son administration – comme par exemple la médiation animale, qui fait même l’objet d’un référentiel commandé par la Dap[1].
Ouvrir le parapluie
Le 19 février, Gérald Darmanin passe aux actes et adopte une instruction bannissant toute activité « ludique ou provocante ». Les directions interrégionales des services pénitentiaires (Disp), chargées de contrôler les activités en détention depuis l’affaire « Kohlantess » en 2022, sont priées de faire du zèle : elles « doivent assurer un rôle strict de supervision, de validation et de contrôle » pour « vérifier l’adéquation totale entre l’objectif de réinsertion et [chaque] activité proposée ». Mais comment interpréter des directives aussi floues, s’agissant d’activités qui peuvent très bien viser l’insertion des personnes détenues tout en comportant une dimension ludique, et dont il se trouvera toujours quelqu’un pour les trouver « provocantes » à l’égard des victimes ?
Dans le doute, l’administration préfère se protéger : dès les déclarations de Gérald Darmanin, suspensions et annulations d’activités se multiplient aux quatre coins de la France. Courant avril, un décompte non exhaustif en relève pas moins de 158 dans 74 établissements péni- tentiaires[2]. L’activité la plus fréquemment mise à l’index semble être le yoga, mentionné en bandeau sur BFM-TV pendant le discours du ministre, et suspendu ou annulé dans pas moins de 25 prisons – y compris par exemple au sein de l’« unité pour détenus violents » de Muret. Mais les ateliers les plus divers sont également sacrifiés : sophrologie, conférences scientifiques, musique, danse, cuisine, jeux de société, sports de combat, sorties culturelles… Le tout, dans la plus grande cacophonie : des intervenant·es voient leurs activités supprimées dans certaines prisons, mais maintenues dans d’autres. Dans plusieurs établissements, des stages autour de la gestion des émotions et de la communication non violente font également les frais de cet emballement. Les structures fléchées vers la réinsertion (structures d’accompagnement à la sortie, centres de semi-liberté…) ne sont pas plus épargnées que les autres[3].
Pour pouvoir reprendre, bon nombre d’activités sont tout simplement rebaptisées, afin qu’on ne puisse surtout pas les soupçonner d’apporter un minimum de plaisir ou de délassement. À la maison d’arrêt de Toul, la « gym douce » devra ainsi reprendre sous le nom de « sport pour per- sonnes âgées ». En milieu ouvert à Nanterre, le théâtre est rebaptisé « expression citoyenne ». Ailleurs, le mot « jeux » doit être retiré du nom d’un atelier « jeux de société ». Au centre de semi-liberté de Corbeil, la boxe est suspendue « tant que le contenu éducatif n’est pas objectivé »…
Une peine réduite à la souffrance et au vide
En attendant le résultat de ces exercices de style, les conséquences de la séquence sont d’ores et déjà très concrètes pour les prisonnier·ères : l’offre d’activités, déjà anémique, se réduit encore. En 2021, Emmaüs France et le Secours Catholique relevaient que les personnes détenues qui y avaient accès ne représentaient qu’une « très faible minorité : moins d’un quart d’entre elles participent à des activités socioculturelles et une sur cinq seulement a accès au sport[4]) ». Loin, si loin, des préconisations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), selon qui « l’objectif devrait être que chaque personne [détenue] puisse passer une partie raisonnable de la journée, soit huit heures ou plus, hors de sa cellule, occupée à des activités motivantes de nature variée : tra- vail, formateur de préférence ; études ; sport ; activités de loisir, adaptées aux besoins de chacun[5]. » Un horizon que l’instruction de Gérald Darmanin éloigne encore un peu plus, au profit d’une peine réduite à la souffrance et au vide.
Mi-mars, l’OIP et six autres organisations[6] ont déposé deux recours devant le Conseil d’État pour faire suspendre en urgence l’exécution de cette circulaire, puis la faire annuler.
Par Johann Bihr
[1] Ministère de la Justice, Médiation animale en prison : un référentiel pour un nouveau métier, 2020.
[2] Ces suspensions et annulations ont été recensées par Marine Guibert, tout comme bon nombre des détails qui suivent. Qu’elle en soit remerciée.
[3] Tract de la CGT Insertion- Probation, Quand la réinsertion devient un jeu : le ministre nous fait tous perdre la partie !, 18 février 2025.
[4] Emmaüs France, Secours Catholique-Caritas France, Au dernier barreau de l’échelle sociale : la prison, 2021.
[5] Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 4 au 18 déc. 2019, 2021, §59
[6] La CGT Inser- tion-Probation, le SNEPAP-FSU, le Syndicat de la magistrature, le CRI, la Ligue des droits de l’homme et l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus (A3D).