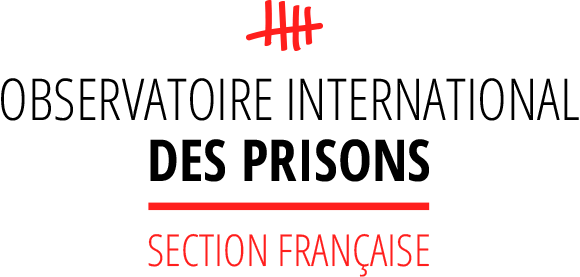Promulguée en février après un long blocage politique, la loi de finances pour 2025 acte une augmentation marginale des crédits dévolus à l’administration pénitentiaire. Les objectifs, quant à eux, restent inchangés : construire toujours plus de places de prison et faire prévaloir le tout-sécuritaire sur les droits fondamentaux. Un programme qui s’inscrit dans la continuité des années précédentes mais que le gouvernement actuel, et son ministre de la Justice au premier chef, semblent fermement résolus à accentuer.
Frôler une dette de 5,4 milliards d’euros[1] pour dépasser 164 % d’occupation en moyenne dans la majorité des prisons françaises[2] : c’est le projet de politique publique qui ressort du Projet annuel de performances de l’administration pénitentiaire pour 2025. Cette feuille de route n’a pas été remaniée après le rejet du projet de loi de finances auquel elle était annexée, en novembre 2024, et l’augmentation des crédits finalement accordés à l’administration pénitentiaire, de 5,2 à 5,3 milliards d’euros. Si les montants exacts sont donc à prendre avec des pincettes, les ordres de grandeur témoignent fidèlement des lignes directrices poursuivies par les pouvoirs publics. Pas d’amélioration à attendre du côté des alternatives à l’incarcération, de l’accompagnement des personnes détenues ou encore de la rénovation d’établissements vétustes. Les principales hausses prévues concernent le nombre de personnes détenues et la dette publique pour construire de nouvelles prisons.
La concentration des moyens sur l’ouverture de nouvelles places s’inscrit dans le droit fil des trente dernières années. Une politique au coût exorbitant, qui ne remplit pas l’objectif proclamé de lutter contre la surpopulation carcérale (voir encadré). Il suffit de regarder l’énième record signé par l’État au 1er avril : 161,8 % d’occupation en moyenne dans les maisons d’arrêt ou quartiers dédiés, où sont incarcérées sept personnes détenues sur dix.
Construire plutôt que rénover
La construction de nouvelles prisons ne permet pas davantage de lutter contre l’indignité des conditions de détention. Pour preuve, les nombreux établissements condamnés par les tribunaux ou visés par des recommandations en urgence du Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans leurs vingt premières années[3]. En réalité, la politique immobilière constitue même un facteur de dégradation des conditions matérielles de détention : c’est autant d’argent public qui n’est pas dédié à la rénovation – en dépit des immenses besoins, qui ne cessent d’augmenter avec l’élargissement du parc carcéral. Après avoir accusé une baisse d’un tiers en 2024, le budget consacré à l’« entretien lourd » serait ainsi encore divisé par deux pour atteindre 28 millions d’euros en 2025. À titre de comparaison, les travaux de rénovation de la seule maison d’arrêt de Saint-Étienne-La Talaudière sont estimés à 30 millions d’euros[4]– une enveloppe jugée insuffisante par l’administration elle-même face à l’ampleur des besoins[5].
Pire, avec le nouveau projet de construire des cellules préfabriquées, la création de nouvelles places de prison pourrait participer plus directement encore à l’aggravation des conditions indignes de détention. Le directeur adjoint de l’administration pénitentiaire a en effet précisé aux organisations syndicales que la dotation allouée à la construction de nouvelles prisons permettrait de « financer un plan d’urgence immobilier visant à accroître les capacités d’accueil des établissements par l’implantation de constructions modulaires sur les domaines pénitentiaires existants »[6]. Si le ministre de la Justice a vanté à la presse, le 14 avril, des « prisons modulaires en béton », construites en usine pour résister « entre 50 et 60 ans », le recours durable à des structures censées être temporaires ne peut que susciter des craintes quant aux conditions de détention. D’autant que des précédents existent : des années après leur mise en service à titre « provisoire », des containers maritimes font toujours office de cellules à la prison de Nouméa.
Le seul mot d’ordre : sécuriser
Plus du double du budget dédié à l’« entretien lourd » est consacré à la sécurisation « active » et « passive » des établissements pénitentiaires, avec 67,2 millions d’euros, d’après le Projet annuel de performances. Cette somme, qui couvre les achats divers d’équipements de sécurité (portiques, armes et gilets pare-balles par exemple), les dispositifs de détection et de neutralisation des communications illicites, la lutte contre les drones dits « malveillants », ou encore la vidéosurveillance et le déploiement des caméras piétons, n’inclut pas de nombreuses autres dépenses sécuritaires. Il faut donc y ajouter les sommes – non chiffrées – dédiées par exemple au renseignement pénitentiaire ou aux équipes cynotechniques. Dans son introduction au Projet annuel de performances, le directeur de l’administration pénitentiaire glisse en outre qu’une réflexion est en cours pour que ces dernières, qui ne pratiquent actuellement « que » le contrôle des locaux, puissent aussi « réaliser la recherche sur personnes »[7].
Cette enveloppe budgétaire dédiée à la sécurité aurait encore été augmentée de 17,6 millions d’euros supplémentaires pour financer le protocole dit « Incarville », selon la présentation du directeur adjoint de l’administration pénitentiaire aux organisations syndicales[8]. Il y est aussi question de « renforcer la sécurisation des établissements de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe, afin de les transformer en prisons de haute sécurité dans la lutte contre la criminalité organisée », un projet profondément inhumain que le gouvernement porte en parallèle au Parlement depuis le début d’année.
Si le Projet annuel de performances ne prévoyait par ailleurs aucune création d’emploi, sauf de personnels de surveillance pour les nouveaux établissements, la présentation de la loi de finances aux organisations syndicales a acté la création supplémentaire de 58 emplois pour « l’établissement criminalité organisée », 15 pour « la lutte contre la criminalité organisée » ainsi que 20 emplois pour le SNRP (service national du renseignement pénitentiaire).
Accompagner, pour quoi faire ?
Rien, donc, du côté des professionnel·les chargé·es d’accompagner les personnes détenues, notamment dans l’élaboration d’un projet en vue de la sortie de prison. Un rapport sénatorial d’information publié début 2023 notait pourtant que l’objectif de 60 personnes suivies par conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (Cpip), « qui sert de référence au niveau européen, rest[ait] encore lointain »[9]. Il estimait qu’il faudrait environ 600 postes supplémentaires pour y parvenir – une estimation sous-évaluée dès lors qu’elle est fondée sur un nombre stable de personnes suivies par la justice – et qu’un tel effort budgétaire devait « être considéré comme un investissement qui peut être source d’économies s’il entraîne une baisse de la récidive ».
D’après le Projet annuel de performances, l’enveloppe dévolue à la prévention de la récidive et à la réinsertion diminuera pourtant d’1,4 million en 2025, pour atteindre 121,8 millions. Alors que le nombre de personnes sous main de justice ne cesse de croître[10] et que l’enveloppe couvre un grand nombre de sujets : travail au service général, évolutions relatives au statut des travailleurs détenus, l’insertion professionnelle, matériel pour l’enseignement, augmentation et diversification des actions de réinsertion, renouvellement des matériels sportifs, cartographie des partenaires sociaux, etc. Un mépris pour l’accompagnement et l’insertion des personnes détenues qui fait écho à la suspension ou la suppression de plus de 150 activités en détention, début 2025, dans la foulée d’une polémique largement alimentée par le garde des Sceaux (voir p.5).
Le budget 2025 ne permettra pas davantage d’atténuer l’exclusion sociale et la récidive produites par la prison, bien au contraire. Les aménagements de peine et alternatives à l’incarcération font pâle figure, avec un budget qui stagne à 52 millions d’euros. Une augmentation drastique aurait pourtant été nécessaire : posé par la loi comme un passage transitoire de principe entre la détention et la liberté, notamment parce qu’il permet de diminuer le taux de récidive, l’aménagement de fin de peine n’est octroyé qu’à une minorité de personnes détenues condamnées. Le « taux global d’aménagement de peine des personnes condamnées et écrouées » était, selon l’administration pénitentiaire, de 27,6 % au 1er août 2024.
Dans le prolongement des années précédentes, les trois quarts de ces crédits sont en outre consacrés à la surveillance électronique, confirmant une culture pénale obsédée par le contrôle et habituée à délaisser l’accompagnement humain. La somme dédiée au placement à l’extérieur, « que les professionnels s’accordent à trouver utile et qui s’adapte à tous les publics » selon les termes de Romain Emelina, chef du département des parcours de peines de la direction de l’administration pénitentiaire (Dap)[11], reste quant à elle figée à 13,8 millions d’euros.
Changer de paradigme
Un amendement pour mettre en œuvre « des procédures d’aménagement de peines pour certains détenus en fin de peine » afin « de désengorger les prisons et d’engager des procédures de réinsertion pour les détenus » avait bien été voté en première lecture du projet de loi de finances pour 2025 par la commission des finances de l’Assemblée nationale[12]. Il s’agissait de réorienter une partie du budget actuellement dédié à la construction de nouvelles places de prison vers la création d’un fonds visant à expérimenter un mécanisme contraignant de régulation carcérale. Ce fonds, de 87,5 millions d’euros sur cinq ans, devait permettre de financer 50 magistrats, 50 greffiers, 250 personnels d’insertion et de probation, ainsi que la création de places en milieu ouvert nécessaires à l’aménagement des peines de prison ferme. En dépit des appels convergents de nombreuses organisations et de l’exemple du Royaume-Uni[13], cette disposition reste fermement rejetée par le gouvernement, qui préfère s’inspirer de ce dernier pour construire des prisons Algeco structurellement indignes.
Au moment où le Projet annuel de performances était publié, fin octobre, plus de trente organisations mobilisées au quotidien sur les politiques pénales et pénitentiaires dénonçaient dans un communiqué commun cette fuite en avant : « Alors que la dette française n’a jamais été aussi importante depuis la seconde guerre mondiale, [nous] le dis[ons] avec gravité : le sens de l’incarcération et la sortie de prison sont des impensés, et l’argent public est gaspillé dans une surenchère sécuritaire aux effets désastreux[14]. » Depuis, le nouveau ministre de la Justice semble pourtant fermement résolu à accélérer la cadence de cette course effrénée.
Par Prune Missoffe
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°126 – Surpopulation carcérale : les personnes détenues prennent la parole
[1] Somme des loyers du titre 5 dus au titre des contrats de partenariat (667,3 millions) et les crédits relatifs aux opérations immobilières (4,7 milliards). Source : Administration pénitentiaire, Projet annuel de performances, Annexe au projet de loi de finances pour 2025.
[2] Ibid.
[3] Par exemple, la prison de Seysses, mise en service en 2003, a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal administratif de Toulouse le 4 octobre 2021, et la prison de Liancourt, mise en service en 2004, d’une condamnation par la cour administrative d’appel de Douai le 15 juin 2010.
[4] Noémie Coquet, « Prison de La Talaudière : fin des travaux prévue en 2027 », Mes infos,
26 octobre 2022.
[5] Voir « Près de Saint-Etienne, plongée au cœur de la prison de la Talaudière, « la pire de France » », France info, 20 avril 2023.
[6] Direction de l’administration pénitentiaire, « Présentation de la LFI 2025 », support de la présentation du budget aux organisations syndicales, 21 mars 2025.
[7] Administration pénitentiaire, op. cit.
[8] « Après Incarville, une déferlante de mesures sécuritaires », Dedans Dehors n° 123, juillet 2024.
[9] « SPIP : la lutte contre la récidive mise à l’épreuve », rapport de mission d’information sur l’évaluation des services pénitentiaires d’insertion et de probation, Sénat, février 2023.
[10] Il dépassait 270 000 au 1er janvier 2024. Source : Gouvernement, « Quelle est la population pénitentiaire ? », Vie publique (en ligne ; dernière modification le 2 janvier 2025).
[11] « Placement à l’extérieur : une alternative à la peine », Dedans Dehors n° 120, octobre 2023.
[12] Amendement n°II-CF968, adopté le 31 octobre 2024.
[13] « Outre-Manche, des libérations massives pour désamorcer la “bombe” carcérale », Dedans Dehors n° 125, décembre 2024 – janvier 2025.
[14] « Coûteuse, inefficace et source d’indignité, la politique pénale doit radicalement changer ! », communiqué de presse, 30 octobre 2024.