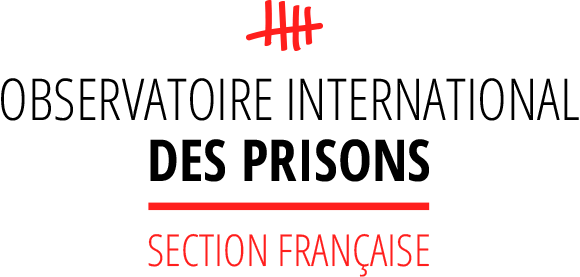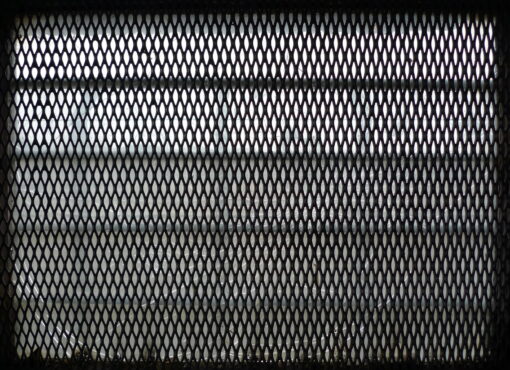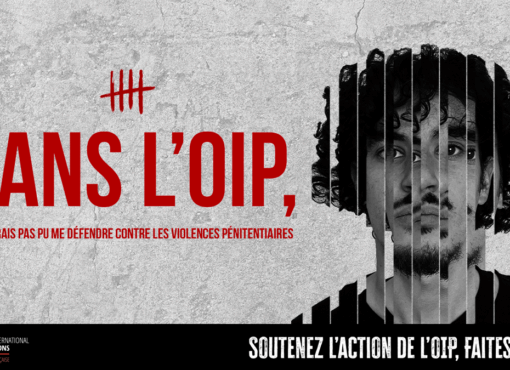Au centre pénitentiaire de Beauvais, les personnes détenues considérées comme appartenant à la criminalité organisée subissent depuis le printemps un durcissement de leur régime de détention. Plusieurs d’entre elles dénoncent des conditions inhumaines et dégradantes.
Au quartier d’isolement (QI) du centre pénitentiaire de Beauvais, les personnes détenues sont soumises à des mesures sécuritaires inédites et extrêmement strictes. D’après la direction, interrogée dans le cadre d’une visite de la députée Ersilia Soudais le 7 juillet, ce régime concerne 13 des 14 occupants du quartier d’isolement, en raison de leur « appartenance à la criminalité organisée ». Ce durcissement s’inscrit dans le contexte d’une surenchère répressive du ministre de la Justice, qui a annoncé récemment l’ouverture de deux établissements de « haute sécurité » afin d’y enfermer les « 200 narco-trafiquants les plus dangereux ». Comme avait alerté l’OIP, loin de se limiter à 200 personnes détenues, cette escalade sécuritaire semble se diffuser plus largement dans les établissements pénitentiaires français, et notamment au QI de Beauvais.
Une escalade de mesures sécuritaires
Plusieurs personnes incarcérées à Beauvais ont contacté l’OIP dès le mois de mars au sujet de fouilles à nu extrêmement fréquentes, de l’ordre de plusieurs fois par semaine. Ces dernières interviendraient lors de chaque fouille régulière de cellule, soit deux fois par semaine, et après chaque rendez-vous extérieur, qu’il s’agisse d’un parloir avec leurs proches, d’un rendez-vous avec leur avocat·e, ou avec le personnel médical de l’établissement. La direction a confirmé lors de la visite l’intensification des mesures de sécurité et la fréquence des fouilles, en accord avec les consignes du ministère de la Justice.
Le droit au secret médical des patients ne serait également pas respecté. En effet, le personnel pénitentiaire imposerait sa présence lors de certains rendez-vous médicaux à certaines personnes détenues. Les patients concernés expliquent que des soignant·es finissent par accepter afin d’éviter l’annulation de la consultation. D’après eux, le caractère impressionnant de l’escorte qu’on leur impose pourrait également générer un sentiment d’insécurité chez certain·es.
Les liens avec l’extérieur sont eux aussi affectés par les mesures de sécurité. Une note émanant de la direction de l’établissement fait en effet état d’une limitation de l’accès à la téléphonie légale à la plage horaire 8h-17h, « en conformité avec les dispositions nationales relatives à la lutte contre la criminalité organisée ». Cette note, adressée à l’ensemble de la population de l’établissement, est appliquée seulement aux personnes considérées comme appartenant à la criminalité organisée, sans qu’elles soient passées par une procédure en limitation, donc sans que des motifs individuels de restriction aient été examinés.
De même, la direction a doté certaines cellules du quartier d’isolement de grilles en plus des caillebotis et barreaux déjà présents, ainsi que d’un grillage de type « cage à poule » formant une cage d’un mètre de profondeur autour de la fenêtre. « Dans la cellule, il y a une fenêtre avec des barreaux, des caillebotis, et collée aux caillebotis une grille avec des trous en forme de losange par lesquels on ne peut même pas passer un doigt, et le pire c’est cette cage derrière, on a l’impression d’être une bête enfermée », décrit Alan G., placé au QI.
Plusieurs avocat·es contacté·es par l’OIP soulignent le caractère arbitraire et injustifié des placements à l’isolement au centre pénitentiaire de Beauvais. D’après ces dernier·es, la direction invoque les liens, même ténus, qu’entretiendraient les personnes concernées avec la criminalité organisée, et imposeraient les mesures détaillées ci-dessus sans proposer d’explications aux personnes détenues, y compris quand celles-ci en font la demande. La direction procéderait de même pour l’inscription sur la liste des DPS (détenus particulièrement signalés) ainsi que pour leur attribuer une escorte d’agents pénitentiaires lors de chacun de leurs déplacements. Maître Julia Le Floc’h-Abdou, avocate au barreau de Paris, place le point de départ de ce durcissement à l’arrestation de Mohamed Amra. Dans les semaines qui ont suivi, elle a remarqué dans l’ensemble des établissements pénitentiaires l’inscription au registre des DPS ou l’attribution d’une escorte d’agents pénitentiaires à tous ses clients considérés comme appartenant à la criminalité organisée : « Cela vise même des détenus incarcérés pour des faits de blanchiment aggravé, recel ou de petits braquages de type boulangerie ou bureau de tabac. Même les détenus prévenus sont classés escorte 3, voire 5, ce qui était habituellement réservé aux terroristes ou aux détenus avec un long palmarès. » Maître Ciaudo, avocat au barreau de Dijon, constate pour sa part une systématisation du recours à l’isolement au centre pénitentiaire de Beauvais. Le motif pénal de la condamnation des personnes est selon lui utilisé pour placer ces personnes à l’isolement ou leur attribuer le statut de DPS, et ce même lorsque ces personnes étaient incarcérées depuis plusieurs années sans incident aucun. Les témoignages des personnes concernées confirment ce point.
Un quotidien marqué par l’isolement extrême et les atteintes à la dignité
Ces mesures de sécurité aggravent encore les conditions de détention d’un régime d’isolement déjà largement dénoncé pour ses effets délétères sur la santé physique et psychique, notamment par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ou la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Les personnes placées à l’isolement sont seules en cellule, et ne doivent avoir en principe aucun contact avec les autres personnes détenues dans l’établissement, y compris à l’occasion de leurs déplacements. Mais si les directions sont incitées à favoriser les interactions, en proposant des activités par binôme ou petits groupes pour rompre l’isolement, le régime spécial imposé à Beauvais exclut les personnes isolées de toute forme d’aménagement : activités collectives, travail et promenades collectives leur sont inaccessibles.
Ne disposant d’aucune activité et de seulement quelques heures de sport par semaine, certaines se replient sur la lecture pour occuper leur journée. La bibliothèque leur étant interdite d’accès, elles commandent des livres à partir du catalogue de la bibliothèque, qui en organise la livraison deux fois par mois. D’après le compte-rendu de la visite parlementaire, le catalogue se révèle très incomplet, et les livres reçus ne correspondent pas nécessairement aux livres commandés. Michaël, incarcéré au QI, explique ainsi que la plupart des livres ne sont plus disponibles, et que l’on ne leur fournit pas de remplacement lorsqu’ils demandent un ouvrage indisponible. Incarcéré depuis plusieurs mois, il aurait obtenu seulement deux livres dans cette période.
Dans ce contexte d’isolement total, le maintien de relations avec leurs proches revêt d’autant plus d’importance pour les personnes détenues. La restriction des horaires d’accès à la cabine téléphonique limite pourtant grandement la possibilité d’échanger, comme l’indique Mehdi dans un courrier adressé à l’OIP : « Les accès cabine sont autorisés de 8h à 17h uniquement, comme si nos familles ne travaillaient pas et que nos enfants n’allaient pas à l’école. […] Je ne peux pas dire à mes enfants “restez enfermés le samedi, ne sortez pas, n’ayez pas de loisirs“ pour que je puisse leur parler. Je ne veux pas qu’ils subissent ce que je vis ici ».
A cette solitude s’ajoute une rupture physique radicale avec l’extérieur du fait des grilles apposées aux fenêtres : « A travers tous ces dispositifs, témoigne Alan, ce que je vois, c’est un grillage de 10 mètres de haut, des murs en béton, une petite parcelle d’herbe et un mirador. Pas plus. Pour éviter de penser à ce que je ne vois plus, j’ai fini par couvrir ma fenêtre avec une serviette. Ça me crée une sorte de cocon. Parce que sinon… autant murer la fenêtre. Ce serait plus clair, plus honnête. Ces grillages, ils nous rappellent constamment où on est. […] C’est l’automne en permanence ici, un automne gris. Je ne sais jamais quel temps il fait dehors. L’autre jour, je suis arrivé au parloir en doudoune. Il faisait une chaleur de plomb. »
Coupées de tout contact, les personnes détenues au QI de Beauvais subissent également des atteintes multiples et répétées à leur dignité. La fréquence des fouilles intégrales est particulièrement violente : elles doivent en effet se mettre à nu devant plusieurs agents au moins deux fois par semaine. « Le caractère de ces fouilles entraîne forcément une forme d’humiliation aussi dégradante que rabaissante, et ce sans aucun motif, car je ne pense pas représenter de danger pour le personnel. Depuis mon incarcération, je n’ai fait preuve que de respect envers le personnel et le règlement », remarque Michaël.
Afin de limiter ces moments dégradants, certaines personnes expliquent renoncer aux rendez-vous médicaux car elles savent qu’ils seraient l’occasion de nouvelles fouilles à nu, ou d’une rupture du secret médical. Alan G. a ainsi indiqué à l’OIP avoir fait l’objet de moqueries de la part d’agents pénitentiaires lors d’un rendez-vous chez le dentiste. Une autre explique avoir réclamé le respect du secret médical à un agent, qui lui aurait répondu que le personnel pénitentiaire faisait partie des professionnels inclus dans le secret médical. Ces conditions dégradantes de prise en charge médicale renforcent les difficultés rencontrées par les personnes détenues dans leur accès aux soins, alors que la visite réglementaire du médecin au QI n’aurait lieu qu’une fois par semaine au lieu de deux, et que la liste d’attente pour rencontrer un·e psychologue est de plusieurs mois.
Ces mesures de précaution contre une dangerosité supposée ont ainsi des conséquences réelles pour les personnes détenues. Elles aggravent leur isolement, les contraignent à subir des atteintes à leur dignité, des humiliations et des actes dégradants, le tout sans justification satisfaisante :
« J’ai une forme de haine que je contiens en moi du fait de ces mesures tant indignes qu’inhumaines. reconnait Michaël. Tout cela ne fait qu’accroître mon mal-être. Leurs nombreuses répressions, la privation de mes droits, leur mépris engendre une détresse profonde. […] C’est un désespoir complet ! Subir de telles conditions aura forcément une incidence lorsqu’un jour je serai à nouveau confronté au monde réel. »
Tellement affectés par ce régime, certains de ces isolés craquent, pris dans la spirale d’un système qui produit ce dont elle dit vouloir se protéger : « J’ai eu 15 rapports [d’incident] en 5 mois, alors que j’en avais eu très peu en 8 ans. C’est la situation qui pousse à ça, on devient le miroir de ce qu’on a subi », confie l’un d’eux.

Par Noémie Rousseau