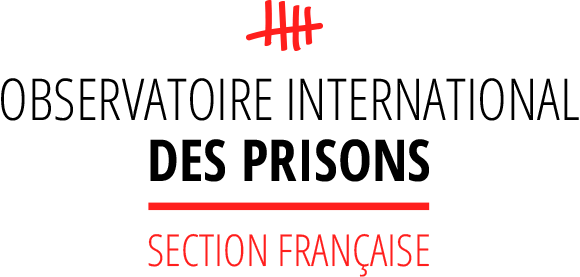Depuis plusieurs mois, les professionnel·les du soin dénoncent une dégradation sans précédent de leurs conditions d’exercice, donc de la qualité des soins dispensés aux personnes détenues, entraînée par le durcissement des conditions de sécurité dans les établissements pénitentiaires. Déjà régulièrement entravé par les contraintes sécuritaires et mis à mal par la surpopulation carcérale, le soin en détention semble aujourd’hui menacé dans son fondement même, au point que plusieurs professionnel·les font le choix de démissionner.
Dès mai 2024, le ministre a annoncé la limitation des extractions, judiciaires comme médicales. Alors que la décision d’une extraction médicale relève de la seule compétence des professionnel·les du soin, le relèvement massif des niveaux d’escorte des personnes détenues à la suite du drame d’Incarville a freiné de fait les possibilités d’extraction. En exigeant un nombre d’agent·es toujours plus élevé, quel que soit le profil du ou de la détenu·e, l’administration a organisé sa propre impossibilité de faire, accroissant le fossé entre les effectifs qu’elle définit comme nécessaires pour l’exécution de la mission et ceux effectivement disponibles. Dans un contexte où le taux d’annulation des extractions faute d’effectifs pénitentiaires pour les mettre en œuvre entraîne régulièrement d’importants retards de prises en charge, avec des conséquences délétères sur la santé des patient·es détenu·es, cette nouvelle étape remet en question la possibilité même du soin.
En février 2025, l’interdiction des activités dites « ludiques ou provocantes » engagée par le garde des Sceaux n’a pas épargné les activités thérapeutiques. Beaucoup de lieux de détention, par exemple à Paris, Nîmes, Mulhouse-Lutterbach, ont connu une suppression des activités médicales organisées par les unités sanitaires, surtout par les services psychiatriques, comme la relaxation ou le yoga, considérés comme ludiques. Le récent rapport d’information parlementaire sur l’évaluation de la prise en charge des troubles psychiques des personnes placées sous main de justice fait état de ces initiatives politiques « particulièrement mal vécues par les soignants », qui « ont dû rappeler [le] rôle thérapeutique avéré » des activités qu’ils proposent[1]. Quant aux activités maintenues, elles sont la plupart du temps devenues inaccessibles aux personnes isolées. Amel Masseboeuf, cheffe du service du SMPR et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) du centre pénitentiaire des Baumettes, fait état dans le rapport parlementaire « de plus grandes difficultés à faire participer les détenus mis à l’isolement à des groupes thérapeutiques ».
Des soins « dégradés et raréfiés » dans les quartiers spécifiques
Dans des quartiers spécifiques, c’est l’ensemble de l’accès aux soins qui est freiné depuis ces derniers mois. Une vaste opération nationale en vue de « sécuriser et étanchéifier les quartiers d’isolement (QI) » a été mise en œuvre par les directions interrégionales, d’après une source pénitentiaire, et a conduit à une rigidification des règles d’entrée et sortie de cellule. Les personnes affectées dans ces quartiers et les autres quartiers spécifiques – principalement quartier disciplinaire, quartiers pour personnes radicalisées (QPR) –, ont vu leurs mouvements, déjà rares, soumis à des conditions renforcées, hormis la sortie en promenade. Dans certains établissements, la direction refuse qu’elles soient amenées à l’unité sanitaire, pour les consultations individuelles comme pour les activités thérapeutiques. « Il n’y a plus du tout moyen que les patients circulent, et donc qu’ils viennent dans des espaces de soin, de sorte qu’on ne peut plus les voir. Ils voient un médecin et un infirmier quand ils ont accès, pour faire du dépistage plutôt que de la consultation et des soins », constate Raphaël Gourevitch, responsable du Service régional médico-psychologique (SMPR) de Paris-la Santé. Beaucoup de soignants refusent en effet de se plier à l’injonction de l’administration pénitentiaire de venir consulter dans les quartiers. « Il est clair que les psychologues ne peuvent pas faire une consultation dans un lieu de non-neutralité », souligne Raphaël Gourevitch. Comment instaurer une relation de confiance dans un lieu où le personnel pénitentiaire règne en maître, quand il ne s’impose pas carrément dans la consultation ? Le problème se pose pour l’ensemble des professions médicales. « Les unités sanitaires sont les seuls lieux où le soin est possible », rappellent les docteurs Béatrice Carton, présidente de l’Apsep et Pascale Giravalli, présidente de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP), cosignataires d’une lettre ouverte publiée le 6 juin dénonçant la « dégradation toujours plus inquiétante » des conditions du soin[2]. Elles font état d’une « remise en cause régulière du cadre et des règles indispensables pour des soins respectueux de la dignité humaine », observée sur l’ensemble du territoire.
Les soignant·es qui se résignent à consulter en détention s’engagent dans un parcours du combattant : « Quand on veut monter dans les quartiers spécifiques, ce n’est jamais le bon moment. On ne nous ouvre pas, ou on nous enferme avec le patient, ça nous prend énormément de temps et ça nous désorganise beaucoup », précise Raphaël Gourevitch. La procédure est d’autant plus longue que le personnel soignant doit désormais passer à travers les dispositifs électroniques de surveillance. « Pour voir les personnes au QI, c’est cadenassé », explique une responsable d’unité sanitaire. « Il faut passer le bagage X et le portique, poser les choses qu’on a dans les poches, et on a un matériel énorme ! Ils ont installé ça dans tous les QI ! Qu’est-ce que ça veut dire sur la confiance qu’on nous accorde ? » Lorsqu’enfin le personnel médical accède au patient, il doit souvent mener la consultation à travers des grilles, en présence de surveillant·es casqué·es et armé·es de de boucliers, ou à travers un passe-menottes. « Lorsque le médecin vient, il me voit au travers de la porte et notre conversation est écoutée par un gradé et trois surveillants », déplorait William K., incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, en juin.
Des lieux de soin investis par la surveillance
Dans certains établissements, les patients des quartiers spécifiques continuent à avoir accès à l’unité sanitaire, mais n’y retrouvent pas forcément les conditions de consultation habituelles : alors que la présence du personnel pénitentiaire en salle de consultation et le refus de démenotter les patients étaient des pratiques observées uniquement lors des consultations réalisées dans les hôpitaux dans le cadre des extractions, ou dans certains cas exceptionnels, elles sont désormais monnaie courante au sein des unités sanitaires des établissements pénitentiaires. La confidentialité et le secret médical sont donc loin d’être assurés, et la dignité des patients est mise à mal : « J’ai eu un rendez-vous dentaire récemment, les surveillants ont obtenu que la porte reste ouverte pour pouvoir me regarder alors que j’étais allongé, ils se moquaient de moi pendant que le dentiste me faisait les soins », racontait Thomas O. en mai.
Concernant le maintien des menottes, la pratique varie là aussi selon les établissements, et même au sein d’un établissement. « La direction a clairement dit que pour les soins du SMPR, les menottes ne seraient pas enlevées, et que pour les soins somatiques, il faudrait donner une raison médicale pour justifier la nécessité du retrait des menottes », affirme Quentin Puyguiraud, infirmier au SMPR de Bois d’Arcy. Des consultations sont donc régulièrement annulées, les conditions n’étant pas réunies pour un accès à des soins effectifs. « On explique au patient devant le personnel pénitentiaire que ce ne sont pas des conditions dignes, et on leur indique les coordonnées du Défenseur des droits », explique Ophélie Marcucci, également infirmière au SMPR.
Une indépendance médicale sous contrôle
Qu’il s’agisse de l’accès aux consultations, des activités thérapeutiques, de la présence des surveillant·es ou du menottage pendant l’acte médical, il semble que l’activité médicale dans son ensemble soit soumise à validation de la direction de l’établissement, charge aux soignant·es de lui fournir des arguments médicaux, au mépris du secret professionnel[3]. Si les soignant·es résistent depuis longtemps aux demandes d’informations à caractère médical de la part de l’administration pénitentiaire, on assiste à un changement d’échelle qui remet en question le principe même du soin. « L’administration pénitentiaire a toujours eu soif d’informations, là ils ont une brèche qui s’est ouverte, un soutien institutionnel qui leur donne l’impression d’être légitime pour en savoir le plus possible, parce qu’ils ont un ministre qui multiplie les déclarations », commente Quentin Puyguiraud. Le rapport d’information parlementaire souligne la généralisation et la « multiplication des situations d’atteinte au secret médical » au cours des derniers mois. Malgré son absence de légitimité en matière médicale, et en violation des principes du partenariat avec le ministère de la Santé[4], l’administration pénitentiaire, à la manœuvre pour organiser tout mouvement en prison, est en position de pouvoir bloquer l’activité médicale, au détriment de la santé des personnes détenues.
Concernant les extractions, déjà freinées par l’inflation des niveaux d’escorte, les médecins se trouvent dans plusieurs établissements face à des injonctions intenables de directions qui exigent qu’ils justifient toute demande d’extraction, sous peine d’annulation. Dans un établissement du sud de la France, la direction a envoyé une demande d’explications à l’Agence régionale de santé (ARS) au sujet d’une extraction programmée par l’unité sanitaire. Au centre de détention de Toulon La Farlède, face aux pressions de la nouvelle direction, qui s’est déclarée seule décisionnaire des extractions médicales, et après le refus d’extraire en urgence un patient vers le centre hospitalier de rattachement, les deux médecins ont quitté le service en mars.
Même scénario pour le démenottage, qui doit être justifié par des raisons pratiques précises, ou pour les activités, dont le chef d’établissement doit pouvoir évaluer l’intérêt thérapeutique. « Si je dois rendre des comptes, c’est à l’ARS », s’indigne une responsable d’unité sanitaire face à ces atteintes répétées à l’indépendance médicale.
Des enjeux déontologiques majeurs
Face à de tels bouleversements dans l’organisation du soin, les soignant·es se sont fortement mobilisé·es. Et les nouvelles prisons « de haute sécurité » de Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe sont un sujet principal de mobilisation, bien au-delà des équipes concernées localement. « Si ce qui est annoncé en local se met en place, ce sera un changement de paradigme, qui pose des questions éthiques et déontologiques majeures », prévient Pascale Giravalli. D’une part en raison de conditions de détention marquées par un isolement strict « dont les effets délétères et inhumains sur la santé physique et psychique des personnes sont prouvés »[5]. D’autre part du fait de « l’annonce de contraintes renforcées pesant sur le soin » dans ces établissements, avec groupes étanches de détenus ne pouvant se croiser à l’unité sanitaire, fouilles à nu après chaque consultation, suppression totale des extractions médicales »[6].
Au moment de l’ouverture de ces prisons « haute sécurité », l’inquiétude et le découragement sont donc importants, et l’avenir du soin en détention incertain. Or, rappelle Valérie Kanoui, cheffe de service de l’unité sanitaire de Fleury-Mérogis et vice-présidente de l’Apsep, « 75 % des responsables d’unité sanitaire d’Ile-de-France auront l’âge de prendre leur retraite dans les cinq ans ». Dans un secteur déjà mis à mal par la faible attractivité de l’exercice de la médecine en prison, comment assurer la relève des soignant·es démissionnaires ou en fin de carrière ?
Par Odile Macchi
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°127 – Une société qui s’enferme : la répression comme seul horizon
[1] Josiane Corneloup, Elise Leboucher, Rapport d’information n°1807 sur l’évaluation de la prise en charge des troubles psychiques des personnes placées sous main de justice, Assemblée nationale, 10 juillet 2025.
[2] B. Carton, P. Giravalli, Lettre ouverte au Président de la République, au Premier ministre, aux ministres de la Santé et de la Justice, 6 juin 2025, APSEP, ASPMP.
[3] Cette ingérence de l’administration dans le soin est dénoncée dans le communiqué de presse de l’Apsep et l’ASPMP du 6 mars 2025.
[4] Ministère de la Justice, ministère des Solidarités et de la santé, « Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice », guide méthodologique, édition 2019.
[5] Lettre du 4 mai 2025 adressé aux ministres de tutelle par l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP) et l’Association des professionnels de santé exerçant en prison (Apsep)
[6] Rapport d’information parlementaire précité