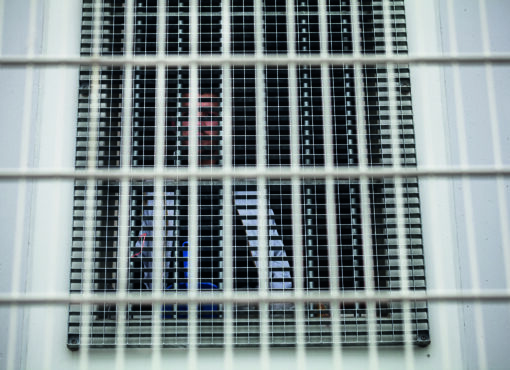Le sociologue Corentin Durand décrypte ce qui se joue en commission disciplinaire. Et rappelle que la discipline en prison est loin de s'y limiter : omniprésesnte, elle matérialise au quotidien les relations asymétriques entre le détenu et l'administration. Un déséquilibre que, selon lui, aucune procédure ne pourra compenser.
Dans vos travaux, vous soulignez que le nombre de comportements passibles de sanctions disciplinaires est « potentiellement infini, sinon indéfini ».
Corentin Durand[1] : Le principe même du droit disciplinaire est d’être encadré jusqu’à un certain point : il y a toujours des clauses fourre-tout, y compris dans des listes restrictives. Par exemple, est défini comme une faute par le code pénitentiaire le fait de « refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement »[2] ; ce peut être tout et n’importe quoi, comme enlever votre serviette de la fenêtre, déboucher un œilleton, baisser le volume de votre radio… toutes choses qui font partie du quotidien en détention. De telles formulations permettent de sanctionner des comportements un peu à l’infini.
En même temps, tous les « incidents » ne finissent pas en commission de discipline. Comment l’expliquer ?
Certains vont être absorbés dans de la « gestion de coursive », dans le relationnel ou des règlements de comptes informels, comme le fait de refuser quelque chose qu’on accorde d’habitude, de ne pas ouvrir une cellule pour une activité, ou encore de couper l’électricité la nuit… Décider de rédiger un compte-rendu d’incident (CRI), c’est-à-dire d’enclencher la machine disciplinaire, est toujours un risque pour les surveillants. C’est un risque relationnel d’abord, puisqu’on est amené à recroiser chaque jour la personne contre laquelle on a fait un CRI ; certains arrangements interpersonnels, qui sont ce sur quoi repose la paix sociale en détention, sont plus difficiles à tenir quand on a signalé un incident. C’est aussi un risque professionnel : faire appel à l’autorité supérieure, trop souvent ou « à mauvais escient », peut être vu comme la preuve qu’on ne sait pas gérer sa détention. C’est pourquoi tous les comportements potentiellement répréhensibles ne font pas nécessairement l’objet de comptes-rendus d’incidents. Et même lorsqu’un CRI est rédigé, il ne donne pas toujours lieu à des poursuites : un tri va être fait par la hiérarchie pour décider quels incidents vont être poursuivis disciplinairement et lesquels vont être classés ou faire l’objet d’un traitement « infra-disciplinaire ».
Qu’entendez-vous par « infra-disciplinaire » ?
C’est un ensemble de procédures plus ou moins formalisées au sein de l’administration pénitentiaire répondant souvent à diverses appellations empruntées au pénal – « médiation disciplinaire », « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », etc. – qui permettent de sanctionner sans passer par la commission de discipline. C’est du « formel informalisé » : avec l’infra-disciplinaire, ce sont les officiers dans leur bureau, derrière des portes closes, qui vont négocier l’accord de la personne sur une sanction, contre le fait qu’il n’y ait pas de traces, pas de conséquences sur les aménagements de peine, etc. « Je te mets ça, mais j’aurais pu faire plus, entre toi et moi il y a un accord : tu t’engages à bien te tenir et si tu te tiens bien, tu auras ça. » Les relations carcérales, la coopération entre gardiens et gardés, est basée sur ce pouvoir discrétionnaire. Avec l’infra-disciplinaire, la hiérarchie intermédiaire récupère une partie de ce pouvoir de punir (jusqu’au confinement cellulaire) dont la formalisation de la procédure disciplinaire les avait privés. Si elles ont l’avantage de ne pas laisser de trace et d’exclure le quartier disciplinaire des sanctions prononçables, ces procédures offrent moins de garanties que la procédure disciplinaire puisqu’il n’y a pas de témoin (pas d’assesseurs, pas d’avocat). Surtout, elles échappent au contrôle exercé par le tribunal administratif.
Quels incidents vont justifier des poursuites et un passage en commission de discipline ?
La commission de discipline est une ressource rare, au coût bureaucratique élevé ; il faut que ce qui en ressort en vaille la peine d’un point de vue de gestion de la détention. Or, ce que permet la procédure, c’est le placement au quartier disciplinaire. Dans ce que j’ai pu observer, les incidents poursuivis sont ceux qu’on veut sanctionner de cette manière. Il s’agit avant tout d’affronts aux surveillants : des insultes, des menaces – les véritables atteintes physiques étant rares. Ensuite, il y a les violences contre d’autres prisonniers, mais cette fois seulement en cas de violences physiques. Et puis il y a toutes les infractions non relationnelles, principalement la détention de produits interdits (stupéfiants, téléphones, etc.), dont le traitement dépend de la politique de l’établissement : dans un centre de détention particulièrement calme, la moindre barrette de shit va passer en commission. Dans une maison d’arrêt où il y en a dans toutes les cellules, on va attendre les grosses quantités, la répétition d’incidents ou la suspicion d’implication dans des formes de trafic, etc.
Au-delà de la nature de la faute, d’autres facteurs entrent-ils en ligne de compte ?
La manière dont le compte-rendu d’incident est rédigé joue aussi. J’ai beaucoup entendu les officiers en charge de ce tri dire « ça, c’est mal écrit, on ne va pas le faire passer en commission ». La possibilité d’un recours, si peu nombreux et si peu couronnés de succès soient-ils, est vue comme quelque chose à quoi il faut faire attention. Il y a des normes de rédaction à respecter pour ne pas risquer de se faire « retoquer » par le tribunal administratif. Par exemple, on ne peut pas juste dire « j’ai été insulté », sans spécifier les insultes. Mais cela reste un critère secondaire : face à un incident considéré comme grave, la hiérarchie prendrait un risque à ne pas engager de poursuites, surtout si c’est un agent qui a été insulté, menacé. Classer l’incident, c’est une forme de désaveu vis-à-vis du surveillant et cela entraîne des réactions, notamment sous la forme de tracts syndicaux. Donc ce genre de CRI, même avec des faiblesses dans la rédaction, peut justifier des poursuites disciplinaires.
À quoi sert la commission de discipline ?
J’ai entendu un jour un directeur justifier le prononcé d’une sanction collective en disant : « la discipline est plus une affaire de gestion que de justice ». De fait, la commission de discipline est au croisement de logiques en tension. Sa première fonction, c’est de punir, et par la même occasion de rappeler et de restaurer l’asymétrie des pouvoirs. Le décorum de la commission de discipline lui-même – avec le prisonnier debout, entouré de deux ou trois surveillants, face à un directeur et à des assesseurs assis, avec parfois au milieu une barre qui « singe » celle du tribunal – est fait pour marquer l’asymétrie. Celle-ci s’affirme également dans la punition, qui vient marquer de façon très concrète ce surpouvoir de l’institution, du directeur, sur le prisonnier. La commission de discipline a aussi une fonction de cohésion professionnelle : par la sanction, le directeur vient marquer un soutien à ses personnels. Au stade de la commission disciplinaire, il n’y a jamais, ou de manière exceptionnelle, de moment où on accepte une version radicalement contradictoire à celle des personnels. J’ai le souvenir d’une directrice qui relisait le compte-rendu d’incident de plus en plus fort pour couvrir les contestations du prisonnier, jusqu’à dire « Moi je pense que vous mentez. Tout ça, c’est vrai ». Dans une telle scène d’humiliation, la restauration de l’asymétrie est particulièrement visible.
Dans cette configuration, que vaut la parole de la personne détenue ?
Il y a une sorte de « présomption de crédibilité » de ce qui est écrit dans le compte-rendu d’incident, qui est vu comme irréfragable. Le fait que la parole du surveillant vaille plus que celle de la personne détenue est la base du surpouvoir des agents pénitentiaires et des rapports en détention. Cela s’illustre d’ailleurs dans ce paradoxe : la procédure disciplinaire produit énormément d’écrits, mais il n’y en a pas un seul qui soit rédigé par la personne détenue elle-même. Tout ce qui relève de l’expression de la personne détenue est traduit – et non simplement retranscrit – par un agent pénitentiaire. Même la parole de l’avocat, lors de la commission, est synthétisée par la direction, ou son secrétaire. La maîtrise de la forme, de l’écrit, appartient de bout en bout à l’administration pénitentiaire.
Vous parlez également de la fonction « réintégratrice » de la commission de discipline. Dans quel sens ?
Sauf dans les cas rares de transfert, les personnes détenues ont vocation à réintégrer la détention après la sanction. C’est un enjeu dont la direction est évidemment consciente. Au-delà de la punition, la commission vise à faire accepter la sanction et obtenir un engagement moral de la part du prisonnier, en disant par exemple « Là je vous ai mis trois jours, mais j’aurais pu vous mettre plus. Si vous revenez devant moi, je me souviendrai de vous, j’attends de ne plus entendre parler de vous jusqu’à la fin de la détention ». Il y a aussi tout un travail sur ce qui est fréquemment désigné comme de « l’intolérance à la frustration » lors des commissions : « Vous voyez comment vous réagissez ? Vous ne savez pas garder vos nerfs », etc. L’intervention institutionnelle n’est pas centrée sur le motif premier, à la source de l’incident – par exemple les tensions liées au fait d’être trois en cellule, ou le fait de ne pas avoir été appelé pour une activité à laquelle on était inscrit – mais sur l’individu lui-même, que l’on soumet à une espèce de thérapie émotionnelle à la fois rétrospective (« Regardez comment vous avez réagi ») et prospective (« la prochaine fois, vous respirez, vous venez nous en parler, vous écrivez »). Au cœur des commissions, il y a ce travail de réinjection du mécontentement dans des circuits plus acceptables. Il s’agit de discipliner l’expression.
L’arrivée des avocats en commission de discipline, au début des années 2000, puis le remplacement de l’un des assesseurs pénitentiaires par une personne extérieure à la prison, en 2011, ont-ils changé les choses ?
On a invité l’avocat à entrer en commission de discipline, mais aucun texte ne codifie les échanges : il parle quand le directeur lui dit de parler ; il peut demander des pièces, mais l’administration peut s’y opposer, en invoquant des motifs de sécurité. L’expérience montre de manière assez claire – et de nombreux avocats le reconnaissent eux-mêmes – que l’avocat ne change pas grand-chose à l’issue de la procédure, au prononcé de la sanction. Là où cela peut avoir un effet, c’est dans le ton et la nature des débats : il y a des choses qu’on ne peut pas dire en présence d’un avocat. Les références au droit deviennent plus naturelles.
Quant aux assesseurs extérieurs, je pense qu’il y a un grand malentendu. L’idée que ce représentant de la « société civile » allait, en lui-même, apporter la lumière de l’extérieur en prison est assez naïve. C’est oublier la force de socialisation de la prison. Sans compter ses expériences propres, l’assesseur ne perçoit la détention qu’à travers la commission de discipline : une fois par semaine, il voit défiler des personnes pour des insultes, des menaces, entend « mais ça fait combien de fois qu’on vous dit qu’on ne fume pas du shit ? ». Difficile dans ces conditions de développer un point de vue critique sur la vie en détention… Et quand bien même, il faut se rappeler que ce n’est pas un vote : l’assesseur peut donner un avis, mais c’est le directeur qui décide. Pour moi, c’est vraiment la définition de la mesure symbolique qui fait écran aux vrais problèmes.
La procédure a connu d’autres évolutions, avec le développement du contradictoire et l’extension des possibilités de recours. La discipline en prison est-elle pour autant moins arbitraire, plus équitable ?
Je crois qu’en la matière il faut dépasser le commentaire – critique ou élogieux – des réformes pour s’intéresser à leurs effets concrets sur la détention. En l’occurrence, le premier de ces effets, c’est d’avoir vu les dossiers disciplinaires s’épaissir d’innombrables formulaires. Par exemple, le droit à être représenté par un avocat a été traduit par un formulaire qui atteste que l’assistance d’un avocat a bien été proposée, et d’un autre qui atteste qu’il a bien été contacté – sans qu’aucun des deux ne garantissent d’ailleurs qu’il y aura bien un avocat présent lors de la commission. J’ai toujours été fasciné par le nombre de papiers qu’un prisonnier doit signer tout au long d’une procédure disciplinaire – au moins une dizaine. Mais qu’il les signe ou pas, tout se passe ensuite exactement de la même façon. Il s’agit là de signatures parfaitement symboliques, qui visent plus à protéger l’administration d’éventuelles contestations qu’à garantir l’exercice de droits. Rajouter des procédures, du papier, des choses que l’on peut contrôler ou contester a posteriori, n’a jamais résolu le problème de l’arbitraire, qui trouve toujours le moyen de s’accommoder de la forme. De même, calquer davantage la commission de discipline sur le procès pénal – par exemple en faisant en sorte qu’elle soit présidée par un juge – me semble être une impasse. En poursuivant le judiciaire, on chasse juste le disciplinaire ailleurs : au fur et à mesure que l’on formalise, il y a plus d’infra-disciplinaire, plus de sanctions informelles. C’est le propre du disciplinaire en prison : être le reflet d’une asymétrie, d’un surpouvoir inhérent à une institution de contrainte. Aucune procédure, aucun formulaire, n’y pourra rien.
À l’issue du processus disciplinaire, quel est le sentiment qui prédomine chez les personnes détenues ?
Je me garderai de toute généralisation parce qu’il y a des styles disciplinaires très différents, y compris au sein d’un même établissement, selon le directeur, la directrice ou l’adjoint qui préside la commission, et bien sûr une grande diversité d’expériences individuelles du côté des prisonniers. On peut parfois entendre l’expression d’une forme de satisfaction de ce contact rare avec la direction : « J’ai pu discuter avec la directrice, elle, elle comprend. » Cependant, beaucoup de personnes font part d’un sentiment d’inégalité, mettant en avant des disparités de traitement entre prisonniers (« Mon pote il s’est fait prendre avec un téléphone il y a deux mois il n’a rien eu, moi j’ai pris cinq jours »). Ce sont aussi des personnes qui, par la force des choses, ont une certaine expérience de la justice pénale et ont intégré un certain nombre de normes, telles la charge de la preuve, la valeur probatoire d’un témoignage, etc. et qui voient bien la différence : « Moi j’avais plein de témoins, ils n’ont pas voulu les entendre », « Parole contre parole, ça ne serait jamais passé face à un juge »… Pour les prisonniers qui résistent, qui refusent de jouer le jeu, la commission disciplinaire est le lieu de l’apprentissage de l’impuissance. Il y a chez eux un très fort sentiment d’injustice, qui n’est pas sans lien avec cette idée, souvent exprimée, que « l’administration est plus forte », que « de toutes manières, à la fin, ce sont eux qui gagnent ».
Le nombre de recours est extrêmement faible. Comment cela s’explique-t-il ?
Au-delà des facteurs classiques liés à la connaissance de leurs droits par les prisonniers et leur capacité à faire des recours, cela s’explique par les insuffisances des dispositifs juridiques eux-mêmes. Les chances d’obtenir gain de cause sont objectivement très faibles et, de toutes manières, la sanction sera purgée bien avant que leur requête ne soit examinée. De nombreux avocats expliquent d’ailleurs conseiller à leurs clients de ne pas faire de recours. Quant aux personnes détenues, elles insistent sur les coûts de telles procédures : en temps (surtout lorsque celui de la peine est court), en énergie, et surtout en termes de conséquences sur la vie en détention. C’est plus dur d’en appeler à la bienveillance du directeur quand on a soi-même activé le registre du droit contre l’une de ses décisions. Même les rares prisonniers qui acceptent ces conséquences et d’endosser le stigmate du « procédurier » reconnaissent souvent qu’ils le font par principe, sans véritable espoir de succès. L’un d’eux le formulait ainsi : « On peut les faire chier, mais pas les battre ».
Propos recueillis par Laure Anelli
Cet article est paru dans la revue DEDANS DEHORS n°119 – août 2023 : Discipline en prison : la punition dans la punition
[1] Corentin Durand est l’auteur d’une thèse intitulée Les reconfigurations de la relation carcérale : sociologie des espaces de communication entre prisonnier·e·s et autorités pénitentiaires, soutenue en octobre 2019 à l’EHESS.
[2] Article R232-5 du code pénitentiaire.