La réduction drastique des interactions et des mouvements des personnes placées à l’isolement les expose à des risques psychiques et somatiques majeurs. Pourtant, plus encore que dans le reste de la détention, l’accès aux soins est entravé et le suivi médical défaillant.
« L’isolement, ça rend fou, ça détruit ! s’exclame Monsieur E., à l’isolement dans le centre de la France. Quand j’étais en détention classique, je ne faisais pas tous ces allers-retours à l’UHSA [unité hospitalière spécialement aménagée]. » Ce régime de détention extrême, caractérisé par la restriction des contacts humains, peut en effet accélérer le développement de certaines pathologies, voire en favoriser l’émergence[1]. « Les personnes à l’isolement ont beaucoup plus de ruminations anxieuses, du fait d’être seules en cellule, de ne pas avoir de stimuli extérieurs, de ne jamais voir de pairs », pointe Claire Cugier, psychiatre à la prison de Nanterre. Ces troubles anxieux, dont tous les praticiens soulignent la prévalence, peuvent entraîner des effondrements dépressifs, voire psychotiques. « J’ai des hallucinations visuelles et auditives, des idées noires », écrit une femme à l’isolement depuis quelques mois dans l’ouest de la France. Quant à Monsieur G., incarcéré dans le Sud-Ouest, il décrit ainsi son état d’esprit : « Dépression, renfermement, angoisse, perte d’avenir. » « C’est une torture psychologique » résume une autre personne incarcérée.
À terme, ce régime est « un rouleau compresseur », s’inquiète Charlotte Haguenauer, psychologue à Nanterre. « Au départ, les détenus peuvent être très demandeurs de soins, et après une longue période d’isolement, certains peuvent se retrouver dans un tel état de dénuement psychique qu’ils ne demandent plus rien. Quand on est en colère, on est encore du côté de la vie ; mais quand on n’a plus la force d’être en colère, parce qu’il n’y a plus rien à espérer, on est du côté de la mort. » La mort, nombreuses sont les personnes isolées à l’évoquer – bien que les suicides à l’isolement restent exceptionnels : trois en 2023, sur 143 passages à l’acte en détention, et un sur 125 en 2022, d’après la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap). « Je pense souvent à ma tombe. Bizarre, non, à trente ans ? » écrit, laconique, Monsieur G.
Pour Claire Cugier, outre l’altération de la santé mentale, l’isolement abîme aussi la capacité des personnes à nouer des relations sociales, y compris une fois dehors (voir encadré). Charlotte Haguenauer n’hésite pas, quant à elle, à parler d’une véritable « intolérance à autrui ». Privées d’échanges au quotidien, n’ayant que les sons de la détention à portée d’oreille, les personnes à l’isolement tendent ainsi à développer une hypervigilance, une méfiance exacerbée, voire des mécanismes de défense paranoïaques, soulignent les praticiens. « Le médecin passe à la porte et fait semblant de s’intéresser à mon état de santé, soupçonne Monsieur V., à l’isolement dans le sud de la France, qui refuse tout suivi psychologique. De même que Monsieur N., détenu dans le Centre. « Certains refusent d’être soignés, voire d’échanger avec nous, confirme le Dr A., médecin généraliste intervenant en centre pénitentiaire. Il faut continuer de passer les voir, de proposer une écoute, malgré tout. »
Dans ces conditions, même quand des soins sont mis en place, les personnes détenues peuvent se révéler moins réceptives. « Quand les gens sont isolés, on se rend compte que le délai d’amélioration clinique est beaucoup plus long, souligne Geoffroy Valmy, psychiatre au service médico-psychologique régional (SMPR) de Seysses. Là où une personne en dépression va se sentir mieux au bout de trois mois, à l’isolement, il va falloir quasiment le double. »
Des corps en souffrance
Délétère pour la santé mentale, l’isolement l’est aussi pour le corps des personnes détenues. Parmi les premières victimes, la vue. Absence de vision lointaine, conditions d’éclairage souvent mauvaises, décors immuables : étant donné le confinement extrême à l’isolement, les praticiens observent une baisse de l’acuité visuelle plus rapide qu’ailleurs. L’ouïe, en revanche, se développe : l’hyper-acousie fait partie des symptômes les plus souvent relevés, au point que certains sons deviennent vite intolérables. « Les bruits me font peur et me font sursauter ! », note Monsieur H. après plus de quinze ans à l’isolement. D’autres bruits, entendus à travers la porte de la cellule, peuvent donner lieu à des surinterprétations, parfois paranoïaques. Autre sens rapidement affecté, le toucher, qui peut parfois devenir insupportable. « Ce sont des gens qui n’ont plus du tout de contact, et le fait de simplement leur serrer la main en début de consultation peut sembler intrusif, parfois agressif, et entraîner des réactions inadaptées », déplore le Dr Valmy.
À ces altérations des sens s’ajoutent de nombreux troubles alimentaires. « Je mange tout le temps », « je suis passé de 70 à 90 kg » : nombre de témoignages décrivent un rapport perturbé à la nourriture. Alimentation déséquilibrée, grignotage, prévalence de produits sucrés, manque d’activité physique : à l’isolement plus qu’ailleurs, l’alimentation peut rapidement avoir des conséquences délétères sur l’organisme. Et ce d’autant plus que les psychotropes souvent prescrits aux personnes isolées peuvent favoriser la prise de poids.
Les conditions dans lesquelles se déroule l’heure de promenade réglementaire quotidienne ne favorisent pas non plus le maintien d’une santé optimale. « Les pathologies articulaires sont fréquentes. Les cours sont toutes petites et ils y tournent en rond, déplore le Dr A . Ils passent souvent beaucoup de temps inoccupés, ou devant la télévision. C’est une vie extrêmement monotone. » Si bien que finalement, les personnes à l’isolement sont nombreuses à cumuler différentes pathologies. « Avant, je n’avais aucun traitement, aujourd’hui j’ai cinq thérapies : pour l’hypertension, le cœur, les reins… J’ai des problèmes de motricité et je ne peux pas bouger comme je le voudrais », indique Madame L., incarcérée dans le Nord et ayant cumulé plusieurs années d’isolement.
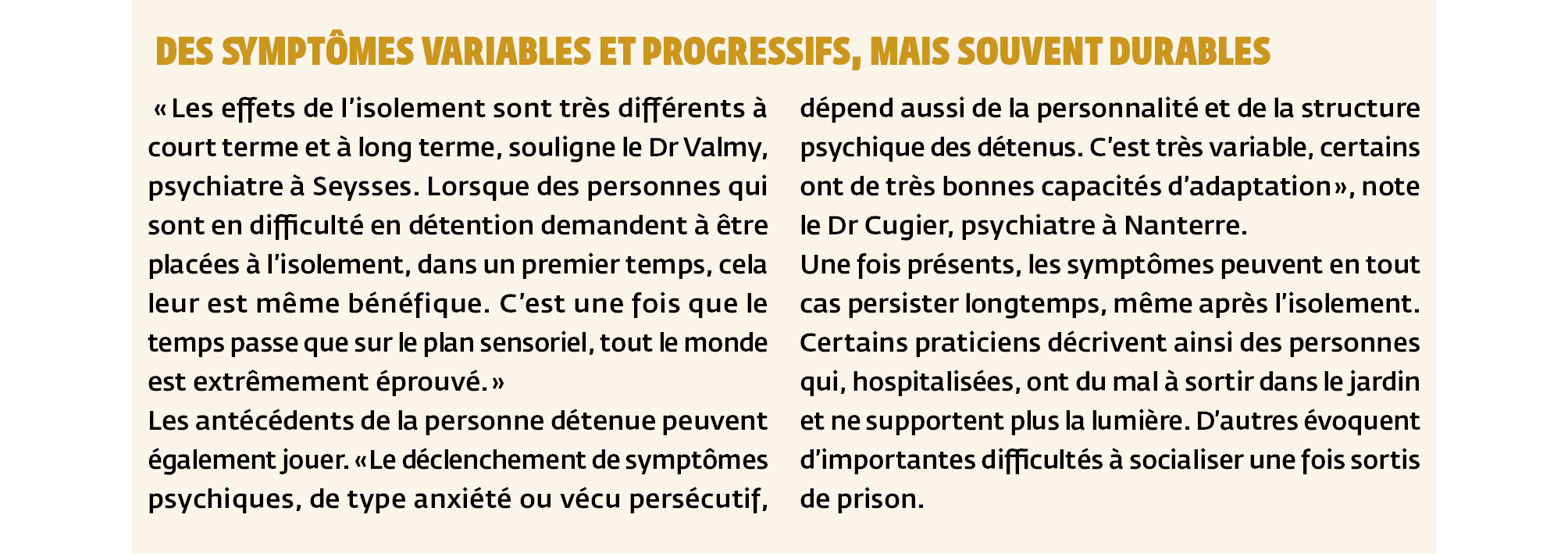
L’accès aux soins entravé
En dépit de ces risques médicaux accrus, l’accès aux soins s’avère encore plus compliqué à l’isolement que dans le reste de la détention. En théorie, les personnes placées au quartier d’isolement et au quartier disciplinaire doivent être vues par un médecin deux fois par semaine – non pour une consultation en bonne en due forme, mais pour évaluer leur état général et leur permettre de signaler d’éventuels problèmes pour lesquels elles devraient, le cas échéant, être reçues à l’unité sanitaire. Mais dans les faits, il arrive que ce rythme de visite, pourtant obligatoire, ne soit pas tenu. Madame L. ne reçoit qu’une visite par semaine : « Le médecin m’a indiqué qu’ils n’étaient pas assez nombreux pour tout le centre pénitentiaire. » D’autres témoignages sont encore plus inquiétants : Monsieur G. explique ainsi voir les médecins « une fois tous les quinze jours ». « Ce n’est pas toujours facile de trouver un moment qui convienne au médecin, au surveillant et au détenu, concède le Dr A. Certains surveillants se rendent disponibles le temps nécessaire et restent à l’écart pour préserver la confidentialité des échanges, mais d’autres se disent toujours occupés et demandent de repasser. Quant au soignant, s’il veut faire cette visite consciencieusement, mettre à jour le dossier médical du patient et transmettre les demandes spécifiques, c’est autant de temps à caser dans sa demi-journée de consultations. »
Quand ils ont bien lieu, ces échanges restent par ailleurs souvent très superficiels. « Il dit bonjour et il s’en va », témoigne une personne à l’isolement dans le centre de la France. « S’attarder dans une cellule provoque souvent un agacement visible chez certains surveillants, note le Dr A. Et de plus en plus souvent, pour certains détenus, ordre est donné de ne pas ouvrir la porte, donc il faut se plier en deux pour échanger à travers le passe-menottes. Que peut-on en attendre ? »
Lorsque des consultations plus approfondies sont nécessaires, un bras de fer s’engage souvent entre soignants et surveillants : ces derniers veulent que la consultation se fasse au quartier d’isolement, quand les premiers plaident pour faire descendre les patients à l’unité sanitaire. « J’ai eu deux consultations en un an à l’unité sanitaire. Les surveillants mettent la pression pour que ça soit le médecin qui monte », confirme Monsieur E. « J’essaie au maximum de les recevoir à l’unité sanitaire, qui reste le lieu du soin, insiste Charlotte Haguenauer : symboliquement, ce n’est pas du tout la même chose de parler dans une salle de commission de discipline, par exemple, ou dans le bureau du psychologue au sein du service médical. Le déplacement des détenus du QI vers l’unité sanitaire est très compliqué puisque cela implique d’arrêter les autres mouvements de la détention, d’où le refus fréquent des surveillants. »
De facto, la balance penche rarement du côté médical, et de nombreux praticiens préfèrent alors voir leurs patients dans un cadre non optimal que de ne pas les voir du tout. « Dans ces quartiers, il y a très peu de portes qui ferment avec des poignées, elles sont souvent entrebâillées : cela ne permet pas de garantir l’étanchéité du cadre et le secret professionnel auquel chaque intervenant hospitalier est soumis », poursuit Charlotte Haguenauer. Son confrère Geoffroy Valmy complète : « Les conditions de consultation au quartier d’isolement ne sont pas satisfaisantes. C’est une salle à tout faire, utilisée par les avocats, les Cpip [conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation], on n’a pas notre dossier médical, rien, c’est un cagibi ! » La polyvalence des salles entraîne en outre des conflits d’agendas. « S’il y a déjà un entretien en cours, par exemple avec un avocat, on est obligé d’attendre. Et ça peut entraîner des retards de consultation de plusieurs jours – même pour les cas qui nous sont décrits comme urgents », poursuit-il.
Ces multiples embûches finissent souvent par décourager patients comme soignants. « Quand il faut se battre chaque semaine pour faire une visite avec de vrais échanges, c’est usant, soupire le Dr A. Il m’est arrivé de baisser un peu les bras. » Même quand les patients sont amenés à l’unité sanitaire, les conditions dans lesquelles se font les déplacements sont elles aussi décourageantes : « Ils viennent menottés, sous forte escorte, avec des fouilles à corps avant et après. Il y en a qui finissent par refuser de venir, et qui refusent les extractions à l’hôpital pour les mêmes raisons », complète un autre praticien en maison centrale.
Le sentiment d’impuissance des soignants est d’autant plus grand que leur avis est régulièrement sollicité, mais finalement peu pris en compte (voir encadré). Même des aménagements du quotidien, prescrits sur ordonnance, peuvent être refusés. « En tant que médecin, on peut essayer de faire un peu changer les choses, appuyer les demandes d’accès au travail ou aux activités, en expliquant que c’est aussi un traitement contre l’oisiveté et l’isolement, mais on a très peu d’impact », soupire le Dr Cugier. Un aveu d’impuissance que partage le Dr Valmy : « Il est difficile de pouvoir discuter avec l’administration pénitentiaire du fait que c’est parfois l’isolement qui dégrade la santé mentale des personnes. Une hospitalisation ne fournira qu’une solution temporaire aux difficultés, et les arguments sécuritaires prévalent souvent sur le soin. »
Et de conclure : « Les personnes isolées n’ont pas un accès égal aux soins par rapport à ceux qui sont en bâtiment. Là où nous estimons qu’une personne aurait besoin d’un suivi mensuel, ce sera au mieux tous les deux mois. Et quand certains, au QI depuis longtemps, finissent par être hospitalisés, c’est souvent parce qu’il y a eu un retard de prise en charge, dû à des décisions qui ne sont pas de notre ressort. En résumé, le quartier d’isolement, ça isole pour tout, même pour le droit fondamental de se soigner. »
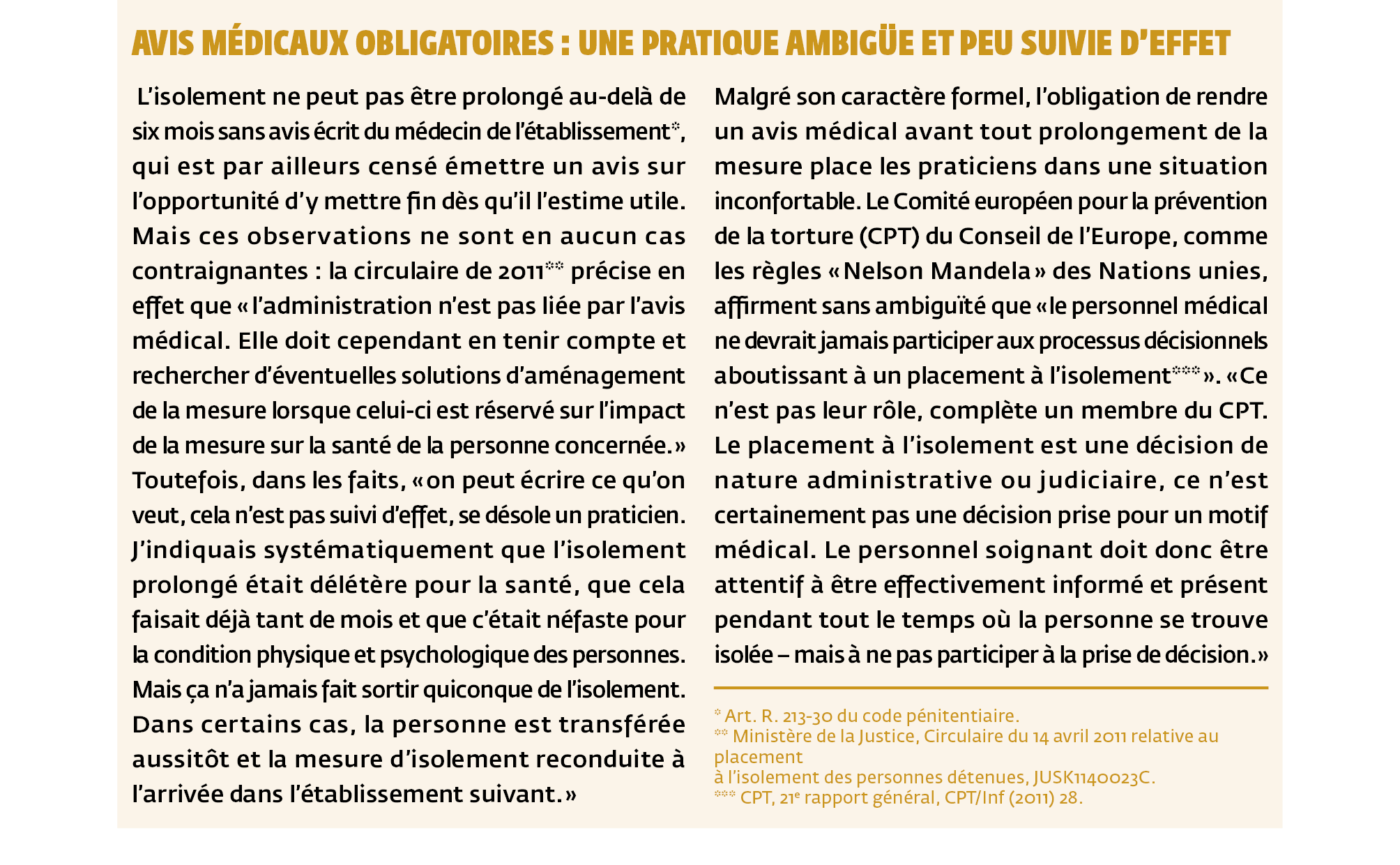
Par Pauline Petitot et Charline Becker
[1] Pour une revue des principales études médicales disponibles sur le sujet, voir Sharon Shalev, A Sourcebook on solitary confinement, Mannheim Centre for Criminology/ London School of Economics and Political Science, 2008.






