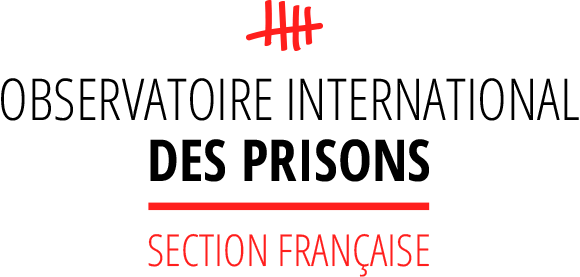L'Assemblée nationale vient d’adopter la proposition de loi transpartisane déposée par Gabriel Attal visant à durcir la répression à l’encontre des mineurs. Derrière les discours sur l'autorité et la sécurité, cette proposition de loi renonce à la distinction qu’une société se doit pourtant d’assurer entre capacité de discernement et de maturité des mineurs d’un côté, et des majeurs de l’autre. En restreignant l'atténuation de la responsabilité pénale des 16-18 ans et en instaurant une procédure de comparution immédiate pour les mineurs dès 16 ans, cette proposition de loi détruit le principe fondamental de l'éducation prévalant sur la répression.
Les jeunes, souvent issus de milieux vulnérables, risquent d’être jugés dans l’urgence. Huit fois plus. C’est la probabilité d’aller en prison à la suite d’une comparution immédiate par rapport à une audience classique de jugement[1]. Une étude de l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux (ORDCS) a révélé que les audiences en comparution immédiate duraient en moyenne 29 minutes pour décider du sort de la personne, aboutissant à 70 % de peines de prison ferme.
Derrière, des vies humaines. Le 30 juillet, c’est un homme condamné à 5 mois de prison ferme pour « menaces de dégradation », avec mandat de dépôt, c’est-à-dire incarcération immédiate à la sortie du tribunal pour avoir crié aux usagers de la station de métro qu’il y avait une bombe et avoir tenté d’éloigner les personnes présentes, une bombe qu’il imaginait durant un épisode psychotique induit par l’usage de stupéfiants auxquels il est addict depuis ses 16 ans. Le 3 janvier, c’est une femme placée en détention provisoire pour deux mois alors que la procureure avait demandé un placement sous contrôle judiciaire au motif qu’elle était âgée de 21 ans, mère d’un enfant de deux ans, avec un logement et un travail, et que la détention viendrait « casser tout ça ».
Comment imaginer, dans ce cadre, et lorsque la personne comparaît généralement dans la foulée de sa garde à vue, qu’une telle procédure expéditive puisse être digne d’une institution judiciaire ? Qu’une procédure qui broie des adultes puisse être élargie à des adolescents ? Peut-on sérieusement faire fi de l’effet cliquet qui guette face à l’élargissement à terme de cette procédure à tous les enfants susceptibles d’être incarcérés, c’est-à-dire à partir de 13 ans ?
Une politique pénale juste ne peut être fondée sur l’émotion de faits divers dramatiques. Le risque zéro n’existe pas. Faire croire à l’opinion publique qu’il serait atteignable est démagogique. et extrêmement dangereux. L’administration pénitentiaire le dit elle-même : « les périodes où prédominent thème de l’insécurité dans l’actualité médiatique » font partie, aux côtés des crises économiques, des « deux contextes conjoncturels qui favorisent la croissance du nombre de personnes détenues ».
Est-ce cela le projet ? Enfermer plus d’adolescents dans nos prisons condamnées pour leur indignité structurelle ? Avant d’être des mineurs, il s’agit d’enfants, comme l’a si justement rappelé Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dans une tribune parue dans Le Monde.
Loin d’être une réponse adaptée aux enjeux de la justice des mineurs, cette proposition de loi renforce un système punitif dont l’inefficacité est déjà documentée. L’emprisonnement précoce des mineurs ne fait qu’accentuer leur marginalisation et renforcer les trajectoires délictuelles, au lieu de leur offrir une chance de réinsertion.
La justice des enfants a besoin de moyens et de personnels pour mener à bien leurs missions, les acteurs et actrices du milieu ne cessent de le réclamer. Si action vigoureuse il doit y avoir, c’est au service de la prévention spécialisée et de la protection de l’enfance, délaissées depuis de nombreuses années. Broyer encore davantage des vies en construction ne fera jamais partie de la solution.
Contact presse : Sophie Deschamps – 07 60 49 19 96
[1] Virginie Gautron et Jean-Noël Retière, La justice pénale est-elle discriminatoire ? Une étude empirique des pratiques décisionnelles dans cinq tribunaux correctionnels, 2013.