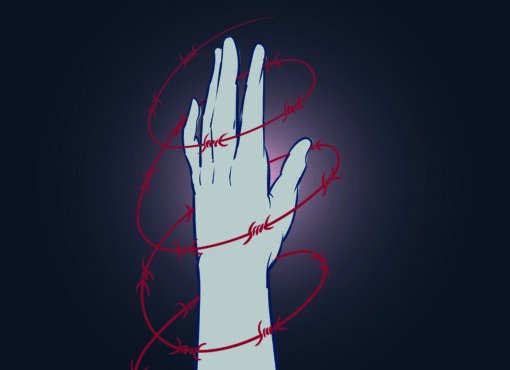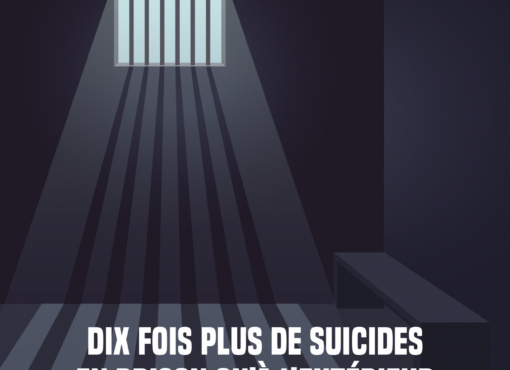20 ans après la loi de 1994, la séparation des missions de soin et de garde des personnes détenues est remise en cause à bas bruits, au nom d'une prétendue modernisation de la prison. Syndicats de médecins et organisations des droits de l'homme s'en inquiètent dans une tribune commune publiée dans Libération le 14 mars 2014.
Les transformations de la prison dans le sens d’une amélioration substantielle de la condition des personnes détenues sont trop rares pour qu’elles soient reconsidérées sans une délibération collective, transparente et argumentée. La loi du 18 janvier 1994 transférant la prise en charge sanitaire des personnes détenues, qui relevait jusqu’alors de l’administration pénitentiaire, au service public hospitalier a sans aucun doute réalisé l’une des plus importantes réformes de l’histoire carcérale de notre pays. Or le principe de séparation des missions de soin et de garde qui en constitue le fondement se trouve remis en cause à bas bruits, au nom d’une prétendue modernisation de la prison.
Depuis quelques années, ministères de la Justice et de la Santé tentent d’imposer aux médecins exerçant en prison de siéger dans des commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) où se discute collectivement, sous l’égide du directeur de la prison, la situation de chacune des personnes incarcérées, du point de vue du comportement, de l’évolution de la personnalité, du risque suicidaire, etc., par exemple pour préparer la décision déterminant le régime de détention qui lui sera appliqué. Le principe de la CPU veut que les personnels soignants partagent avec leurs interlocuteurs pénitentiaires des informations à propos de leurs patients et participent notamment à l’adoption de mesures potentiellement nocives au plan psychique.
Se revendiquant des exigences de protection des personnes et d’individualisation des prises en charge, ce dispositif veut assurer la primauté des impératifs d’ordre et de sécurité dans la prison et, par sa dimension pluridisciplinaire, renforcer la légitimité des mesures prises par le directeur. Ignorant de la relation singulière qui se joue entre le patient et son médecin, il place celui-ci en position de codécideur de l’exécution de la peine de celui-là. En CPU, le médecin est face à une alternative impossible : rester silencieux lorsque sont tenus des propos hostiles à son patient, ou tenter à l’encontre des obligations juridiques liées au secret professionnel, d’expliquer médicalement l’attitude de l’intéressé, au risque alors d’accroître la peur qu’il suscite et de l’exposer à un ostracisme plus grand. De même, le repérage systématique et formalisé des « personnes à risque » suicidaire demandé aux soignants en CPU procède par mises en catégorie, dans des conditions moins respectueuses de la singularité et de l’intérêt des patients que ne l’est une démarche intuitu personae de signalement verbal, effectuée auprès d’un surveillant pénitentiaire de confiance, lorsque les circonstances l’indiquent.
Cette remise en cause du rôle du médecin a été jugée inacceptable par le législateur. Au terme d’un âpre débat centré sur la CPU, la loi pénitentiaire de 2009 est venue préciser que « ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale ». Pourtant, le gouvernement précédent a édicté en 2010 un décret intégrant les soignants à la CPU. En 2012, les ministères de la Justice et de la santé leur ont adressé des instructions (actuellement contestées par l’OIP devant le Conseil d’Etat) pour préciser les conditions d’application de ces textes.
Cette politique oublie les raisons de la réforme de 1994. Le scandale du sang contaminé a rendu visible le fait que les personnes détenues ne constituaient pas un groupe isolé de la population générale, et que les carences de la prise en charge médicale en prison créaient un problème de santé publique affectant la société toute entière. Chargé de penser la réforme, le Haut Comité de santé publique a constaté que, au-delà des insuffisances techniques de ce qu’il était coutume d’appeler la « médecine pénitentiaire », « l’efficacité́ d’une bonne prévention comme d’une bonne prise en charge » se jouait « dans la qualité́ de la relation entre le patient et le médecin », et que, de ce point de vue, seule l’indépendance professionnelle de ce dernier serait à même de faire « disparaître les motifs de suspicion » visant le système en place.
Après vingt ans de mise en œuvre, et alors que son évaluation en 2001 montrait que la réforme était « bien acceptée par les personnels pénitentiaires qui en comprennent les enjeux et en mesurent les conséquences », dont « la grande majorité (…) apprécient cette clarification des rôles », il y a quelque chose d’un peu désespérant à devoir rappeler que, selon le mot d’un ancien président du Conseil de l’Ordre, « il n’y a pas de médecine sans confiance, de confiance sans confidence et de confidence sans secret ». La confusion des rôles suscite de la défiance – du patient vis-à-vis du soignant, de la pénitentiaire vis-à-vis des soignants et inversement – alors qu’une articulation concertée de missions clairement délimitées est saine pour tout le monde.
La loi de 1994 peut certes parfois poser des difficultés dans son application quotidienne. Mais elle présente l’immense mérite d’affirmer, à l’encontre de toute la tradition pénitentiaire, que la prison n’est pas, en matière de soin, un lieu d’exception, même s’il existe des facteurs inhérents au contexte carcéral qui limitent concrètement la possibilité de soins identiques à ceux assurés à l’extérieur, et qui impliquent des sorties sous escorte vers les hôpitaux civils. A l’approche du grand débat parlementaire annoncé sur la place et la fonction de la peine, il est urgent que le Premier ministre énonce clairement s’il entend, dans la continuité de l’action de son prédécesseur, se délier de cette exigence.
Par Antoine LAZARUS, président de l’Observatoire international des prisons – section française (OIP-SF), Hugues de SUREMAIN, avocat et coordinateur du Réseau européen de recherche et d’action en contentieux pénitentiaire (RCP), Michel DAVID, président de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP), Patrick SERRE, Association des Professionnels de Santé Exerçant en Prison (APSEP), Odile VERSCHOOT, présidente de l’Association pour la Recherche et le Traitement des auteurs d’agressions sexuelles (ARTAAS), Jean-Claude PENOCHET, président du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH), Sylvain ROBIN, président du Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (Genepi), Jean-Etienne de LINARES, Délégué général de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Pierre TARTAKOWSKY, président de la Ligue des droits de l’homme (LDH).