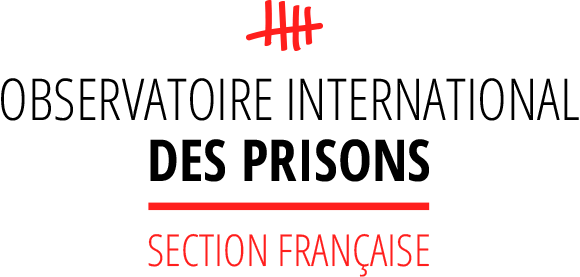En proportion de sa population, la Nouvelle-Calédonie compte 2,5 fois plus de personnes détenues que l’Hexagone. Un constat qui ne cesse d’interroger, mais dont les pistes d’explication sont en elles-mêmes révélatrices, notamment de l’ampleur des inégalités sociales et de la faiblesse des dispositifs d’insertion.
Avec 265 personnes détenues pour 100 000 habitants, le taux d’incarcération en Nouvelle-Calédonie est 2,5 fois supérieur à celui de l’Hexagone[1]. Et ce, sans compter les dizaines de prisonniers transférés ces derniers mois vers la métropole (voir p.37). Un rapport commandé par le ministère de la Justice en 2012 observait déjà cette surincarcération, dont il soulignait l’absence de toute « corrélation avec le taux de criminalité » et de toute autre « explication évidente[2] ». L’écart ne cesse de se creuser depuis lors, malgré la forte croissance de la population carcérale hexagonale. L’ouverture de 120 places de prison supplémentaires à Koné, en 2023, y a certainement contribué (voir p.28). Mais aucune étude approfondie n’a été menée pour identifier précisément les causes structurelles de ce phénomène – qui se retrouve par ailleurs, à des degrés divers, dans d’autres territoires ultramarins[3].
Les services de l’État en Nouvelle-Calédonie, pour leur part, relient souvent la surincarcération à un « taux d’élucidation des affaires particulièrement élevé[4] » dans l’archipel : plus de 60 % en 2023[5]. Une particularité que les professionnels tentent généralement d’expliquer, faute de données objectives, par l’exiguïté du territoire ou la fréquence des aveux complets[6]. La nature des infractions poursuivies n’y est sans doute pas étrangère non plus : d’après le Haut-Commissariat de la République, qui représente l’État en Nouvelle-Calédonie, l’archipel n’est pas affecté par la « délinquance organisée », mais par une « délinquance d’opportunité », « non structurée et toujours fortement liée à l’alcool, voire au cannabis[7] ». « Le territoire est épargné par des phénomènes qui touchent la métropole et certains Outre-mer tels que le grand banditisme, les vols à main armée, le trafic d’êtres humains ou de stupéfiants à grande échelle », précise-t-il.
Des peines particulièrement lourdes ?
Malgré cela, l’ensemble des professionnels interrogés s’accorde à décrire une justice calédonienne particulièrement sévère. « Les peines prononcées sur le territoire sont très élevées », confirme une magistrate qui a fait carrière dans différents ressorts de l’Hexagone et d’Outre-mer. « Pour des infractions liées au cannabis, par exemple, ou des cambriolages, elles sont souvent sans commune mesure avec ce qui se pratique en métropole. »
À quoi tiendrait cette sévérité ? Beaucoup y voient la conséquence « mécanique » d’une récidive décrite comme importante – mais qu’aucun chiffre ne permet de mesurer – et de l’absence d’alternative efficace. Certains y voient le fruit d’un tropisme « répressif », voire « colonial », chez une partie des magistrats qui seraient « distants » de la population qu’ils jugent (voir p.20). D’autre pointent au contraire la sévérité des jurés populaires, bien plus présents dans le système calédonien que dans l’Hexagone, alors que la rhétorique sécuritaire imprègne le débat public. D’autres encore mettent en avant la politique de fermeté préconisée par le parquet.
En amont des peines prononcées, l’ouverture des poursuites par le parquet est d’ailleurs questionnée. « Qu’il y ait un contentieux important lié à la forte prévalence des violences routières et intrafamiliales, on le comprend très bien. Mais à côté de cela, les choix de poursuites engendrent un volume d’incarcérations plus important que les capacités carcérales – et ce, malgré un recours important à la composition pénale et aux alternatives aux poursuites », observe Emmanuel Poinas, délégué général du syndicat CFDT-Magistrats, responsable de la section Pacifique. « Ce n’est pas propre à ce territoire, nous sommes confrontés aux ambiguïtés qui structurent la politique pénale française : l’appareil répressif n’est pas calibré pour appliquer la politique affichée. Celle-ci vise à traiter rapidement des flux importants, sans que l’on se demande si les capacités suivent, ni si c’est pertinent sur la durée, par exemple pour éviter la récidive. »
Plus de peines alternatives, plus de prisonniers
Pour réduire la surincarcération en Nouvelle-Calédonie, la ministre de la Justice Christiane Taubira avait pourtant adopté, en 2013, une circulaire de politique pénale visant à limiter le recours à la détention et à développer les peines alternatives ou aménagées. Dix ans plus tard, ces dernières se sont effectivement multipliées. En 2022, les travaux d’intérêt général (Tig) et les placements sous surveillance électronique se comptaient par centaines, et 351 peines de moins d’un an de prison étaient aménagées dès le procès[8]. Fin 2024, 220 personnes écrouées purgeaient la fin de leur peine de façon aménagée, essentiellement sous bracelet électronique, et 1971 personnes étaient sous main de justice hors écrou[9]. Des chiffres qui ne cessent de croître – à tel point que la Nouvelle-Calédonie ne compte plus seulement 2,5 fois plus de prisonniers par habitant que l’Hexagone, mais aussi 2,5 fois plus de personnes suivies en milieu ouvert : rapporté à la population métropolitaine, leur nombre dépasserait les 475 000. Les peines alternatives se sont donc développées en parallèle des peines de prison, au lieu de s’y substituer.
Les moyens manquent par ailleurs cruellement pour accompagner toutes ces personnes. Avec près de 90 personnes à suivre en moyenne[10], les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (Cpip) sont débordés et les délais de prise en charge, importants. Une étude réalisée pour le ministère de la Justice en 2020 exprimait de grandes réserves quant à la mise en œuvre de Tig en milieu rural, « prononcés tous azimuts » mais décrits comme souvent peu formateurs et peu propices à la réinsertion, en l’absence de suivi individualisé et de coordination entre les acteurs locaux[11]. Si une poignée d’associations encadre également des Tig, une seule, la Rapsa (Réintégration des anciens prisonniers dans une société accueillante), dispose de quinze places à Nouméa pour accueillir des personnes détenues en placement à l’extérieur. Or, au vu de la grande précarité de la population pénale, les contraintes associées à la surveillance électronique ou à la liberté conditionnelle peuvent être difficiles à respecter, avec un risque d’incarcération à la clé. « On manque cruellement de structures d’accueil et d’hébergement », souligne un professionnel travaillant auprès des publics incarcérés. Un déficit particulièrement marqué hors du Grand Nouméa.
Déficit de politiques sociales
Facteur très largement associé à la détention dans l’Hexagone, la précarité touche en effet une part importante de la population calédonienne, sur fond d’inégalités abyssales mises en lumière par l’insurrection de mai 2024[12] : près d’un habitant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, et près de 10 000 personnes occuperaient un habitat informel. Des difficultés encore approfondies par la crise du nickel, notamment dans le Nord, et le choc économique consécutif aux émeutes. Dans ces conditions, difficile pour de nombreux justiciables de présenter les « garanties de représentation » attendues par les juges pour les laisser libres. « Tout le monde n’a pas de boîte postale ou de messagerie électronique, donc le simple fait de convoquer les personnes n’est pas toujours évident », note Emmanuel Poinas.
Le poids du manque de formation et de perspectives socio-économiques sur les parcours délictueux est par ailleurs bien documenté[13]. « La grande majorité des profils de délinquants ici sont à problématique sociale : avec des moyens, on pourrait faire beaucoup de choses », souligne une magistrate, qui regrette que la protection sociale soit « réduite au minimum » dans l’archipel. Les politiques sociales, déléguées aux autorités calédoniennes, sont peu dotées, et les budgets tendent à se réduire – affectant les parcours d’insertion, en amont comme en aval de la prison. « Pour obtenir un logement social, par exemple, il faut un CDI – et encore, en province Nord, il y en a très peu », pointe un professionnel travaillant auprès des personnes détenues. « Faute de prise en charge efficace sur le plan social en sortie de détention, on en arrive à cette récidive très élevée, qui pèse sur le taux d’incarcération », complète une juge.
Le manque de moyens affecte particulièrement la prise en charge des mineurs, elle aussi déléguée aux autorités calédoniennes, y compris sur le plan judiciaire. « On n’a pas de foyer d’accueil d’urgence, pas d’ITEP [institut thérapeutique, éducatif et pédagogique], pas de structures de soins… souffle une professionnelle de la protection de l’enfance. On fait beaucoup de “placements chez des tiers dignes de confiance”, mais les allocations sont régulièrement suspendues. Pour les AEMO [actions éducatives en milieu ouvert], il y a un an et demi d’attente, et l’association qui les met en place n’est plus payée non plus… Donc c’est aberrant, mais la seule mesure dont l’exécution soit assurée d’être immédiate, c’est la détention. Et on sait qu’à la sortie, rien ne sera mis en place. »
« Au vu de la surpopulation carcérale et des conditions de détention au Camp-Est, on essaie de limiter les incarcérations, assure un magistrat. De plus en plus de collègues se rendent compte de l’inutilité d’un passage en prison dans des conditions aussi indignes. Mais parfois, on ne sait plus trop quoi faire… Le sens des peines est vraiment compliqué, ici. »
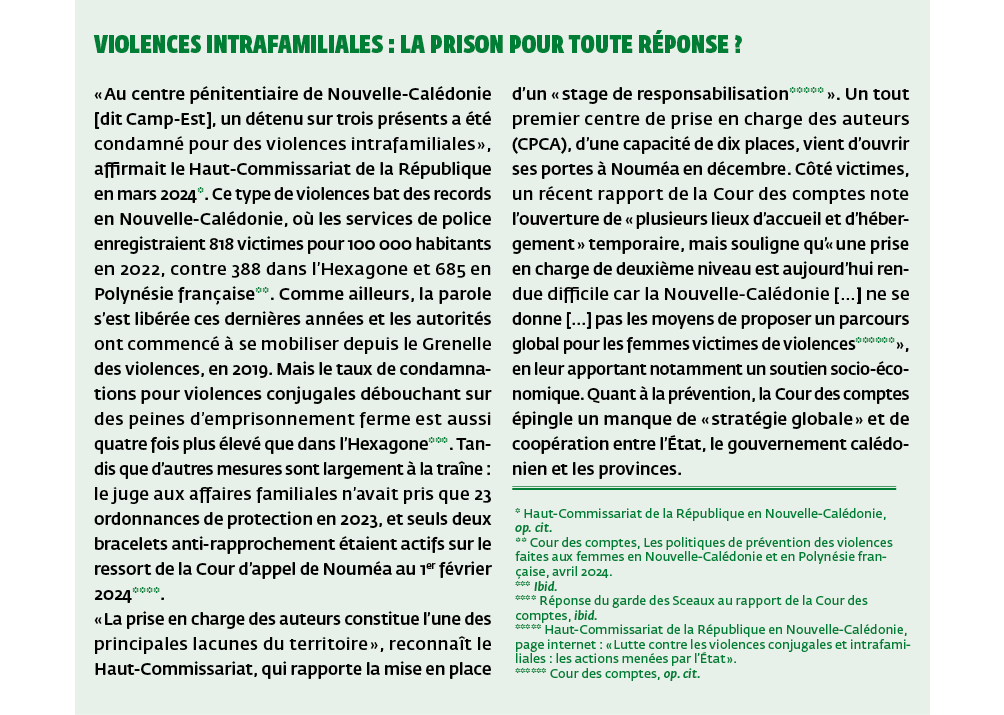
Par Johann Bihr
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°125 – Kanaky – Nouvelle-Calédonie : dans l’ombre de la prison
[1] Taux d’incarcération indiqué par le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas, le 5 mars 2024. En métropole, le taux d’incarcération était alors de 105 pour 100 000.
[2] Mireille Imbert-Quaretta, Rapport sur les difficultés de prise en charge de la population pénale au centre pénitentiaire de Nouméa, novembre 2012.
[3] Au 1er janvier 2024, la Guadeloupe comptait par exemple 245 personnes détenues pour 100 000 habitants ; la Martinique, 293 ; la Guyane, 352 ; la Réunion, 159 ; et Mayotte, 210. (Calculs OIP)
[4] Rapport d’activité 2022 du Spip de Nouvelle-Calédonie.
[5] Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, Délinquance en Nouvelle-Calédonie : bilan 2023 et stratégie 2024, 5 mars 2024.
[6] Tous les professionnels interrogés, et des personnes détenues, se rejoignent sur ce constat. Les hypothèses d’explication avancées tournent généralement autour de facteurs socio-culturels, mais la fréquence des aveux interroge aussi l’accès à la défense, notamment hors du Grand Nouméa. À noter que les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sont très fréquentes en Nouvelle-Calédonie.
[7] Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, op. cit.
[8] Chiffres indiqués par le procureur de la République Yves Dupas, cité par Julien Mazzoni, « Réinsertion : la seconde chance est-elle possible ? », Les Nouvelles calédoniennes, 15 mars 2023.
[9] Source : Direction de l’administration pénitentiaire (chiffres au 1er octobre 2024 pour le milieu ouvert, au 1er décembre 2024 pour les aménagements de peine).
[10] Source : Rapport d’activité 2022 du Spip de Nouvelle-Calédonie. Chiffres au 31 décembre 2022.
[11] Yoram Mouchenik (coord.), Recherche-action sur la pertinence d’une prise en charge spécifique en Outre-mer pour les populations autochtones, septembre 2020.
[12] Les 10% de ménages les plus pauvres ont un niveau de vie huit fois plus modeste que les 10 % les plus aisés, contre un rapport de 3,4 en France métropolitaine. À noter que les prix à la consommation sont 31 % plus élevés que dans l’Hexagone. (Source : Isee, Insee)
[13] Yoram Mouchenik (coord.), op. cit.