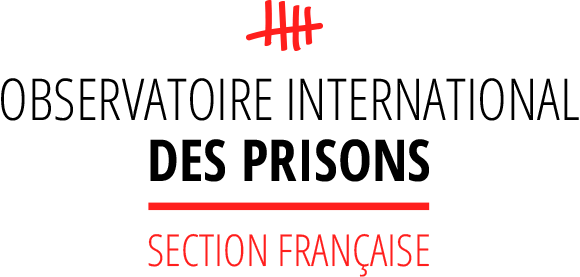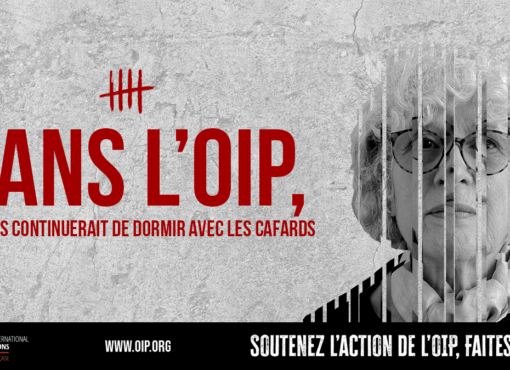Si le Conseil constitutionnel a, à juste titre, censuré plusieurs dispositions de la loi « Attal », l’assaut mené par le Parlement et le Gouvernement contre la justice des enfants témoigne d’une très inquiétante offensive autoritaire décomplexée, aux antipodes d’une politique publique d’accompagnement respectueuse des droits humains et des droits de l’enfant.
« Toujours plus de répression et de prison pour les enfants » aurait pu être le titre de la loi déposée en octobre dernier par Gabriel Attal, portée de manière transpartisane et examinée dans le cadre d’une procédure accélérée engagée par le Gouvernement[1]. Dénoncé par de nombreuses organisations de magistrat·es, d’avocat·es, d’éducateur·ices de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou encore de défense des droits humains, le texte a, un mois après son adoption, été largement retoqué par le Conseil constitutionnel[2], saisi à trois reprises par plus de soixante parlementaires. Et pour cause : il enfreignait, de manière aussi abrupte qu’assumée, le principe même d’une justice spécifique pour les enfants, êtres en construction, pour qui l’éducatif doit prévaloir sur le répressif.
Une large censure constitutionnelle
Motif principal de cette large censure, de multiples atteintes au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineur·es, dégagé par les Sages eux-mêmes il y a plus de vingt ans[3]. Un principe à valeur constitutionnelle dont il résulte notamment, rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin, « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées[4] ».
Résultat : la création d’une procédure de comparution immédiate pour les enfants est inconstitutionnelle. La loi prévoyait que cela soit possible pour les jeunes d’au moins 16 ans qui encourent une peine d’au moins trois ans de prison et ont déjà fait l’objet de certaines mesures[5]. Un usage ni réservé « à des infractions graves ou à des cas exceptionnels », ni subordonné « à la condition que les charges réunies soient suffisantes et que l’affaire soit en l’état d’être jugée »[6], reproche l’institution.
Autre censure : la disposition qui prévoyait de faire du principe d’atténuation de la responsabilité pénale l’exception pour les jeunes d’au moins 16 ans, « du seul fait de l’état de récidive légale » et « pour un grand nombre d’infractions »[7]. Le Conseil souligne que ce principe d’atténuation, qui limite les peines à la moitié de celles qu’encourent les adultes, découle directement du principe constitutionnel d’une justice spécifique pour les enfants. Il rappelle au passage que ce principe peut déjà être écarté pour les jeunes de plus de 16 ans, sur décision spécialement motivée, « à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation[8] ».
Est également jugée inconstitutionnelle l’application de l’audience unique aux enfants de 13 à 16 ans encourant trois ans de prison (ou plus) et aux jeunes de 16 à 18 ans encourant un an (ou plus) – une procédure déjà possible si ces mineur·es risquent, respectivement, cinq et trois ans d’emprisonnement. Il en va de même pour la détention provisoire des enfants de moins de 16 ans que le législateur voulait autoriser jusqu’à un an, contre deux mois dans le droit actuel. Ou encore de la possibilité pour les officiers de police judiciaire (OPJ) de placer en rétention des enfants pour non-respect d’une mesure éducative judiciaire sans « contrôle préalable d’une juridiction spécialisée » ou « procédure appropriée. »[9]
De nouvelles dispositions fortement contestables
Il subsiste malgré tout de ce texte plusieurs dispositions très contestables qui s’inscrivent désormais dans notre droit. Parmi elles, la possibilité pour les juges[10] d’interdire à des enfants d’aller et de venir sur la voie publique sans être accompagné·es d’un·e représentant·e légal·e, pour une durée de six mois, sauf « exercice d’une activité professionnelle », « suivi d’un enseignement ou d’une formation professionnelle » ou « motif impérieux d’ordre médical ou administratif. »[11]
La responsabilisation à outrance des parents a également passé l’examen constitutionnel. Côté civil, leur absence aux convocations du juge des enfants[12] pourra leur valoir une amende. Quant au pénal, la loi durcit le délit déjà existant de soustraction des parents à leurs obligations légales « au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation » de leur enfant, punissable de deux ans de prison[13]. Avec la création d’une circonstance aggravante, la peine encourue est désormais de trois ans lorsque cette soustraction a « directement conduit » à la commission d’infractions[14] par leur enfant. Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne seraient ni équivoques ni insuffisamment précises dès lors qu’elles n’exigeraient pas que les parents aient connaissance des infractions commises, et n’auraient pas pour effet de rendre les parents personnellement responsables des infractions de leurs enfants…
Mais, fondamentalement, « est-ce la façon dont on souhaite accompagner les parents en difficulté […] ? », interrogeaient d’une même voix, en février, la Fédération nationale des associations socio-judiciaires Citoyens & Justice et l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux)[15]. Une question qui fait largement écho à la tribune publiée quelques jours auparavant par la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Dominique Simonnot : parmi les « parents défaillants », « c’est l’état le grand responsable de toute la chaîne des défaillances[16]». Le 1er avril, la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de la protection de l’enfance qualifiait à son tour l’état de « premier parent défaillant de France », et identifiait « le soutien à la parentalité comme un levier majeur de la prévention ».
Banalisation de la répression : les enfants en première ligne
Plus invisible mais tout aussi dramatique : les articles de loi censurés auront participé, par le vacarme démagogique politico-médiatique qui les a accompagnés, à banaliser la diabolisation et la répression des enfants au détriment d’une justice tournée vers leur protection et leur (ré)insertion. Et ce, à dessein, puisque c’est en pleine connaissance de cause que Parlement et Gouvernement ont porté des dispositions inconstitutionnelles – ou qu’ils savaient, à tout le moins, fortement susceptibles de l’être. Le sénateur Francis Szpiner, rapporteur du texte et membre des Républicains alliés à Renaissance dans la coalition gouvernementale, l’avait lui-même souligné. Il s’agissait donc, comme pour d’autres pans répressifs de la politique pénale et pénitentiaire menée depuis le début d’année (voir p.14), de tester jusqu’où le tout-punitif pouvait s’étendre en l’état actuel du droit.
La création d’une procédure de comparution immédiate pour les enfants en est l’illustration la plus éloquente. Comment imaginer que leur appliquer le stéréotype d’une justice bâclée et brutale qui, pour les adultes, conduit à 70 % de peines de prison ferme, puisse répondre à un objectif « éducatif et moral » et respecter l’idée d’une procédure adaptée à leur âge et personnalité ?, La procédure de comparution immédiate est à la fois la plus expéditive que connaisse la justice française – une audience dure en moyenne 29 minutes[17] – et la plus pourvoyeuse d’emprisonnement – la probabilité de condamnation à de la prison ferme est 8,4 fois supérieure à celle d’une audience classique (toutes choses égales par ailleurs)[18]. Sans compter qu’elle vise trois fois plus, chez les adultes, les personnes sans domicile fixe ou nées à l’étranger (à infraction et casier judiciaire équivalents)[19].
Offensive 2.0 : faire des enfants des adultes
Et si certain·es doutaient encore de cet élan répressif insatiable et de la fragilité de notre état de droit face à des gouvernant·es en roue libre, la confirmation n’a pas tardé à retentir. Après avoir refusé d’exercer leur rôle de garant du socle constitutionnel, Gouvernement et Parlement sont dorénavant résolus à saboter tout principe fondamental qui viendrait entraver leur fuite en avant autoritaire. Pendant que le Rassemblement national fustige la censure constitutionnelle, celui qui a donné son nom à la loi « Attal », par ailleurs président du groupe Ensemble pour la République à l’Assemblée nationale, annonçait préparer un nouveau texte qui prenne en compte les contours dessinés par le Conseil constitutionnel[20]. Quant au ministre de la Justice, il s’est dit favorable à l’abaissement à 16 ans de la majorité pénale[21]. Autrement dit : contourner la censure en faisant fictivement des enfants des adultes. Au Sénat, le groupe Les Républicains a déjà déposé une proposition de loi constitutionnelle qui vise à donner compétence au législateur pour déterminer « l’âge de la majorité pénale et les modalités selon lesquelles la réponse pénale peut être adaptée à la situation particulière des mineurs[22] ».
L’absurdité de l’abaissement de la majorité pénale était pourtant soulignée dès février par la présidente du tribunal pour enfants de Bobigny : citant l’interdiction de choisir seul·e son orientation scolaire, de sortir du territoire ou d’accéder à une carte bancaire sans autorisation parentale, Muriel Eglin rappelle que, « dans le droit civil, il est reconnu et de notoriété publique qu’une personne de [16 ans] n’est pas à pleine maturité pour faire des choix pour sa vie. Comment reconnaître alors qu’on a une maturité suffisante en matière pénale ?[23] »Et de conclure qu’aussi infondées soient-elles, les « accusations en laxisme, par une forme de pression sourde, aboutissent petit à petit à une augmentation de la sévérité des juges des enfants ».
Banalisation d’un enfermement aux conséquences désastreuses
Une justice plus sévère et un recours accru à la prison pour les enfants les plus précaires et vulnérables, c’est bien l’objectif des gouvernant·es. « Frapper les plus fragiles, les plus jeunes, les plus marginalisés est devenu un moyen cynique de flatter l’opinion », résume la Conférence des avocats du barreau de Paris dans une tribune publiée en juin[24]. En lieu et place d’une justice « éducative, adaptée, humaine », dénonce-t-elle, « la violence exercée par l’institution judiciaire contre les mineurs […] laisse des traces durables, des cicatrices carcérales en guise de rides fracassant des enfants déjà, pour beaucoup, abîmés par la vie ».
Broyer encore davantage des vies en construction ne pourra jamais constituer une solution digne de ce nom. Au contraire, des besoins humains sont identifiés de longue date. La présidente du tribunal pour enfants de Bobigny notait, en Seine-Saint-Denis, des délais de « un, voire quatre à cinq mois » pour que soit exécutée une mesure éducative judiciaire provisoire ou un contrôle judiciaire avec l’intervention d’un·e éducateur ou éducatrice. « Certaines unités de la Protection judiciaire de la jeunesse ont plus de 45 mesures en attente, sachant qu’un éducateur prend en charge 25 jeunes. […] Il faut qu’on puisse renforcer la qualité et la densité de l’accompagnement humain du jeune délinquant », poursuivait-elle.
L’emprisonnement précoce ne fait, lui, qu’accentuer marginalisation et trajectoires délictuelles. Comment pourrait-il en être autrement ? La réalité de la détention des enfants en France devrait en effet alerter et faire réagir les pouvoirs publics de manière diamétralement opposée : incarcération dans des conditions indignes, atteintes aux droits fondamentaux de citoyens et citoyennes en devenir, ou encore carences structurelles en termes d’accompagnement social, éducatif et plus largement humain. Début mai, l’Observatoire international des prisons – section française (OIP-SF) communiquait ainsi sur l’isolement illégal depuis plus d’un mois d’un adolescent à la prison d’Orvault, privé d’activités et de toute interaction avec d’autres jeunes. En mars, c’étaient les enfants incarcérés à la Valentine, à Marseille, qui avaient été régulièrement privés de cours. La situation alarmante et les conséquences désastreuses sur les enfants, et notamment leur santé mentale et physique[25], ont ainsi conduit l’OIP-SF à mener, jusqu’à la fin de l’année, une enquête de long cours sur le sujet.
par Albane Lefebvre et Prune Missoffe
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°127 – Une société qui s’enferme : la répression comme seul horizon
[1] Loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
[2] Décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.
[3] Décision n°2002-461 DC du 29 août 2002.
[4] Décision du 19 juin 2025, para. 32.
[5] Mesure éducative, mesure judiciaire d’investigation éducative, mesure de sûreté, déclaration de culpabilité ou peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an.
[6] Décision du 19 juin 2025, para. 25.
[7] Ibid, para. 56.
[8] Article L.121-7 du code de la justice pénale des mineurs.
[9] Décision du 19 juin 2025, para. 67 et 68.
[10] Le parquet dans le cadre d’alternatives aux poursuites, ou la juridiction des mineur·es au titre d’une mesure éducative judiciaire.
[11] Loi du 23 juin 2025 (précitée).
[12] Statuant en matière d’assistance éducative.
[13] Article 227-17 du code pénal.
[14] « au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive ».
[15] « La proposition de loi Attal porte gravement atteinte aux droits des enfants », communiqué de presse, 14 février 2025.
[16] « Pour les enfants délaissés, l’Etat est comme un autre parent défaillant », Le Monde, Tribune, 11 février 2025.
[17] Raoult S. et Azoulay W., « Les comparutions immédiates au Tribunal de Grande Instance de Marseille, rapport pour l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux » (ORDCS), n°8, juillet 2016.
[18] Virginie Gautron et Jean-Noël Retière, La justice pénale est-elle discriminatoire ? Une étude empirique des pratiques décisionnelles dans cinq tribunaux correctionnels, 2013.
[19] « Le procès des comparutions immédiates », live Mediapart du 28 juin 2017.
[20] « La loi Attal sur la justice des mineurs en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel », Le Monde, 18 juin 2025.
[21] « Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, se dit favorable à la majorité pénale à 16 ans », FranceInfo, 20 juin 2025.
[22] Proposition de loi constitutionnelle relative à la justice des mineurs, Texte n°766 (2024-2025), 21 juin 2025.
[23] Muriel Eglin, présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, citée dans « Justice des mineurs : « Les comparutions immédiates ne sont pas une procédure adaptée » », Libération, 14 février 2025.
[24] « Ces enfants sont les nôtres », Tribune, Gazette du Palais, n°20, 17 juin 2025.
[25] Alice Simon, Les effets de l’incarcération sur les mineurs, Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse, septembre 2023.