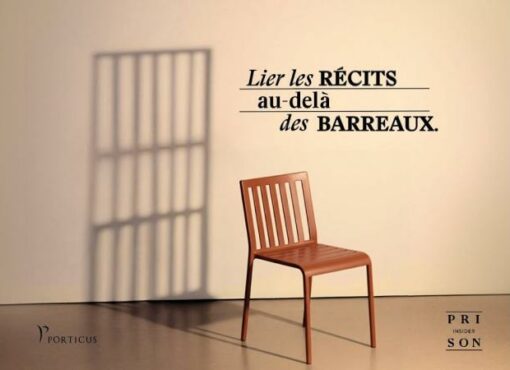En 1985, Pascal est incarcéré pour usage et trafic de stupéfiants. Toxicomane, il a 18 ans et passe deux ans derrière les barreaux, sans être soigné et en continuant à consommer des produits. S’ensuivent quinze ans de toxicomanie et de silence sur son passé carcéral, dont il lui reste des traces dans sa vie quotidienne. Aujourd’hui, il est amoureux, expose ses peintures dans une galerie, a un travail de vendeur… Il dit s’en être sorti grâce au soutien de ses proches
OIP : Pouvez-vous raconter comment vous viviez avant d’avoir affaire à la justice ?
Pascal : Je suis le dernier d’une famille de cinq. Enfant, j’étais assez doué à l’école mais je m’ennuyais, alors je faisais le malin et je me faisais renvoyer de partout. Très vite, je suis devenu ce qu’on appelle un « jeune à problèmes ». J’habitais dans un quartier HLM de Montluçon avec plein de tours. J’avais pris l’habitude de rester dans les halls d’entrée avec mes potes. C’est comme ça que j’ai commencé très jeune à fumer du cannabis, puis à prendre d’autres produits. De 16 à 18 ans, j’ai été apprenti vendeur dans un magasin de disques et de vidéos. J’étais toujours à l’heure, jamais malade ni absent. Mais j’ai continué à prendre des stupéfiants. A Montluçon, c’était la galère pour trouver des produits. Comme j’allais régulièrement à Paris chez une de mes sœurs, j’ai commencé à ramener du cannabis. Je faisais un voyage par mois et je rapportais 100 à 200 grammes à chaque fois.
Comment s’est passée votre rencontre avec la justice ?
Après mon apprentissage, je suis parti vivre à Paris. J’avais 18 ans. Mais des gens que je connaissais à Montluçon ont été arrêtés et m’ont dénoncé. Je suis tombé pour usage et trafic. Cette affaire a pris une grande ampleur à Montluçon. Ils ont fait des calculs : tant de grammes fois tant de voyages sur telle période… On arrivait à des quantités énormes pour une petite ville. Du coup, toute ma famille a été punie pour mes conneries : à cause des titres des journaux, des voisins, des collègues de mon père qui n’ont rien trouvé de mieux que de lui mettre un article sur sa machine outil…
Comment s’est passée votre arrivée en prison ?
Je me suis retrouvé dans la plus petite maison d’arrêt de France. A cette époque, on commençait à parler du sida et les toxicomanes étaient vraiment mal perçus par les détenus, qui peuvent être pires que la justice. J’ai beaucoup entendu « on va attraper le sida », certains pensaient qu’ils pouvaient même être contaminés par une piqûre de moustique. Un peu après, une boule est apparue derrière mon oreille. Il a fallu m’emmener à l’hôpital, où j’ai été opéré menotté. J’aurais dû rester un peu en observation mais ils m’ont ramené directement. Je me souviendrai toujours de la phrase d’un policier de l’escorte aux médecins : « Ne vous inquiétez pas, c’est un dur. » Dans ma tête, je me suis dit : « Je ne suis pas un dur, mais je suis en train de le devenir. »
Pendant que vous étiez en prison, vous avez gardé des contacts avec vos proches ?
Oui, j’ai été bien soutenu. J’avais plusieurs parloirs par semaine. Ma mère venait me voir en alternance avec mes sœurs. Mais j’ai perdu ma petite amie. Elle est venue me rendre visite une fois. Je lui ai dit : « Laisse tomber, je n’ai plus envie que tu viennes, tu ne vas pas m’attendre. » On se flagelle parfois en prison… J’étais en détention provisoire et je ne savais pas combien de temps j’allais rester, ça me faisait flipper. Même les gardiens me disaient : « Tu vas prendre cher. »
Comment se déroulait la vie quotidienne à la maison d’arrêt ?
C’était terrible. Comment peut-on entasser des gens comme ça ? C’est obligé que ça parte en vrille, malgré les cachets, les calmants. La direction me mettait des codétenus un peu perdus, qui n’allaient pas bien. Parce que moi, j’avais des mandats et des visites. Ils essayaient de mélanger les gens qui allaient mal et ceux qui tenaient le coup, mais c’était du bricolage. Et ça me rendait tout plus difficile. A un moment, je partageais la cellule avec un mec qui avait tué une vieille dame de 32 coups de fourchette. Les surveillants savaient ce qu’il avait fait, ils l’ont dit comme toujours à certains détenus, et il s’est fait défoncer. Dès qu’il y avait un entrant, on savait rapidement par les gardiens ce qu’il avait fait, même s’il arrivait le soir à minuit. Et le lendemain, on était tous en promenade à regarder s’il allait venir. De toute façon, à l’intérieur, on a un autre casier. Sans parler du travail des surveillants pour trouver des indics, demander à des détenus des renseignements sur les autres, tout cela crée de la méfiance et des tensions. Il y avait aussi la souffrance des parloirs. Les visites, c’est bien, mais ça chamboule, ça laisse un goût amer. Le parloir, c’est un pleuroir. Quand on ne l’a pas, c’est dramatique, et quand on l’a, on sort en larmes.
Au final, j’ai quand même réussi à vivre la prison le mieux possible. J’avais la chance de recevoir beaucoup de courrier. Le matin, on attend pour voir si on a une lettre, puis on occupe sa journée à répondre. J’ai aussi commencé en prison à travailler le dessin, pour essayer de faire du beau avec tous les trucs horribles que j’avais dans la tête.
Vous avez continué à consommer des produits en prison ?
Oui, bien sûr. A l’époque, les détenus avaient encore droit à une bière midi et soir. On les stockait, puis on les mélangeait avec la fiole de médicaments distribuée chaque jour, et on se défonçait la tronche. La prison ne m’a pas du tout aidé à sortir des problèmes de drogue. J’ai fait une demande pour être envoyé dans un centre de soins fermé. Elle m’a été refusée parce que je n’avais pas voulu collaborer avec la justice, à savoir dénoncer mon fournisseur. C’était un mec chaud, il aurait pu s’en prendre à ma famille, je n’ai pas voulu le balancer. Et donc la semi-liberté, le centre de soins, tout cela m’a été refusé.
Vous avez travaillé en détention ?
Quatre mois avant ma sortie, le directeur est venu me demander de travailler pour faciliter mes réductions de peine. On était trois dans une cellule d’à peine 12 m², où on devait monter des pinces à linge avec des ressorts, en se servant d’une espèce de machine qu’on fixait sur la table. On se bousillait les doigts, et on devait gagner 3 ou 4 francs pour une journée de travail. Ceux qui ne recevaient pas d’argent de l’extérieur faisaient ça jour et nuit, dans leur cellule, avec des sacs de pinces à linge partout. Pour un salaire de misère.
Comment s’est passée votre sortie ?
Ma famille voulait venir me chercher, mais j’ai refusé, j’avais envie d’être seul. Je suis rentré à pieds et là, j’ai pris une claque. Je suis arrivé à un passage clouté, et je ne savais plus comment faire. J’avais peur de traverser. J’ai aussi été malade pendant une semaine parce que je ne supportais plus la bonne nourriture de mes parents, après avoir avalé pendant deux ans des trucs dégueulasses.
Ma famille a tout fait pour que je m’en sorte. Le plus important : ils ont compris que si je restais à Montluçon, j’allais recommencer. Comme de nombreux potes qui sont devenus multirécidivistes… J’avais une sœur à Paris et une autre à Marseille, j’ai eu la chance de pouvoir partir.
Vous avez été suivi après, notamment pour vos problèmes de drogue ?
Pas vraiment. J’avais trois ans de mise à l’épreuve, mais j’avais seulement des rendez-vous avec une assistante sociale, qui m’a pourri la vie ! La drogue, je m’en suis finalement sorti tout seul. Parce que j’ai eu des enfants et qu’à un moment donné, j’ai été fatigué de tout ça. Je suis tombé sur un docteur qui m’a bien soutenu, et sur un produit qui s’appelle le Subutex. Quand je me suis installé à Rouen, il y a une dizaine d’années, j’ai été embauché comme vendeur et j’ai arrêté le Subutex. Depuis, c’est fini.
Ce que je reproche le plus à la prison, c’est l’absence de soins, alors que j’étais incarcéré pour usage et trafic de drogue. Je suis tombé à 18 ans et il m’a fallu quinze ans pour me sortir de la toxicomanie après ma détention.
Qu’est-ce qu’il faudrait faire pour les gens à leur sortie de prison ?
Il faudrait déjà faire des choses pendant la peine de prison. Si le détenu est capable de travailler jour et nuit comme nous le faisions en cellule, il est capable d’être soigné jour et nuit. On a un temps énorme en détention, qui pourrait être utilisé à bon escient pour que la personne s’en sorte. Le problème, c’est que tout le monde s’en fout. Qu’est-ce qu’on fait faire aux détenus ? Promenade, parloir, une douche tous les trois jours, à quoi ça rime ? Il faudrait tout revoir. Faire venir plus d’intervenants extérieurs pour des activités, faire travailler les détenus et les payer au SMIC, qu’ils puissent au moins rembourser les frais de justice et les victimes. Les détenus se sentiraient grandis et les personnes de l’extérieur les verraient différemment.
Autre chose : il faudrait que les médias arrêtent de monter en épingle les cas de récidive. Si on essayait de soigner un toxicomane, il récidiverait moins. On envoie des mecs en prison parce que la population le demande, parce qu’il faut qu’ils payent. Mais on peut bien leur mettre vingt ou trente ans, ils n’auront toujours pas été soignés à leur sortie. Il y a aussi tous ceux qui sortent de prison avec 20 euros sur leur pécule. Ceux-là, je les ai vus entrer, sortir, et revenir pendant mes deux ans de détention. Rien n’avait été fait pour eux non plus.
Qu’est-ce qui vous reste de votre passage en prison ?
La prison fait partie de ma vie, elle m’a rendu plus fort. Mais elle a laissé des traces. J’ai vu des trucs de fou, des scènes terribles en détention. Mon plus gros drame, c’est la mort de sept de mes potes, en prison ou après. Je le vis mal encore. J’ai aussi perdu le sommeil là-bas. Je suis toujours en éveil.
J’ai aussi un gros problème pour aller aux toilettes, il faut en parler. En prison, on n’avait aucune intimité : souvent, je perdais une heure de promenade juste pour être tout seul dans ma cellule et pouvoir aller tranquille aux WC. Ça m’occupait l’esprit tous les jours là-bas. Aujourd’hui, même avec ma copine et mes enfants, j’ai besoin d’une intimité énorme.
J’ai aussi pris l’habitude d’avoir toujours une fenêtre ouverte. Sinon je me sens mal, j’ai l’impression d’étouffer. En prison, je suis resté deux ans avec la fenêtre ouverte parce que tu ne peux pas vivre à trois dans 12 m². Une fois sorti, j’ai longtemps caché mon passage en détention, que ce soit à mes collègues de travail, à la famille de mon amie… En fait, j’ai passé quinze-vingt ans sans rien en dire, à me sentir coupable, à ne pas vouloir faire peur aux gens.
Qu’est-ce qui vous a finalement décidé à en parler ?
Au moment où j’ai arrêté les produits, j’ai commencé à me sentir libéré de moi-même. C’est alors devenu une évidence de parler de tout ça, de dire que mes potes étaient morts en prison… et puis d’y mettre de la couleur et des cœurs, à travers la peinture. Je répète souvent une phrase : « Rendez-moi l’amour que j’avais avant d’aller en prison. » Quand je suis sorti, j’étais devenu violent. Comment sortir autrement de cet endroit, après tant d’humiliations et de frustrations ? Et encore, j’ai eu de la chance, j’ai été soutenu, c’est grâce aux miens que je m’en suis sorti.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Je le vois bien, je suis tranquille : j’ai mon corps, je suis amoureux, j’ai deux enfants. Je ne suis plus avec leur mère mais je ne suis pas le seul auquel ça arrive, on est quand même restés ensemble quatorze ans. J’ai mes potes, ma galerie d’art, mon boulot de vendeur. Je suis respecté à mon travail, parce que je suis quelqu’un d’entier et de sérieux. Enfin, je suis heureux, quoi !
Recueilli par Cécile Marcel et François Bès