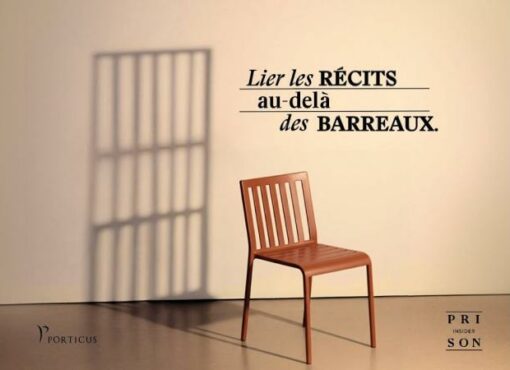Jean, qui a passé plusieurs années en détention, revient sur le délitement des liens. Les sentiments qui ne peuvent plus s’exprimer. La prison qui réduit l’univers et accapare tout, même les rêves.
« Les parloirs, on les a surtout au début, quand on est encore bien vivant au sein de notre famille et dans notre réseau social et amical. Après, le temps passant, c’est plutôt : loin des yeux, loin du cœur. Petit à petit, on reçoit moins de visites. Après des années en maison d’arrêt, tu te retrouves en maison centrale. Les conditions de visite sont bien meilleures. Les plages horaires sont plus larges. Sauf qu’il n’y a plus personne pour te rendre visite. J’ai d’ailleurs toujours trouvé hallucinant qu’en maison d’arrêt, on dispose de moins de temps de parloir qu’en maison centrale. Il y a des logiques qui m’échappent. Quel est l’objectif de tout ça ?
Avec le temps, on a aussi de moins en moins de choses à dire. Notre univers se recroqueville sur l’intra-muros. Le monde extérieur, on s’en fout, on n’a plus aucun contact. Je ne sais plus si c’était au bout de trois, quatre ou cinq ans, mais à un moment, le champ de mes rêves s’est réduit à la prison. Je ne rêvais plus des membres de ma famille, des places de la ville d’où je venais, ni des montagnes de chez moi. C’était les parloirs, l’infirmerie, les couloirs… Les promenades étaient devenues le lieu de mes rêves. Et même lorsque j’y voyais des gens de l’extérieur, c’étaient dans le cadre des parloirs. Pour moi, c’est la pire conséquence de la détention : même les rêves sont pollués par la prison. On dit que c’est le dernier espace de liberté. Mais, non, même pas.
En prison, on est dans un jeu de rôle où le taulard doit être l’homme de métal. Il y a cette idée qu’en face, il ne faut pas leur montrer notre vulnérabilité. Il ne faut pas montrer notre simple humanité. J’ai été acteur de ce mauvais jeu. Par exemple, j’ai perdu mon père quand j’étais en prison. Les premiers jours après l’annonce de son décès, je me rappelle que je ne versais pas une larme en journée. Pas une. J’attendais le soir que la porte se ferme, sachant que les surveillants n’allaient plus rentrer, pour déverser des litres et des litres de larmes. Surtout ne pas montrer de faiblesse, c’est ce qui nous habite. Car on se dit : s’ils voient une faille, ils vont foncer dedans. Alors on se ferme. Étant en plus pudique de nature, j’en suis venu à gommer la vérité des mots, à effacer la profondeur des sentiments, pour qu’ils ne soient pas objet de violation. Petit à petit, j’ai constaté que mes propos étaient devenus fades, les mots utilisés étaient de plus en plus neutres. Ils n’exprimaient plus grand-chose, en tout cas rien de nature à éveiller ou maintenir un sentiment. D’autant qu’en prison les lettres sont lues, les communications sont écoutées. Je pense que si le téléphone en détention était véritablement un lieu d’expression libre, non surveillé, les personnes dedans pourraient avoir la sensation d’être vivantes. Et leur entourage le ressentir.
En prison, j’ai divorcé. Pour moi, c’est évident que c’est une conséquence de l’enfermement, du manque d’intimité. Parce que le lien d’amour se nourrit. Au quotidien. Un peu comme dans l’âtre, quand on apporte des bûches pour maintenir le feu. Si l’on ne peut plus le nourrir, le feu se meurt. En prison, c’est pareil : quand tu ne peux plus alimenter la relation, ne serait-ce qu’avec la force des mots, la personne que tu as en face, celle que tu chéris, ne ressent plus, ne lit plus, n’entend plus tes sentiments. Et forcément, c’est l’amour qui dépérit, qui s’éteint petit à petit. »
Recueilli par Marie Crétenot