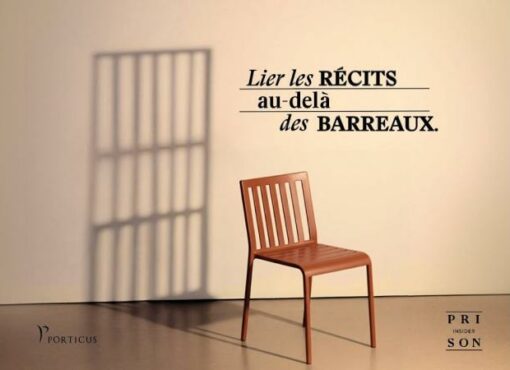Une communauté d’entraide en ligne à destination des femmes ayant un proche en prison : c’est l’idée concrétisée cette année par Leslie Charlemegny, une jeune Montpellieraine. Espace de partage d’expériences et de conseil, la plateforme Femmes de taulards, qui se décline sur les réseaux sociaux en plus d’un site web, entend aussi lutter contre la stigmatisation.
Comment est né le projet « Femmes de taulards » ? Quels sont ses objectifs ?
Dans le cadre d’une mission de service civique que j’ai faite dans l’association Unis-cité de Montpellier : on devait créer un projet social et solidaire, alors j’ai choisi de faire quelque chose qui me ressemblait. J’ai été la compagne de quelqu’un qui a été incarcéré et qui est sorti début 2019. Il est resté à la maison d’arrêt de Carcassonne pendant un an environ. Au départ, je voulais juste faire un recueil de cinq témoignages de femmes de détenus, pour montrer la diversité de ces femmes et leur combat. Finalement, j’ai décidé de faire quelque chose qui serait plus complet et qui durerait dans le temps. J’ai créé le site, le compte Facebook et le compte Instagram fin 2018. Avoir une formation en communication et marketing m’a bien aidée. Au départ, j’ai pensé en faire une association, mais finalement j’ai préféré que ce soit une communauté. Aujourd’hui, « Femmes de taulards » a deux objectifs : parler à ces femmes-là, les soutenir, mais aussi informer l’extérieur de ce qu’est vraiment la prison, le parcours de ces femmes. Parce que je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas beaucoup de choses pour nous.
Comment avez-vous vécu l’incarcération de votre compagnon ?
C’est mitigé. Au départ, c’était assez compliqué parce que je lui rendais visite « en cachette ». C’est quelque chose d’encore très tabou, dont on n’est pas forcément fière. Donc je préférais ne pas en parler lorsque je me rendais à Carcassonne. J’y allais au minimum chaque samedi, parfois trois jours d’affilée. Il m’est arrivé de prendre un hôtel sur place pour aller au parloir du mardi au samedi. Ce n’est pas simple à cacher, l’entourage finit par se douter de quelque chose. En général, les gens sont plutôt inquiets. Ils se disent qu’il faut se méfier de quelqu’un qui est en prison. Ils ne comprennent pas forcément pourquoi on perd son temps pour aller voir quelqu’un qui a fait une bêtise.
Vous avez l’impression d’avoir été stigmatisée ?
Ce n’était pas qu’une impression – à part pour les personnes qui étaient vraiment proches de moi, qui connaissaient mon histoire. Sinon, les gens disaient que j’étais « tombée love d’un voyou », ce genre de choses… Les clichés. Pour eux, soit tu es attirée par les voyous, soit tu te prends pour Bonnie and Clyde ! Il n’y a pas si longtemps, quelqu’un a posté un message sur Instagram, en demandant aux femmes si elles n’avaient pas honte d’aimer quelqu’un qui était incarcéré. C’est ce genre de petites phrases que certaines se prennent tous les jours dans la tête et qui font du mal. Mais au bout d’un moment, ça glisse. Ça touche la première et la deuxième fois, après on s’habitue. On sait qu’il y a des personnes qui ne veulent pas prendre le temps de comprendre, on se dit « tant pis pour elles ». Et on essaye de discuter avec celles qui jugent mais qui sont un peu curieuses. On doit aussi faire face aux clichés sur la prison en elle-même. Les gens aiment bien croire que la prison c’est le club Med, que tout est gratuit. Heureusement, pour mon compagnon, ça s’est plutôt bien passé. C’est quelqu’un qui a un caractère, qui ne s’est pas laissé marcher dessus. Mais il me racontait des choses qui arrivaient à d’autres personnes. Ça ne se passe pas bien pour tout le monde, tout le monde ne vit pas la prison de la même manière.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile à vivre pendant cette période ?
La longueur des trajets et la perte d’argent… Que ce soit en train ou en voiture, c’est cher. C’était minimum huit euros de péage à l’aller et au retour, plus l’essence. Ça fait quand même une somme. Mais il y avait surtout le stress d’arriver en retard, parce qu’après, c’est fini, on ne vous laisse plus rentrer. Une fois, mon train avait du retard. J’ai appelé la prison en panique, et finalement ils m’ont autorisée à aller au parloir suivant. Mais je sais que dans d’autres prisons, comme Béziers par exemple, ça n’aurait pas du tout été possible. Il y avait aussi le problème des parloirs collectifs. Franchement, j’avais l’impression d’aller en étude tous les samedis. Il n’y avait pas d’intimité. Je voyais mon ami dans cette pièce, avec une vingtaine de personnes autour. Un jour, un couple était super content de se retrouver, ils s’embrassaient et on entendait tout, ils s’enlaçaient, c’était un peu gênant pour eux et pour nous. Au point même que le surveillant est intervenu au bout d’un moment pour leur dire de se calmer, qu’il y avait des enfants autour. On n’est pas seuls quoi.
Quels sont les profils des femmes avec qui vous êtes en contact ?
Il n’y a pas vraiment de profil-type. Celles qui visitent Instagram ont entre 20 et 30 ans, et celles qui nous parlent et témoignent ont de 17 à 46 ans. Elles sont étudiante, professeure des écoles, fleuriste… Il y a de tout. Leurs compagnons sont incarcérés partout : à Fleury, en Bretagne, en Occitanie… Certaines veulent directement témoigner, d’autres cherchent des informations ou des conseils. On nous demande comment se passent les parloirs, ce qu’on peut apporter ou non. Beaucoup ont juste besoin de s’exprimer. Il y a par exemple une maman de trois enfants qui est vraiment en galère avec sa famille, avec les démarches pour son mari qui conteste sa condamnation : c’est compliqué de gérer ça toute seule.
Qu’est-ce que vous faites dans ces cas-là ?
Des avocats sont venus vers nous il y a quelque mois, ils sont prêts à aider, à donner des conseils juridiques. On a envoyé par exemple une maman seule vers l’une de ces avocats, parce qu’elle galérait avec les démarches administratives et que c’était trop technique pour nous. On essaye de démarcher d’autres professionnels. Sinon, on essaye de les soutenir, de voir comment elles vont, de donner des conseils, de faire en sorte qu’elles évitent de prendre trop de risques parfois. Parce que la plupart des FDT [femmes de taulard] prennent des risques pour leur mari, leur père, leur fils : par exemple en faisant passer des choses qui sont interdites en prison, des téléphones ou des objets tout bêtes, comme des petites montres… Mais cela peut leur coûter cher, faire sauter le permis de visite ou dans des cas plus extrêmes, aller jusqu’à leur valoir une condamnation pénale.
Comment gérez-vous cette communauté ?
On se fait connaître essentiellement sur les réseaux sociaux pour le moment. Mais on prépare des flyers à envoyer dans les centres pénitentiaires, chez des avocats, des psychologues, tout ce qui touche de près ou de loin le milieu carcéral. Ma meilleure amie me soutient beaucoup, me donne des idées et m’aide pour des tâches administratives. Le site et le compte Instagram, c’est moi qui les gère : c’est beaucoup de travail, je ne compte pas les heures. Il m’arrive parfois de passer des nuits entières dessus. Sinon, c’est au moins dix heures par semaine, parfois tout un week-end.
Est-ce qu’il vous arrive de vous rencontrer, de faire des activités, ou la communauté est-elle avant tout virtuelle ?
Pour le moment, j’ai rencontré quelques femmes après un échange de textos. Mais des ateliers sont en projet. Pour échanger, se retrouver, pour faire des choses qui ne sont pas en rapport avec la prison justement. Pour faire une pause dans tout ça, sans qu’il y ait de jugement. Parce qu’en étant femme de taulard, on vit prison, on respire prison, on rêve prison. Ça peut être de la cuisine, des balades, des pique-niques, des activités qui au premier abord ne semblent pas avoir de but spécifique, mais qui en fin de compte apportent beaucoup.
Est-ce que vous avez été contactées par des hommes de taulardes ?
Non pas encore. Parce que ce n’est pas une légende : les femmes sont beaucoup moins visitées que les hommes, et beaucoup moins longtemps. Une femme va tenir plus longtemps à faire les trajets, toutes ces choses pénibles. Mais on a eu des taulards qui nous ont écrit. L’un d’entre eux nous disait qu’il se rendait compte de l’importance d’une FDT, sachant que lui n’en avait plus. Qu’il soutenait l’initiative.
Il y a quelque chose de contradictoire : il faut réapprendre à faire sa vie seule, mais en même temps toute notre vie s’organise autour de la prison.
Qu’est-ce que ça change dans un quotidien, de soutenir quelqu’un qui est en prison ?
Pour des personnes qui vivaient en couple avec la personne incarcérée, ça peut être des problèmes financiers, parce que les revenus sont divisés. C’est aussi beaucoup de solitude. Il y a quelque chose de contradictoire : il faut réapprendre à faire sa vie seule, mais en même temps toute notre vie s’organise autour de la prison. Et on se coupe un peu du monde extérieur, on s’auto-enferme. Beaucoup de personnes ne s’autorisent pas vraiment à vivre parce qu’elles se sentent coupables de s’amuser quand leur proche est enfermé.
D’après vous, quelles sont les mesures qui pourraient changer le quotidien des femmes de taulards ? Au Royaume-Uni par exemple, une aide financière est proposée aux proches des personnes incarcérées.
Oui, s’il y avait une aide pour les personnes qui habitent loin de la prison dans laquelle est détenu leur proche, ce serait génial. Et puis il y aurait aussi besoin de parloirs plus longs pour celles qui viennent de loin. Plus d’UVF [unités de vie familiales, petits appartements dans lesquels les personnes détenues peuvent recevoir la visite de leur proche sur des durées allant de 6 à 72 heures], ce genre de choses. Mais ça n’existe pas dans toutes les prisons.
Recueilli par Sarah Bosquet