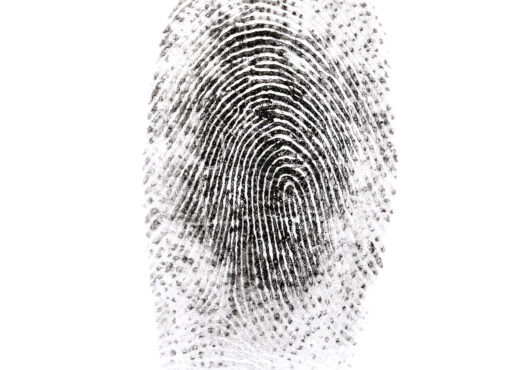Chargés de travailler à un projet de réinsertion avec les détenus, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation sont souvent confrontés, en ce qui concerne les personnes étrangères, à l’irrégularité de leur situation administrative, qui bloque l’accès aux dispositifs sociaux traditionnels. Démunis pour y faire face, ils se voient souvent contraints de recentrer leur action sur un accompagnement a minima, qui consiste à « faciliter » la détention plutôt que préparer à la sortie.
Pour les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP), l’accompagnement des personnes en situation irrégulière est bien souvent une gageure. L’obstacle de la langue est l’une des principales difficultés rencontrées. Si les détenus non francophones bénéficient systématiquement d’un interprète devant le juge, ce mécanisme s’étend rarement aux entretiens menés par les CPIP. Et ce alors même que les personnes étrangères représentent, dans certaines prisons, près de 50 % des personnes suivies. « Nous n’avons pas du tout d’interprètes à Fleury, explique Mathilde, CPIP dans l’établissement. Pendant un temps, ISM interprétariat venait, mais ce n’est plus le cas. Donc c’est la débrouille. » Un système D qui repose bien souvent sur l’assistance de codétenus, plus ou moins bilingues. Ce bricolage s’accorde pourtant mal avec les exigences déontologiques que requièrent les entretiens : « C’est problématique, on ne peut pas aborder les sujets sensibles. Donc on ne creuse pas les choses en profondeur, on ne travaille pas sur les faits commis par exemple », poursuit Mathilde.
Quand bien même les échanges sont possibles, l’irrégularité de la situation administrative de nombre d’étrangers détenus vient alors mettre en échec toutes les démarches et outils habituellement utilisés par les CPIP. « Nous n’avons aucune flèche à notre arc pour préparer la sortie », explique une conseillère. « Tous nos partenaires sont conventionnés, et le fait d’avoir des papiers en règle est obligatoire. Pôle emploi, CAF, partenaires d’insertion, de formation professionnelle, logement, hébergement, associations… Ils ne peuvent rien faire avec des personnes en situation irrégulière », complète un autre. « Franchement, ce sont des situations sur lesquelles on est bloqué, on n’y arrive tout simplement pas », conclut une troisième. Cette préparation à la sortie est rendue d’autant plus compliquée qu’un titre de séjour est le plus souvent exigé pour obtenir un aménagement de peine (lire page 27). Ne reste alors comme solution que de travailler à l’obtention ou au renouvellement de ce précieux sésame. Un parcours du combattant, tant les obstacles matériels et les pratiques des préfectures viennent faire obstacle à ces démarches.
La question incontournable des papiers
Avant même d’envisager une démarche de régularisation, la personne doit disposer de documents d’identité à jour. Or, lorsque ces derniers n’ont pas été perdus ou confisqués, ils peuvent avoir expiré durant le temps de la détention. La première étape est donc d’en solliciter le renouvellement auprès du consulat de son pays d’origine. Or, « très peu de consulats se déplacent en détention, explique une assistante sociale. Dans la région, on n’arrive à faire venir que le consulat du Maroc, et encore ». La personne doit alors solliciter une permission de sortir pour s’y présenter en personne. Or l’octroi de ces permissions est soumis à l’appréciation des juges de l’application des peines et est loin d’être systématique : beaucoup d’entre eux la conditionnent notamment à la présentation d’une convocation officielle du consulat.
Si les papiers sont à jour et qu’une permission de sortir a été accordée, c’est donc à la préfecture que se joue l’étape suivante – étape qui marque bien souvent la fin du parcours. Car une fois la demande déposée, la très grande majorité des détenus se heurte aux pratiques des préfectures qui, par principe, refusent souvent d’examiner les demandes de séjour effectuées en détention. Des pratiques qui, bien qu’illégales, sont rarement contestées par les CPIP. Madame L., détenue en Auvergne-Rhône-Alpes, en a fait les frais. D’origine comorienne, mère d’un enfant français, elle voit son titre de séjour expirer durant sa détention provisoire. Elle sollicite alors son renouvellement en 2016. Quatre ans plus tard, elle reste toujours en attente d’une réponse de la préfecture. Sa date de sortie approchant, elle se décide alors à solliciter l’aide d’un avocat spécialiste en droit des étrangers. « Ma cliente a manqué de conseils !, s’exclame ce dernier. Elle a perdu quatre ans. La préfecture, c’est bien simple : en l’absence de réponse au bout de quatre mois, il y a une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant les tribunaux administratifs. Le problème, c’est que la majorité des CPIP sont très peu formés en droit public. Ils font des courriers, des relances, qui ne marchent pas. Mais ils n’ont pas ce réflexe, typiquement publiciste, de faire naître des décisions implicites pour les attaquer ensuite. Si ce refus avait été attaqué en 2016, cela ferait longtemps que ma cliente aurait eu son titre de séjour, ce qui lui aurait permis de solliciter un aménagement de peine », soupire-t-il.
« Je vous avoue que le droit des étrangers… on n’a pas réellement de formation initiale sur le sujet, et c’est un droit en constante évolution. Nous nous retrouvons très vite démunis », confirme une CPIP. De fait, le module de formation en droit des étrangers, dispensé un temps, a désormais disparu des programmes de l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). Quant à la formation continue, cette dernière est plus que parcellaire et varie selon les établissements. « Nous avions eu une journée de formation dans l’Oise, mais c’était un format très court, trop court pour un domaine complexe qui change régulièrement. Et nous avons très peu de réactualisation sur ce sujet », explique un autre CPIP. « Au vu de la complexité de la matière et de son évolution, même avec une formation de deux jours tous les trois ans, ça ne suffit pas, tranche Julien Dumas, de la CGT insertion-probation. C’est très compliqué de demander des papiers en France, et c’est très compliqué de faire des démarches en détention, alors le mélange des deux… ». « On renvoie les dossiers vers des spécialistes, la Cimade ou les points d’accès au droit », complète Flore Dionioso, du même syndicat. Mais ces derniers ne sont manifestement pas présents dans tous les établissements, ou bien à une fréquence insuffisante. « Ça fait des années que nous demandons des intervenants spécialisés sur le sujet, mais comme nous sommes un peu éloignés de la région parisienne… » regrette une CPIP. L’auto-formation reste alors le seul outil à leur disposition.
Un accompagnement non prioritaire
Démunis, confrontés à des difficultés qui paraissent insurmontables, les CPIP s’épuisent. « Accompagner ces dossiers, cela nous prend énormément de temps. Il faut tout le temps faire des relances, alors quand on suit cent dossiers, ce n’est pas possible. Surtout quand la personne ne peut pas faire la moindre démarche seule : on doit tout faire, même les relances les plus simples, car elle ne maîtrise pas la langue française et ne comprend pas les procédures », détaille Flore Dionioso. Cet investissement, au regard des refus prévisibles de préfectures, dissuade bien souvent les CPIP d’y consacrer davantage de temps. « En six ans, j’ai dû voir ces démarches de renouvellement aboutir deux fois », constate un CPIP. « Forcément, on va mettre plus d’énergie sur des dossiers pour lesquels on sait que l’on peut obtenir des résultats », complète une autre.
À défaut de pouvoir préparer la sortie, solliciter un aménagement de peine ou travailler sur les faits, les CPIP tentent alors d’investir d’autres aspects de la vie en détention. « Nous allons beaucoup travailler sur la prévention des risques suicidaires, par exemple. Sur le maintien des liens avec la famille, sur les moyens de rompre l’isolement, explique l’un d’eux. Ce sont des gens souvent très isolés, sans soutien de leurs proches : on va aussi travailler sur l’accès à l’emploi en détention par exemple. » À l’approche de la sortie, l’accompagnement peut également porter sur la contestation d’éventuelles OQTF (lire page 34), sur le développement de réseaux informels de solidarité, via la famille ou les amis, ou encore sur la mise en lien avec des associations spécialisées telles que la Cimade. En d’autres termes, des perspectives limitées qui tranchent avec les objectifs traditionnels de réinsertion.
par Charline Becker
Un accès au droit en dents de scie
La loi pénitentiaire de 2009 prévoit que « toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d’un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement ». Depuis, des points d’accès au droit (PAD) ont ainsi progressivement fait leur entrée en détention. Financés en tout ou partie par les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD), eux-mêmes placés sous la tutelle du tribunal judiciaire de chaque département, ces dispositifs visent à proposer aux personnes détenues des permanences généralistes sur des sujets variés. Le code de procédure pénale précise toutefois que l’intervention des PAD se limite à toute demande d’information juridique, « à l’exception de celles relatives à l’affaire pénale pour laquelle la personne est incarcérée, à l’exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi » – ce qui n’est pas sans poser de difficultés. Dans les faits, la composition des PAD est très changeante d’un établissement à un autre, et la plupart d’entre eux consiste en une permanence ponctuelle (hebdomadaire, bimensuelle voire mensuelle) effectuée par des avocats ou des intervenants d’associations. Et lorsqu’ils disposent d’une équipe salariée, celle-ci est réduite au minimum et peut difficilement répondre à l’ensemble des sollicitations.
En règle générale, l’activité des PAD est essentiellement centrée autour du droit des étrangers, ces derniers étant davantage exposés à des problèmes juridiques pendant leur incarcération (titres de séjour, procédures d’expulsion, demandes d’asile, etc.). Mais si la majorité des PAD des grandes prisons parisiennes disposent de spécialistes sur ces questions, c’est loin d’être le cas de tous les établissements. Le plus souvent, la fréquence des interventions ne permet en outre pas de suivre des dossiers sur le long terme, ceux-ci nécessitant des rendez-vous réguliers (notamment pour constituer une demande de titre de séjour et réunir les documents nécessaires).
L’action des PAD s’articule parfois avec celle de la Cimade. Intervenant en prison depuis 1946, cette association d’assistance aux étrangers se rend gracieusement en détention afin d’informer les personnes étrangères sur leurs droits et les assister dans leurs démarches quand elles sont possibles. Dans les quelque 70 établissements où elle est présente, l’action de la Cimade est souvent saluée. « Heureusement qu’on a des interlocuteurs comme la Cimade pour nous accompagner » confirme une conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP). « Ils ne viennent pas sur une base régulière, mais c’est notre principal référent », abonde une autre. Pour essentielles qu’elles soient, les missions de la Cimade sont assurées par des bénévoles, en nombre insuffisant. « À Fresnes, nous avons aujourd’hui quatre bénévoles, mais il y a deux ans, il n’y en avait qu’un seul », explique Marc Duranton, responsable des questions prison à la Cimade. Et si certains bénévoles se rendent en détention deux fois par semaine, ailleurs leurs interventions peuvent n’être que mensuelles. — Julien Fischmeister