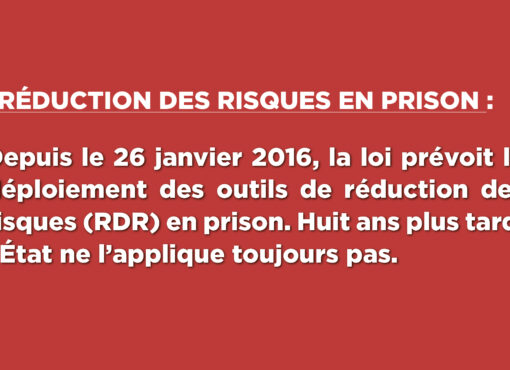À Beauvais, le procureur Jean-Philippe Vicentini a initié un projet inspiré des « drug courts » – forme de justice thérapeutique née en Amérique du nord et développée notamment en Belgique et en Écosse. Un programme innovant en ce qu’il permet d’éviter les poursuites à l’encontre de personnes qui acceptent de s’engager dans un programme axé sur le soin et la réinsertion. Mais avec des limites : plutôt que de se concentrer sur les personnes ancrées dans des parcours délinquants en lien avec leur problématique d’addiction, il cible prioritairement les « simples » usagers de drogues*.
Comment en êtes-vous arrivé à développer ce projet d’accompagnement judiciaire des usagers de drogues ?
Jean-Philippe Vicentini : À Beauvais, dix points de vente d’héroïne génèrent des centaines de milliers d’euros chaque mois, avec une clientèle qui s’étend au-delà de la commune. Et on n’a pas suffisamment d’enquêteurs pour pouvoir mettre un véritable coup d’arrêt au trafic. Alors avec les services de police, on s’est dit qu’on pouvait peut-être essayer d’agir en réduisant la demande. Au niveau du parquet, on avait bonne conscience, parce qu’on donnait une réponse pénale pour chaque usager, mais qualitativement ce n’était pas très brillant. Par exemple, on proposait beaucoup de stages de sensibilisation, pas vraiment efficaces pour les usagers de longue durée : 25 à 30 % de ceux qui participaient aux projets d’alternatives aux poursuites réitéraient dans les trois ans. En 2015, l’École nationale de la magistrature m’a proposé d’intervenir avec [la professeure de droit] Martine Herzog-Evans dans un colloque sur les juridictions thérapeutiques. Pour nous préparer, Mélanie Delsahut, ma substitut, et moi nous sommes rendus à Glasgow en Écosse et à Gand en Belgique pour voir comment fonctionnaient leurs « juridictions- drogues ». Les Belges, dont l’exemple nous a séduits, font des audiences au tribunal avec un procureur et une coordonnatrice. Ils y convoquent des usagers de stupéfiants ou des personnes qui ont commis des infractions en lien avec leur consommation et signent un contrat avec eux pour travailler sur l’ensemble de leurs difficultés. Puis le tribunal se réunit chaque mois pour faire le point, à l’aide d’un rapport écrit par la coordinatrice. On a décidé de reprendre cette idée de « personne de liaison », aide concrète pour encourager les personnes à se réinsérer. Et on a choisi de cibler essentiellement des usagers d’héroïne ou des gens qui avaient commis une infraction pour se procurer des stupéfiants.
Comment fonctionne cette prise en charge, juridiquement et concrètement ?
On a décidé de monter ce projet dans le cadre d’alternatives aux poursuites, en faisant des « classements sous condition », avec l’idée que si cela ne fonctionne pas, on a toujours une deuxième piste : le passage devant juridiction. Dans le parquet, nous sommes deux à être spécialisés sur ce projet. Concrètement, quand on lance une opération contre un trafic, on récupère toujours des dizaines de contacts d’usagers dans les téléphones saisis. On les convoque par petits groupes à des « commissions d’entrées ». Mélanie Delsahut ou moi les recevons avec la coordinatrice et le même jour, une association réalise une enquête sociale rapide pour chaque personne. Lors de cette réunion, on leur explique l’intérêt du classement sous condition et la philosophie du projet : si le contrat est rempli, il n’y a pas de poursuites, pas d’inscription au casier judiciaire, pas de tribunal. Ils ont le choix d’accepter les engagements ou non. S’ils acceptent, on leur fait signer un document. Ils font ensuite un bilan de leurs difficultés avec leur coordonnatrice pour mettre en place un plan de travail, qui ne se limite généralement pas aux soins, beaucoup d’entre eux n’ayant même plus de carte d’identité, donc ni couverture sociale, ni minima sociaux, etc.
Quelle est la plus-value apportée par les compétences de la coordonnatrice ?
C’est l’élément fondamental du dispositif. Elle apporte un soutien au quotidien pour aider les personnes suivies à accéder aux soins s’ils n’en ont pas, à se réinsérer professionnellement. Cette expérience nous a permis de réaliser que si la France a beaucoup de dispositifs pour aider les gens à s’insérer, ils sont compliqués d’accès dans les faits. C’est là où les services judiciaires sont parfois un peu pris de court et où l’action de la coordinatrice est pertinente. Parce que malheureusement, l’administration pénitentiaire n’a pas le temps de faire ces accompagnements. Les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (CPIP) peuvent avoir l’impression qu’on veut leur prendre leur travail, mais ce n’est pas du tout le cas : la coordonnatrice ne fait pas de contrôle judiciaire et dans les alternatives aux poursuites, le CPIP ne peut pas intervenir parce qu’il n’y a pas de condamnation.
Combien de temps dure le suivi ?
Il dure en moyenne six mois à un an. On veut que dans ce délai-là, la personne soit inscrite dans un programme de soins adaptés. Par exemple, beaucoup de personnes sous traitement de substitution ont besoin d’un suivi psychologique – rarement mis en place. Toutes les six semaines, les usagers viennent en « commission de suivi ». Avec le magistrat qui suit le dossier et leur coordinatrice, ils font le point sur les avancées en termes de logement, de documents administratifs, de formation et d’emploi. On leur demande un bilan urinaire ou sanguin – selon leur choix. On leur explique bien qu’on a compris que les analyses ne seront peut-être pas parfaites les premiers temps, mais que ce que l’on veut voir, c’est une évolution. Si le contrat est tenu, on les convoque à une dernière commission pour décider d’un classement sans suite. Si ce n’est pas le cas, les personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel. Une vice-présidente a accepté qu’on en fasse des audiences spéciales. Une réflexion est en cours sur la meilleure peine à prononcer en cas échec de l’alternative. Pour le moment, on y requiert soit des sursis avec mise à l’épreuve (SME), soit des contraintes pénales.
Le projet a-t-il évolué depuis son lancement ?
Quand on a appris que beaucoup d’usagers conduisaient sous l’emprise de drogues, et que certains étaient même chauffeurs, on a inclus dans le dispositif un module de sensibilisation sur les dangers des stupéfiants et de l’alcool au volant. Ils y sont maintenant systématiquement inscrits.
Actuellement, on réfléchit aussi à l’après suivi judiciaire, au moment où le soutien s’arrête… Notamment parce qu’on a eu plusieurs usagers qui ne veulent plus quitter les coordinatrices et qui demandent à rester trois mois de plus dans le dispositif. Il faudrait qu’ils aient le numéro d’une personne ressource qu’ils pourraient appeler en cas de difficulté. Nous avons par ailleurs signé des conventions avec des organismes comme Emmaüs ou le Secours Populaire, pour que nos usagers aient accès à des petits jobs de réinsertion.
Le seul problème que l’on rencontre avec ce projet, c’est que l’on peine à trouver des financements pérennes pour les postes des coordonnatrices. Du côté de l’ARS [agence régionale de santé], on nous explique qu’il n’y a aucun problème pour financer l’injonction thérapeutique, mais que pour tout ce qui est innovation, c’est plus compliqué… Si les élus sont globalement partants pour ce type de projet, ça devient difficile quand il y a moins d’argent public pour les communes… Pourtant, ce dispositif coûte peu : autour de 3,50 euros par personne et par jour – quand un bracelet électronique coûte 15 euros et une place de prison au moins 90 euros par jour.
Avez-vous tiré un premier bilan de l’expérience en termes de sortie de la délinquance ?
Pour le moment, on ne peut pas faire d’évaluation scientifique, parce que ça coûte cher et que l’on se bat déjà pour faire financer le fonctionnement du projet. Mais nous avons constaté que les personnes qui sont restées jusqu’au bout n’ont pas réitérés, c’est-à-dire environ 80 % des participants. Mais les bienfaits ne se mesurent pas qu’en termes de sortie de délinquance. Les personnes suivies nous font des retours très positifs. Elles nous disent par exemple : « Aujourd’hui, mon banquier est content parce qu’il reste de l’argent sur mon compte à la fin du mois. » Ou : « Pour la première fois depuis très longtemps, on va pouvoir emmener notre famille en vacances. » Certains sont presque fiers que des magistrats s’intéressent à eux et qu’en rendez-vous, on se souvienne de ce qu’ils nous avaient dit à celui d’avant. Mais ce dispositif est aussi valorisant pour les professionnels. Humainement, il est intéressant à porter, à faire vivre. On apprend beaucoup et on voit enfin des choses qui ne fonctionnent pas trop mal.
Ce type de suivi peut-il être appliqué à d’autres problématiques que l’addiction ?
Oui. Dans un projet d’accompagnement moins spécialisé qui fonctionne en ce moment à Saint-Quentin, on peut avoir, par exemple, des personnes qui ont été condamnées pour des violences conjugales. On pourrait aussi imaginer un projet adapté pour les délinquants sexuels. Mais chaque problématique est différente, et nécessite donc un contenu ciblé.
D’autres juridictions vous ont-elles emboîté le pas ?
Oui ! En 2016, une quinzaine de programmes du même genre a été répertoriée. De nombreux collègues sont en train de s’emparer de ces projets, mais avec des outils juridiques différents : à Soissons, les personnes en garde à vue sont déférées devant le procureur, puis celui-ci les convoque en audience correctionnelle. En attendant, ils font l’objet d’un contrôle judiciaire et d’un accompagnement renforcé. Le parquet de Bobigny a opté pour des peines de SME et de contrainte pénale. Un projet similaire va se mettre en place à Senlis, un autre à Valenciennes où je suis muté. Compiègne, Arras, Dieppe et Fontainebleau sont aussi en train d’y réfléchir.
Recueilli par Sarah Bosquet
* Voir notamment : « Drogues et prison, décrocher du déni », Dedans-Dehors n°96, juin 2017.