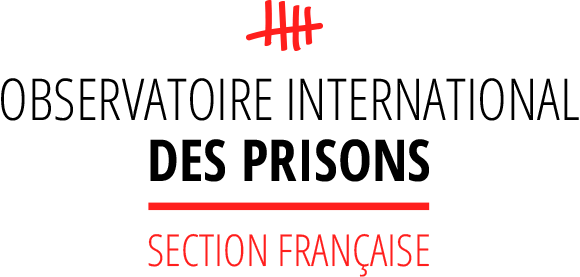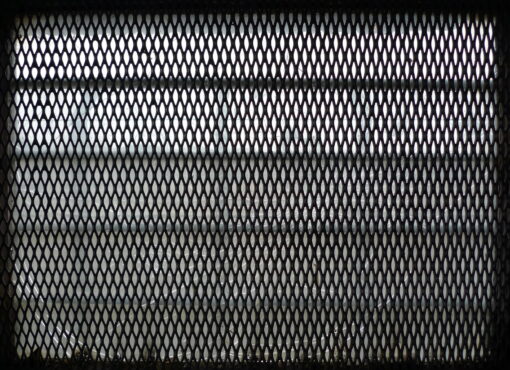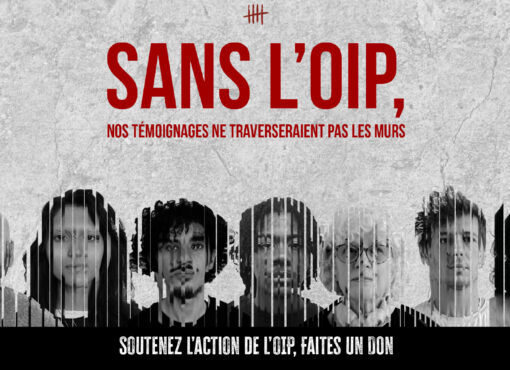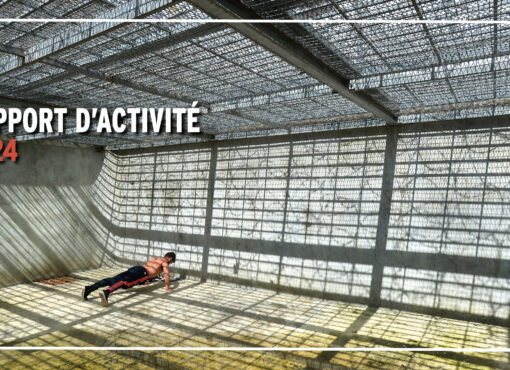Quoi qu’en dise le Conseil constitutionnel, la loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues adoptée début juin anéantit l’effectivité du droit de vote en prison pour les élections municipales, départementales, régionales et législatives. Un droit pourtant fondamental, constitutionnellement protégé et reconnu en droit international. Le détricotage de l’État de droit est en marche.
« On ne peut réinsérer une personne privée de liberté qu’en la traitant comme un citoyen ». Ces mots prononcés en 1999 par le premier président de la Cour de cassation, Guy Canivet, semblent résolument oubliés. Si la très grande majorité des 85 000 citoyens et citoyennes détenues au 1er juillet[1] dispose du droit de vote – seules sont exclus les enfants, les personnes non européennes et celles privées par décision judiciaire de leurs droits civiques[2] –, elles ne pourront désormais (presque) plus l’exercer. Début juin, le Parlement a supprimé la possibilité de voter par correspondance pour les élections municipales, départementales, régionales et législative[3]. Retour au cadre juridique antérieur à 2019, avec deux modalités de vote aussi complexes et peu usitées l’une que l’autre.
La procuration, d’abord, nécessite de trouver un mandataire puis de lui transmettre son choix de vote de manière confidentielle, une illusion dès lors que les courriers peuvent être lus et les communications téléphoniques écoutées. Résultat : 853 votes par procuration ont été recensés lors de l’élection présidentielle de 2017, 412 pour les législatives de 2017 et 110 pour les européennes de 2019[4]. Quant à la permission de sortir, toutes les personnes incarcérées n’y sont pas éligibles[5], à commencer par les 23 000 en détention provisoire au 1er juillet, soit une personne détenue sur quatre. Elle est en outre très rarement accordée. Depuis 2017, le nombre le plus important de permissions de sortir octroyées dans le cadre d’une élection était de 383 lors de la présidentielle de 2022, et tend, depuis, à décroître : aux législatives de 2024, il était de 201[6].
L’instauration de la modalité de vote par correspondance en 2019 avait permis d’augmenter nettement le nombre de personnes détenues votant ces dernières années. C’était d’ailleurs une des rares promesses tenues par Emmanuel Macron en termes d’avancée des droits de personnes détenues : lors du discours donné à Agen en mai 2018, il avait affirmé vouloir « que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ». Pour les élections européennes de mai 2019, 4 395 personnes détenues avaient ainsi participé au scrutin par correspondance. Au total, on décomptait quatre fois plus de personnes votantes que lors de la présidentielle de 2017. Le pourcentage par rapport aux 55 000 personnes incarcérées disposant du droit de vote restait néanmoins minime, de l’ordre de 8%.
A compter du 1er janvier 2021[7], le vote par correspondance est pérennisé et la procédure d’inscription sur les listes électorales simplifiée[8]. Cette dernière est essentielle, car toute démarche administrative est un parcours d’obstacles en prison. Les élections européennes de 2019 avaient révélé que seule la moitié des personnes détenues ayant manifesté le souhait de voter par correspondance était inscrite sur les listes électorales. Et pour les élections régionales et départementales de juin 2021, elles étaient à peine 5 000[9]. Ces réformes ont porté leurs fruits : en 2022 et 2024, entre 18 et 22% des personnes détenues françaises, majeures et non déchues de leurs droits civiques ont voté aux législatives. A celles de 2024, plus de 95% d’entre elles ont utilisé le vote par correspondance[10]. En fin d’année, le gouvernement concluait ainsi à « la pertinence de ce dispositif généralisé en 2022 » et réaffirmait que « favoriser la réinsertion passe aussi par le renforcement de la citoyenneté en prison. »[11]
Ce sont ces récentes avancées, déjà trop timides, que la loi votée en juin vient annihiler. Avec l’autorisation effarante du Conseil constitutionnel[12]. Les objectifs poursuivis par le législateur sont pourtant fallacieux et disproportionnés. L’inscription sur la liste électorale de la commune chef-lieu pour voter par correspondance permettait déjà de réduire drastiquement les risques d’atteinte au « principe de sincérité du scrutin » par la « concentration des votes de ces électeurs dans les communes concernées » dénoncés par le législateur. C’est ce que notait d’ailleurs le rapport du Sénat de 2019, précisant que le nombre de personnes détenues dépassait 5% du corps électoral dans uniquement deux communes chefs-lieux[13].
Quant à l’objectif de sauvegarde d’un « lien de proximité effectif entre ces électeurs et la commune dans laquelle ils sont inscrits », il fait totalement fi d’une autre réalité concomitante : les personnes incarcérées sont directement concernées par les politiques pénales et pénitentiaires votées par les personnes élues – directement ou indirectement – dans le cadre des élections dont elles seront désormais, de fait, exclues. Il ne saurait être trouvé un meilleur exemple que cette loi, votée par l’Assemblée nationale (élections législatives) et le Sénat (dont les membres sont élus par les maires). Sans compter que les personnes détenues restent usagères du service public, par exemple pour les éventuelles extractions médicales dans les structures hospitalières territoriales ou l’accessibilité des transports en commun pour recevoir des visites de ses proches au parloir.
Alors qu’il aurait dû garantir l’effectivité de ce droit fondamental, constitutionnellement protégé et reconnu en droit international, le Conseil constitutionnel a rendu une décision purement théorique en estimant que la possibilité de voter par procuration ou dans le cadre d’une permission de sortir suffisait à assurer l’exercice du droit de vote. Il a par ailleurs décidé qu’il ne lui appartenait pas de rechercher si les objectifs poursuivis par le législateur « auraient pu être atteints par d’autres voies ». Or les atteintes au droit de vote qu’entérine cette loi sont d’autant plus injustifiables au regard des garanties constitutionnelles qui l’entourent qu’aucune solution alternative assurant l’effectivité du droit de vote des personnes détenues n’a été discutée. Deux pistes sérieuses ont pourtant été portées à la connaissance des parlementaires dans le cadre des débats, et ont été temporairement adoptées par la commission des lois de l’Assemblée nationale : l’instauration du principe d’autorisation d’une permission de sortie d’une journée les jours d’élection, ainsi que l’instauration de bureaux de vote en prison.
Ces pistes permettaient en outre de pallier deux problématiques. D’abord, les personnes détenues doivent aujourd’hui exprimer leur choix avant le reste de la population française[14], et avant que ne débute la période de réserve électorale, ces deux jours de trêve médiatique censés « garantir la sincérité du scrutin et éviter toute forme de pressions intempestives sur les électeurs. »[15] Ensuite, le fait que les bulletins de vote des personnes détenues aient été, en 2022, dépouillés à la Chancellerie et que le ministère de la Justice ait décidé de publiciser le résultat des votes des personnes détenues à part – là où, pour le reste de la France, les résultats sont donnés par bureau de vote et donc selon un critère géographique – placent les personnes détenues comme une population à part.
Pour ce qui est de l’instauration de bureaux de vote en prison, elle a, en particulier, été éprouvée au Danemark et en Pologne, suivant le même modèle qu’à l’extérieur : registre électoral, isoloirs, urne, etc. En Pologne, le taux de participation des personnes détenues en capacité de voter était de près de 60% lors des élections législatives de 2011. Est-ce donc cela qui effraie tant les institutions françaises, que l’une des populations les plus précaires et marginalisées puisse remettre en cause leur légitimité aux prochaines élections ?
Par Prune Missoffe
[1] « Au 1er juillet 2025, + 8,3 % de personnes détenues sur un an », Infos rapides justice n°28, juillet 2025.
[2] La privation automatique des droits civiques lors d’une condamnation pénale a été abolie en 1994.
[3] Loi relative au droit de vote par correspondance des personnes détenues.
[4] Etude d’impact du projet de loi relatif à la vie locale et à la proximité de l’action publique, 2019.
[5] Seules les personnes condamnées à une peine de prison inférieure ou égale à cinq ans, ou les personnes condamnées à une peine supérieure mais qui en ont d’ores et déjà effectué la moitié (ou les deux tiers en cas de récidive) peuvent demander une permission de sortir.
[6] Données communiquées par la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap). Elles cumulent les deux tours des élections.
[7] Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
[8] Inscription systématique sur les listes électorales, en laissant aux personnes détenues le choix de la commune de rattachement, avec possibilité de vote par correspondante ouverte dans le chef-lieu du département.
[9] Soit 11% des personnes détenues disposant du droit de vote. Source : « Le vote en prison fait son retour pour les élections régionales et départementales », Ouest France, 16 juin 2021.
[10] Administration pénitentiaire, Projet annuel de performances, Annexe au projet de loi de finances pour 2025.
[11] Ibid.
[12] Décision n° 2025-889 DC du 17 juillet 2025.
[13] 7,85% à Évry-Courcouronnes (maison d’arrêt de Fleury-Mérogis) et 6,5% à Basse-Terre (centre pénitentiaire de Baie Mahault et maison d’arrêt de Basse-Terre). Source : « Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique », Rapport n° 12 (2019-2020), déposé au Sénat le 2 octobre 2019.
[14] Selon la circulaire JUSK2203024C de la direction de l’administration pénitentiaire du 18 février 2022, « les opérations de recueil des votes doivent se tenir dans les établissements pénitentiaires la semaine précédant le scrutin et au plus tard le samedi précédant un scrutin. […] Pour une élection présidentielle Pour le premier tour, les opérations de recueil des votes peuvent se tenir entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin ». En pratique, donc, le vote par correspondance en prison pour l’élection présidentielle peut se tenir jusqu’à plus de 10 jours avant le vote de la population française.
[15] Conseil constitutionnel.