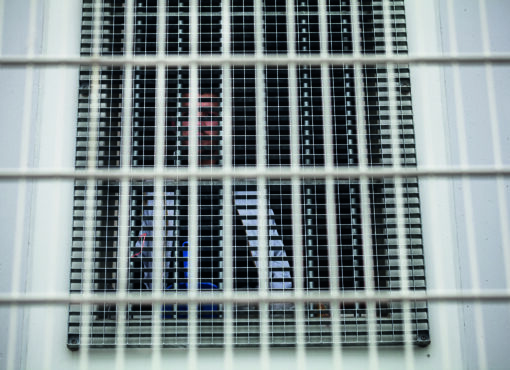Certains projets d’aménagement de peine ou de permissions de sortir peuvent être gelés, plusieurs mois voire plus d’une année durant, dans la seule attente d’une expertise psychiatrique. En cause notamment, une hausse importante du nombre de demandes ces vingt dernières années, couplée à une baisse du nombre d’experts disponibles.
« Une semaine avant l’audience devant le tribunal de l’application des peines, mon client a appris que cette dernière était renvoyée à une date ultérieure car l’experte ne donnait pas signe de vie. Elle s’est manifestée 48h avant l’audience, le vendredi, a fait son expertise en quelques minutes et a produit ses écrits durant le week-end, mais c’était trop tard, le renvoi était déjà prononcé. Mon client était en pleurs. » Cette expérience relatée par Me Juliette Chapelle, avocate au barreau de Paris, n’est pas une exception. Pour les personnes condamnées, l’attente pour obtenir une expertise psychiatrique, que ce soit pour préparer un aménagement de peine ou demander une permission de sortir, se compte en mois, parfois en années, et des audiences sont régulièrement ajournées faute de réponse de l’expert. Au centre de détention de Bapaume, par exemple, un seul expert intervient pour plus de 500 détenus. « Il est tellement sollicité que les expertises mettent jusqu’à un an pour nous revenir. C’est une catastrophe », s’exclame le juge de l’application des peines (Jap) qui intervient dans l’établissement. Même problème à Maubeuge. Si certains territoires, comme le Nord ou les territoires ultra-marins, sont plus durement touchés, l’ensemble des professionnels souligne l’importance de ces délais partout en France. Avec, à la clé, des permissions de sortir refusées, des audiences annulées, des projets professionnels ou de logement qui tombent à l’eau. À l’origine de cette situation et de ces délais, un effet de ciseau : des demandes d’expertises psychiatriques en forte hausse depuis vingt ans, et une diminution, toute aussi constante, du nombre d’experts disponibles.
Une hausse des demandes à des fins criminologiques
Tous les acteurs du système décrivent une augmentation spectaculaire du nombre d’expertises depuis les années 2000, période à partir de laquelle leur objectif comme leur champ d’application se sont étendus. Traditionnellement mobilisés pour déterminer le degré de discernement d’auteurs d’infraction afin d’évaluer leur responsabilité pénale avant leur jugement, les experts investissent, à la suite d’une réforme législative de 1998[1], le champ post-sentenciel avec une nouvelle mission : apprécier le risque de récidive et la dangerosité de certaines catégories de condamnés avant leur remise en liberté. Aujourd’hui, les expertises sont obligatoires pour toutes les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire lorsqu’elles sollicitent un aménagement de peine, et peuvent également l’être lorsqu’une mesure de rétention de sûreté est envisagée à l’issue de la peine. Or, le champ de la peine de suivi socio-judiciaire, initialement applicable seulement aux personnes condamnées pour une infraction à caractère sexuel, a progressivement évolué pour inclure une large palette d’infractions telles que les violences conjugales, les atteintes à la vie, à l’intégrité et à la liberté des personnes ou encore les dégradations de biens par un moyen dangereux – entraînant, dans son sillage, une hausse des expertises. Jusqu’en 2014, celles-ci étaient même obligatoires dès lors que le suivi socio-judiciaire était encouru. Si la loi a depuis circonscrit cette obligation aux seuls cas où il est effectivement prononcé, cela n’a pas pour autant modifié les pratiques. « Notre Jap a gardé les anciens critères, elle demande des expertises même pour les suivis socio-judiciaires encourus », raconte un conseiller d’insertion et de probation.
Outre qu’elle accroît la demande, l’attribution aux experts-psychiatres de cette mission quasi-prédictive du risque de récidive, qui les éloigne de leur cœur de métier, n’est pas sans soulever des questions. « Les attentes de la justice envers la psychiatrie glissent actuellement vers l’exigence d’une catégorisation des individus selon leur dangerosité, qui peut conduire […] à des risques sérieux d’instrumentalisation de notre spécialité », analysaient les auteurs d’un article sur la pratique psychiatrique en milieu pénitentiaire paru en 2012[2].
À l’instar des expertises pré-sentencielles, les magistrats restent en effet libres de demander des expertises en post-sentenciel dès qu’ils l’estiment nécessaire, indépendamment du motif de condamnation. Ils sont ainsi nombreux à en solliciter, même lorsqu’elles ne sont pas obligatoires, pour les personnes atteintes de troubles psychiatriques. « Nous avons de plus en plus de gens avec des pathologies psychiatriques, parfois lourdes, en prison, et nous avons besoin d’avis actualisés sur leur état avant de prononcer un aménagement de peine », explique une magistrate. Opérant au passage un pernicieux amalgame entre dangerosité et troubles psychiatriques, quand bien même les personnes souffrant de tels troubles sont rarement à l’origine des infractions les plus graves[3]. « Il est (…) essentiel de distinguer la dangerosité psychiatrique, manifestation symptomatique liée à l’expression directe de la maladie mentale », de la dangerosité criminologique « liée à de multiples facteurs qui n’ont aucune relation avec une quelconque pathologie », soulignent ainsi les experts[4].
« Ouvrir le parapluie »
L’évolution législative des vingt dernières années ne va cependant pas dans ce sens. « De nombreux textes parlementaires et législatifs récents rapprochent les notions de maladie mentale, troubles de la personnalité, criminalité et “dangerosité”, et participent ainsi à un raidissement généralisé envers l’idée de réhabilitation des personnes atteintes de troubles psychiatriques dans la société », dénoncent ces mêmes experts[5]. « Les nouvelles politiques pénales se développent avec l’idée d’une technicisation de la gestion de la criminalité, associée à une optimisation de notre système par l’implication et la responsabilisation d’une multitude d’acteurs et d’institutions à tous les stades d’intervention, incluant le champ sanitaire », poursuivent les auteurs. Dit autrement : en cas d’échec d’un aménagement de peine, a fortiori s’il est médiatisé, des responsables doivent être trouvés. Conséquence, « certains Jap imposent un passage devant l’expert pour ouvrir le parapluie, dénonce un avocat pénaliste parisien. Il y a eu une telle pression médiatique, avec les années Sarkozy, l’affaire Laëtitia Perrais, Saint-Étienne-du-Rouvray, etc. qu’il y a une réelle inquiétude des magistrats devant ce tribunal de l’opinion publique ». Ce que reconnaissent les premiers concernés. « Le poids de l’opinion publique est très prégnant ces dernières années : il faut désigner des responsables, et en tant que Jap, on est très exposé », témoigne une magistrate. « À chaque fois qu’un fait divers survient, on cherche à désigner des responsables. C’est plus confortable pour nous lorsqu’un expert écrit noir sur blanc que le risque de récidive est maîtrisé », abonde un autre.
Une position que les experts ne sont cependant pas toujours prêts à assumer. « On a des experts qui nous font parfois des expertises totalement incompréhensibles, illisibles. Ils ont cette crainte de voir leur responsabilité engagée, donc on a parfois des formules complètement alambiquées, on a beau relire six fois la phrase, on ne comprend toujours pas ce que l’expert a voulu dire », souffle un Jap. La pression sur les experts peut aussi avoir un autre effet pervers : les conduire à surévaluer la dangerosité, « du fait d’un réflexe inévitable “d’ouverture de parapluie” dû à l’engagement de leur responsabilité face à des enjeux capitaux »[6].
In fine, la demande d’expertises connaît une hausse que rien ne semble endiguer. Ces dernières peuvent parfois se multiplier dans un même dossier : « En post-sentenciel, les expertises doivent être renouvelées tous les deux ans. Par ailleurs, quand la personne demande un relèvement de période de sûreté, une permission de sortir ou un aménagement de peine, un nouvel examen est quasi systématiquement demandé. Parfois, quand elle change d’établissement, le nouveau Jap demande aussi de nouvelles expertises ! » dénonce ainsi un expert-psychiatre. Un passage au centre national d’évaluation, qui rend souvent ses analyses plusieurs mois plus tard, peut aussi parfois venir rendre caduques certaines expertises, imposant leur renouvellement.
Face à cette multiplication tous azimut des demandes, de nombreux experts questionnent « l’utilité de ces sollicitations, non régulées et dans leur majorité jugées nombreuses, redondantes et chronophages », soulignaient les auteurs d’un rapport parlementaire sur la question rendu en 2021[7].
Le nombre d’experts en chute libre
À cette hausse des demandes d’expertises répond une baisse, toute aussi continue, du nombre d’experts-psychiatres : s’ils étaient 800 inscrits auprès des cours d’appel en 2002, ils n’étaient plus que 328 en 2017[8].
« Nous sommes sur une pyramide des âges très défavorable », alerte le Dr Orsat, secrétaire général de la Compagnie nationale des psychiatres-experts près les cours d’appel (CNEPCA). Les experts sont actuellement plutôt des praticiens en fin de carrière, voire déjà à la retraite. Face à ces effectifs vieillissants, la relève se fait attendre. « La psychiatrie médico-légale est l’un des parents pauvres de la psychiatrie, qui elle-même n’appartient pas aux spécialités les plus demandées à l’internat », explique le Dr Layet. Le tout dans une institution sous tension. « L’hôpital psychiatrique est en crise, et les psychiatres ont déjà tellement à faire qu’ils n’ont pas le temps d’aller regarder ce qu’il se passe dans le domaine de la justice. Et même s’ils sont intéressés, les internes et les jeunes confrères n’ont pas forcément le temps de se mettre le pied à l’étrier et de se former », complète le Dr Orsat.
La masse de travail demandée et les échéances parfois urgentes finissent de dissuader de nombreux praticiens. « Vous vous retrouvez pris dans un système qui vous écrase. Il y a des gens qui préfèrent ne pas mettre les doigts dans cet engrenage… », détaille un praticien. Cette pression et le poids des responsabilités que les injonctions à se prononcer sur la dangerosité criminologique leur font endosser contribueraient en partie à assécher le vivier d’experts disponibles.
À cela s’ajoute la question de la rémunération des expertises, jugée largement insuffisante par l’ensemble de la profession[9]. « On ne plaide pas pour que l’exercice devienne une rente : on a conscience que ce ne sera jamais une activité extrêmement lucrative. Mais les niveaux de rémunération et les retards de paiement des expertises sont dissuasifs », développe le Dr Orsat.
L’accessibilité et le fonctionnement rigide des établissements pénitentiaires, enfin, en freine plus d’un. « Il faut prévoir une demi-journée, le temps d’entrer, de sortir, etc. Si on tombe en même temps que les parloirs, il faut laisser rentrer toutes les familles. Le temps des contrôles, on peut parfois attendre 45 minutes. Et puis il faut être bien avec les surveillants, au risque que le détenu qu’on doit voir ne soit pas appelé. Et si on n’a pas fini à l’heure décidée par l’administration pénitentiaire, on nous met dehors manu militari », énumère le Dr Nidal. Les difficultés sont encore accrues par la distance qui sépare de nombreux établissements des pôles urbains. « Quand vous devez perdre une demi-journée pour voir un seul condamné en détention alors que vous pourriez voir trois ou quatre personnes à votre cabinet, il y a parfois la tentation de différer notre intervention en centre pénitentiaire », concède un psychiatre. Pour pallier cela, les magistrats essaient le plus souvent de regrouper leurs expertises sur une journée, ou une demi-journée, pour rentabiliser au mieux les déplacements des praticiens. Une pratique qui peut alors les amener à prioriser la quantité de personnes rencontrées, au détriment parfois de la qualité des expertises rendues.
Par Charline Becker
- Éditorial du N° 117 de Dedans Dehors : Détention provisoire, l’interminable attente
[1] Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.
[2] David Sechter, Jean-Louis Senon et Daniel Sechter. « La dangerosité, problème central dans la confrontation des modèles intégratifs et ségrégatifs des soins entre prison et hôpital », L’information psychiatrique, vol. 88, no. 8, 2012, pp. 631-640.
[3] Entre 2 % et 5 % des auteurs d’homicide et entre 1 % et 4 % des auteurs d’actes de violence sexuelle seulement [sont] atteints de troubles mentaux, J.-L. Senon, Audition au Sénat le 16 janvier 2008.
[4] David Sechter, Jean-Louis Senon et Daniel Sechter, art. cit.
[5] Ibid
[6] Idem
[7] Rapport d’information n° 432 de MM. J. Sol et J.-Y. Roux, fait au nom de la Commission des lois et de la Commission des affaires sociales du Sénat, déposé le 10 mars 2021.
[8] Ibid
[9] De 340 à 573 euros en fonction de la nature de l’infraction et du statut libéral ou non du praticien, selon le rapport du Sénat.