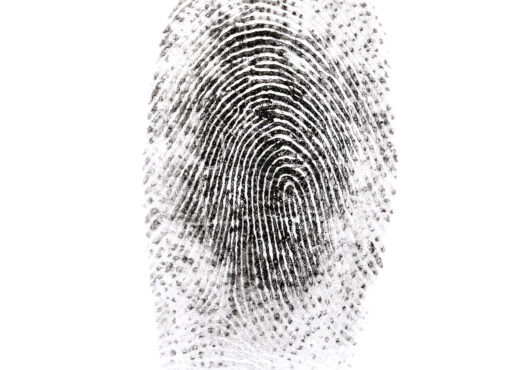Les quartiers « sensibles » sont les premiers pourvoyeurs de détenus dans les maisons d’arrêt des grandes villes. A tel point que pour les jeunes incarcérés, la prison est une « cité avec des barreaux ». Comment l'expliquer ? Quelles sont les conséquences sur le quotidien en prison ? Sur les trajectoires de ces jeunes ? Quelles solutions pour sortir de l'engrenage ?
Ce qui n’était jusqu’alors qu’un secret de polichinelle est désormais confirmé par la recherche : les quartiers « sensibles » peuplent, plus que les autres, les prisons. Les travaux de la géographe et sociologue Lucie Bony en Ile-de-France montrent ainsi que les quartiers prioritaires, ou qui en ont le profil, affichent des taux proches des 150 détenus pour 100 000 habitants, près de 40 points de plus que la moyenne nationale. Une réalité que les premiers intéressés verbalisent sans détour : « En prison, il n’y a que des gens comme nous » disent-ils, ou encore, « la prison, c’est une cité avec des barreaux ». Le sentiment d’un « destin collectif » se dégage nettement des discours des jeunes détenus rencontrés par la chercheuse comme par l’OIP. Illustration de ce phénomène, le sociologue Didier Lapeyronnie constatait, à l’occasion d’une recherche dans un « ghetto » d’une ville moyenne de l’ouest en 2008, qu’« un tiers des hommes du quartier âgés de 18 à 35 ans étaient en prison ou avaient été en prison au cours des deux années précédentes ».

Rien d’inédit à ces résultats, si l’on s’en tient à une lecture « classiste »[1] : au XIXe siècle déjà, 87,5 % des hommes détenus étaient « des pauvres ou des miséreux »[2]. Mais les quartiers prioritaires n’ont pas pour seule caractéristique de concentrer des ménages à bas revenus. Ils accueillent également de fortes proportions d’immigrés, ces deux catégories se recoupant d’ailleurs souvent[3]. Si Lucie Bony s’en est tenue à des indicateurs territoriaux, Didier Fassin a lui étudié le poids de l’origine et de la couleur de peau à l’occasion d’une enquête dans une maison d’arrêt francilienne. En se fondant sur les patronymes et l’apparence physique des détenus sur les photos d’identité consignées dans les registres, il observe que « les hommes noirs et arabes représentent les deux tiers de l’ensemble des détenus et même plus des trois quarts des moins de trente ans »[4]. Si le chercheur a dû bricoler des statistiques « maison », c’est parce qu’elles sont encore interdites en France, sauf dérogation. Les partisans du maintien de cette interdiction la justifient par la crainte, légitime, que de telles statistiques ne réifient des catégories forcément contestables. Autre source d’inquiétude : le risque que les données ainsi produites soient instrumentalisées à des fins de stigmatisation.
Mais refuser la production de données objectives revient aussi à taire cette réalité dérangeante : oui, les maisons d’arrêt renferment essentiellement des hommes, jeunes, issus des quartiers populaires et de l’immigration. Surtout, refuser de l’objectiver, c’est éviter de s’interroger sur ses causes profondes. C’est refuser de s’attaquer aux inégalités socio-économiques à la source du problème. C’est aussi refuser de faire face aux discriminations à l’œuvre dans la chaîne pénale.
« Tous les milieux et classes sociales partagent les mêmes fins, les mêmes objectifs sociaux : consommer, s’affirmer, être reconnu socialement, rappelle le sociologue Marwan Mohammed. Seuls les moyens d’y accéder diffèrent, selon les positions sociales. » Outre les violences, le vol et les trafics[5] sont souvent ce qui conduit ces jeunes derrière les barreaux. Une façon parmi d’autres de « compenser » les inégalités sociales et économiques, décrypte Marwan Mohammed, dans des quartiers où le taux de chômage atteint 26,7 %, où le niveau de pauvreté est trois fois supérieur à la moyenne nationale et où le décrochage scolaire est plus important qu’ailleurs, si bien que 61 % des moins de 30 ans ont un niveau d’étude inférieur au baccalauréat[6]. En outre, « quand on parle de population pénale, on parle de population sélectionnée », précise Marwan Mohammed. Autrement dit, si on enferme ces jeunes plus que d’autres, c’est aussi parce qu’on les cible eux plus que d’autres. « On » ? Les politiques pénales, en sanctionnant plus durement la délinquance de désœuvrement que la délinquance en col blanc par exemple. La Police, qui focalise son activité sur ces quartiers et sur ces jeunes. Et enfin la Justice, qui condamne aussi plus facilement cette jeunesse à de la prison ferme. Mais dans ces maisons d’arrêt surpeuplées, où le temps par jour dévolu aux activités ne dépasse pas l’heure et demi, ils ne font guère que reproduire leur quotidien à l’extérieur, entre « business et galère ». Pire, loin de résoudre le problème, la prison renforce l’exclusion de ces jeunes, qui trouveront encore plus difficilement un emploi à la sortie. En mettant directement en relation des délinquants aux origines et profils variés, l’enfermement « participe de la reproduction de l’espace de la criminalité », souligne en outre Marwan Mohammed. « Plutôt que de penser enfermement ou éloignement, il faudrait travailler à réduire le vivier, en amont des parcours de délinquance », estime le sociologue. On ne peut qu’abonder. Des initiatives existent. Zonzon93, Makadam, 100murs : ces trois associations, parmi d’autres, œuvrent des deux côtés du mur à des actions de prévention et d’accompagnement vers la désistance aussi variées que nécessaires. Et dont les pouvoirs publics feraient bien de s’inspirer.
(1) Qui étudie les discriminations à travers le spectre de la classe sociale.
(2) Jean-Jacques Petit et al., Histoire des galères, bagnes et prisons, Bibliothèque historique Privat, 1991.
(3) L’Observatoire des inégalités établissait en mars 2016 que les immigrés ont un niveau de vie inférieur d’un tiers à celui des non immigrés. Leur taux de pauvreté approche les 40 % contre 14 % en moyenne en France.
(4) Didier Fassin, L’ombre du monde, Seuil, 2014.
(5) Au 1er avril 2012, 23 % des personnes écrouées à la maison d’arrêt de Nanterre l’étaient pour délinquance d’acquisition (ensemble des vols et cambriolages), 21,2 % pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, 16,4 % pour des violences interpersonnelles, 5,2 % pour outrage, rébellion et violences à personnes dépositaires de l’Etat ou encore dégradation de bien publics ou privés et 0,1 % pour délinquance en col blanc. Source : Lucie Bony, « De la prison peut-on voir la ville ? », à partir du fichier national des détenus.
(6) Observatoire national de la politique de la ville – Rapport 2015, Bibliothèque des rapports publics, La Documentation française, mars 2016.