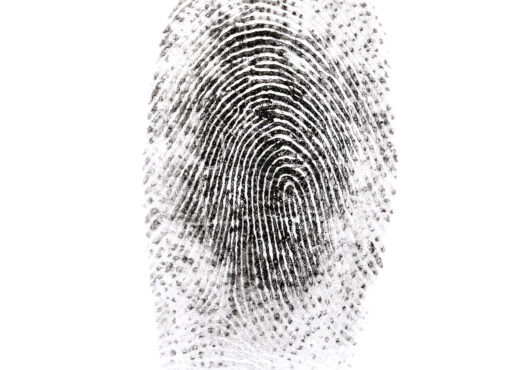En prison, demander ou renouveler un titre de séjour constitue une démarche presque illusoire. Soumises au bon vouloir préfectoral, les personnes étrangères détenues sont le plus souvent maintenues dans une posture d’impuissance, dans l’attente passive d’une fin de peine aux allures incertaines.
Les effets de l’incarcération sur leur droit au séjour constituent bien souvent la préoccupation première des personnes étrangères détenues. Cette détresse est palpable dans les sollicitations adressées aux associations telles la Cimade ou aux points d’accès au droit (PAD). Ces derniers y consacrent d’ailleurs l’essentiel de leur activité : « Le contentieux des étrangers, et notamment les questions relatives aux titres de séjour, constituent près de 75 % des demandes que nous recevons, indique Dalia Frantz, coordinatrice du PAD du centre pénitentiaire de Fresnes. Dans les courriers, on retrouve des personnes complètement démunies face à ce qui leur arrive ». Et de fait, sans titre de séjour, aucune démarche de réinsertion n’est réellement envisageable. La perspective d’un aménagement de peine s’envole aussitôt. En somme, c’est tout un parcours d’exécution de peine qui est vidé de son sens. Avec en bout de ligne, la crainte d’être expulsé à la libération en cas de maintien ou de basculement en situation irrégulière.
Or en pratique, la possibilité de demander ou renouveler un titre de séjour en détention est quasiment réduite à néant. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ces verrous, à commencer par des procédures inadaptées aux spécificités carcérales. En effet, les modalités d’enregistrement des demandes supposent en principe la présentation physique de l’intéressé en préfecture afin de venir déposer son dossier, les envois par correspondance restant systématiquement sans réponse. Pour une personne détenue, cela implique de solliciter préalablement une permission de sortir, lesquelles sont difficilement octroyées sans convocation expresse. Et quand bien même l’autorisation serait accordée, de plus en plus de préfectures exigent une prise de rendez-vous préalable sur Internet. Une démarche qui, déjà complexe à l’extérieur du fait de serveurs surchargés et de créneaux insuffisants, est par définition impossible à entreprendre depuis la détention. Malgré une censure par le Conseil d’État en 2019, qui considérait que cette formalité devait rester facultative(1), rien n’y fait : se présenter en préfecture sans rendez-vous, même muni d’un billet de sortie, c’est la garantie quasi-certaine d’être (illégalement) refoulé à l’entrée.
Une timide circulaire peu appliquée
En 2013, les ministères de la Justice et de l’Intérieur ont tenté de pallier ces difficultés en prévoyant, par voie de circulaire, une procédure uniforme de traitement des demandes formulées par les personnes incarcérées(2). L’objectif était notamment de contourner l’obligation de présentation physique en préfecture, en prévoyant la conclusion à l’échelon local de protocoles alliant les établissements pénitentiaires et la préfecture de leur ressort. Ainsi, la circulaire prévoit la désignation de correspondants pénitentiaires et préfectoraux supposés échanger en vue du traitement des dossiers des étrangers détenus – à l’exception regrettable de ceux placés en détention provisoire. Peu de temps après, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) saluait cette initiative, regrettant toutefois que « toutes les conventions nécessaires ne [soient] pas encore signées »(3). Car pour l’autorité administrative, « aucun étranger ayant droit à un titre de séjour ne devrait perdre sa qualité de personne en situation régulière du fait de la détention ».
Plus de six ans après la publication de cet avis, la situation ne semble guère avoir évolué : « En matière de droit des étrangers détenus, le constat reste aujourd’hui le même », estime Dominique Simonnot, nouvelle Contrôleure générale entrée en fonction en octobre dernier. Sur la base des récentes visites effectuées par l’institution, elle constate qu’« il y a encore des établissements où aucun protocole n’est mis en place, d’autres où il y a un protocole mais pas de référent désigné, d’autres encore où la préfecture refuse de remplir ses missions. Les situations où il est possible, conformément à la circulaire, de réaliser ces démarches par correspondance et dans de bonnes conditions, semblent relever de l’exception. » Faute d’impulsion politique au niveau national, la mise en place et le suivi de ces protocoles dépendent de la bonne volonté des préfets, tout puissants en la matière. Selon la Cimade, cela se limiterait à une vingtaine d’établissements, sans pour autant que les plus importants soient concernés. Fin 2020, les centres pénitentiaires de Fleury-Mérogis, Marseille-Les Baumettes, Paris-La Santé ou encore Nanterre, qui concentrent pourtant les plus fortes proportions de détenus étrangers, ne figuraient par exemple pas parmi les bons élèves.
Enlisement administratif et pratiques illégales
L’autre blocage rencontré de manière récurrente par les personnes étrangères dans leurs démarches de régularisation est relatif à la constitution du dossier et aux nombreuses pièces à fournir, certaines n’étant pas prévues par les textes et constituant dès lors des exigences abusives. Tel est notamment le cas du passeport, systématiquement requis alors que la loi n’impose pour la plupart des situations que la présentation d’un document d’état civil. Or obtenir un passeport en détention implique de nouvelles démarches, très longues et souvent vaines. Le pouvoir discrétionnaire des préfets se manifeste également dans le fait qu’ils peuvent aisément rejeter une demande en considérant que l’intéressé constitue une « menace pour l’ordre public » – critère purement subjectif ne reposant sur aucune définition précise – et accompagner cette décision d’une mesure d’éloignement. Et pour apprécier cette éventuelle menace, ils peuvent exiger des documents sortant de tout cadre règlementaire. « Leur grand jeu c’est de demander les pièces très spécifiques, extraits de casier, comptes rendus d’incidents, synthèses de comportement rédigée par le SPIP, alors que c’est totalement illégal », s’agace Marc Duranton, responsable des questions prison à la Cimade. Mais ne pas se conformer à ces exigences, c’est le risque que le dossier soit au mieux non traité, au pire rejeté.
Sans titre de séjour, aucune démarche de réinsertion n’est réellement envisageable. La perspective d’un aménagement de peine s’envole aussitôt. En somme, c’est tout un parcours d’exécution de peine qui est vidé de son sens.
Une sévérité qui ne doit pas faire oublier qu’en pratique, nombre de préfectures considèrent ne pas être compétentes, voire refusent simplement d’agir sur la situation des personnes détenues. « Il semble que les préfectures de certains départements franciliens (notamment Val-de- Marne et Seine-Saint-Denis) n’acceptent pas d’étudier le renouvellement des titres de séjour des personnes en détention dans l’établissement pénitentiaire du département, explique Guillaume Wickham, juge de l’application des peines au centre pénitentiaire de Fresnes. Je n’ai en tous cas pas connu de cas d’acceptation. Il est vraisemblable que cela réponde à des objectifs de gestion de flux, afin d’éviter de délivrer trop d’accords de renouvellement. Ceci pose néanmoins a minima la question de l’égalité d’accès à l’administration. » Un avis partagé par Dalia Frantz du PAD de Fresnes, et ce alors même qu’un protocole a pourtant été conclu dans cette prison : « La communication est extrêmement laborieuse, les interlocuteurs changent constamment et il est presque impossible de concrétiser les démarches. Il n’y a aucune volonté de traiter les dossiers des personnes détenues », fustige-t-elle. Pour cette juriste, les rares succès ne sont permis que par un acharnement voire des menaces de recours en justice. Soit des leviers impossibles à actionner de manière systématique quand on a à suivre des dizaines de personnes. Cette inertie institutionnelle dénote avec l’énergie déployée dans les procédures d’éloignement du territoire. Au manque de volonté politique de légiférer sur le sujet s’ajoute un désintérêt total des préfets, davantage soucieux de gonfler les statistiques d’expulsion que d’accompagner les efforts déployés par les étrangers détenus pour se mettre en règle. « De ce point de vue, il est beaucoup plus simple de reprocher à une personne de ne pas avoir renouvelé son titre de séjour, quand bien même on n’a rien fait pour l’aider à le renouveler, que de lui permettre de faire valoir ses droits », résume Marc Duranton.
Une société civile indispensable
Néanmoins, ces difficultés matérielles sont loin d’être les seuls freins à l’aboutissement des démarches administratives engagées par les étrangers détenus. Bien souvent, l’incarcération a des conséquences néfastes sur les éléments qui justifient l’octroi ou le renouvellement du titre. Inévitablement, les liens personnels et familiaux se distendent et il devient difficile de justifier du bien-fondé de la demande (participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque celui-ci est français, preuves de vie commune lorsque le titre de séjour est obtenu en raison d’un conjoint français, etc.). Il faut dès lors redoubler d’ingéniosité : relevés de parloirs, bordereaux d’envois d’argent, attestations de proches, etc. Tout doit être mis à profit pour prouver la réalité des attaches de la personne détenue en France, malgré la séparation imposée par l’incarcération. Constituer un dossier est une démarche longue et fastidieuse qui ne peut réellement s’envisager sans l’intervention d’un tiers pour réunir les documents nécessaires, prendre attache avec les administrations, obtenir un soutien financier pour le paiement des droits de timbre particulièrement onéreux, etc. Soit, pour une personne isolée et non accompagnée, une mission presque impossible. Or, les conseillers pénitentiaires sont de fait mal armés pour mener seuls ces procédures, qui dépassent souvent leurs attributions. Aussi, pour affronter ces obstacles de forme mais également pour assurer une passerelle avec l’extérieur, les personnes détenues ne peuvent souvent compter que sur l’acharnement des acteurs de la société civile. Ce soutien se révèle d’autant plus indispensable lorsqu’il s’agit de contester un éventuel refus, qu’il soit explicite ou issu du silence de l’administration pendant plus de quatre mois. « Il arrive qu’il y ait des réussites. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n’est pas le cas dans la majorité des situations que l’on rencontre, prévient Marc Duranton. Ce sont des personnes qui sont sous l’emprise d’un droit extrêmement répressif et forcément, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur. » En effet, les personnes concernées présentent le plus souvent des situations particulièrement fragiles au regard du droit au séjour. Elles sont en outre victimes de la suspicion qui prévaut à l’égard des personnes condamnées. Au total, il est bien rare que leurs demandes aboutissent. Une réalité parfaitement intégrée par les acteurs investis sur le terrain. « Je ne suis pas persuadé que le but du jeu soit de gagner, reconnaît Marc Duranton. Il se situe plus dans le fait que tant qu’on est là, et qu’il y a des associations pour ces personnes, ça montre qu’elles ne sont pas totalement oubliées. » Pas totalement.
Par Julien Fischmeister
(1) CE, 27 nov. 2019, La Cimade et autres, n° 422516.
(2) Circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté.
(3) CGLPL, avis du 9 mai 2014 relatif à la situation des personnes étrangères détenues.