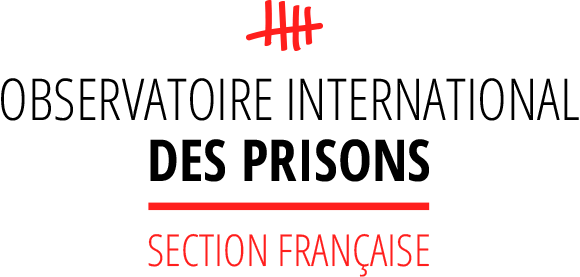La forte surreprésentation des Kanak parmi les personnes détenues en Nouvelle-Calédonie questionne les inégalités sociales autant que les rapports entre l’institution judiciaire et la population. Elle nourrit la défiance à l’égard d’une justice souvent perçue comme « blanche », voire « coloniale ».
C’est un constat choquant : en Nouvelle-Calédonie, la grande majorité des prisonniers sont mélanésiens. Si aucune étude statistique ne permet de le documenter, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip) de Nouméa estime ainsi que « plus de 90% » des personnes détenues au centre pénitentiaire du Camp-Est sont Kanak[1], alors qu’ils ne forment que 41 % de la population[2]. Une surreprésentation aujourd’hui « bien plus marqué[e] qu’il y a une vingtaine d’années », d’après l’ancien directeur du Spip Philippe Pottier[3].
Cette distorsion contribue à raviver une mémoire douloureuse chez une partie de la société calédonienne : celle de la répression coloniale, de la criminalisation des Kanak sous le régime de l’indigénat, ou encore des drames des années 1980 (voir p.16). Parmi les prisonniers du Camp-Est, « le passé colonial […] est présent et ils y font souvent référence. Ils parlent de bagne », témoigne un intervenant en détention[4]. « La justice est souvent vécue très durement dans le monde kanak », observe quant à elle l’avocate Louise Chauchat, du barreau de Nouméa. « Les blessures des années 1980 sont encore ouvertes et nourrissent une défiance importante envers l’institution. »
Inégalités sociales, inégalités ethniques
Comment expliquer cette surreprésentation des Kanak en prison ? Faute de toute étude approfondie sur la question, les professionnels y voient le plus souvent un reflet des profondes inégalités sociales qui affectent la Nouvelle-Calédonie, au détriment des Kanak. Car dans cette société aux structures encore fortement marquées par la colonisation, « les inégalités économiques et sociales se confondent avec les inégalités ethniques. Pour faire simple, les statistiques nous apprennent que les populations favorisées sont européennes et les plus défavorisées kanak », résume l’économiste Samuel Gorohouna[5]. Malgré les efforts de « rééquilibrage » entrepris depuis l’accord de Nouméa[6], le niveau de vie médian des ménages kanak est ainsi deux fois plus faible que celui du reste de la population. Leur taux de chômage approche le double et leur taux de pauvreté, le triple[7]. Les Kanak sont en moyenne nettement moins diplômés et occupent largement les emplois les moins rémunérés. En outre, « à situation égale, un Kanak gagne en moyenne 32% de moins qu’un non-Kanak », souligne un rapport pour le ministère de la Justice[8]. Ces disparités sont encore exacerbées à Nouméa, où une étude de 2016 a mis en évidence d’importantes discriminations dans l’accès au logement[9] et où « les 10% de ménages les plus pauvres (Kanak, Wallisiens et Futuniens) gagnent 13 fois moins que les 10% des ménages les plus riches (Européens)[10]».
La population autochtone serait donc affectée de façon disproportionnée par les mécanismes qui font de la prison « le dernier maillon d’une chaîne d’exclusions[11] » – une spirale bien documentée dans l’Hexagone, qu’Emmaüs France et le Secours catholique résument en ces termes : « Les personnes pauvres sont surreprésentées [derrière les barreaux], souffrent d’une aggravation de leur situation en détention, et se retrouvent le plus souvent à l’extérieur sans avoir pu préparer correctement leur sortie[12]. » Du fait de leur plus grande précarité, « les Kanak ont souvent beaucoup moins de garanties de représentation[13] et beaucoup moins de ressources pour se défendre », ajoute un magistrat.
Les milieux indépendantistes, pour leur part, ajoutent à ce constat le soupçon d’un traitement différencié : « Le sentiment qu’on a, c’est que la justice n’est jamais la même quand c’est un Kanak ou un autre qui est jugé », déclare Brenda Wanabo, l’une des responsables de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), placée sous contrôle judiciaire dans l’Hexagone dans le cadre de l’enquête sur l’insurrection de mai 2024. Cette perception se nourrit de précédents historiques, de l’acquittement des assassins de Waan Yaat en 1984 (Lire : une terre de très grande punition) à « l’affaire Konhu », un procès d’assises qui s’est soldé par l’acquittement de « coupables trop “colonialement beaux” pour être vrais[14] », dans les années 2000. Le sentiment d’un « deux poids deux mesures » dans la réponse aux événements de mai 2024 (voir encadré page précédente) n’a fait qu’aviver cette suspicion – vigoureusement rejetée par les magistrats : « J’applique la loi exactement de la même façon ici qu’en métropole, martèle l’un d’eux. Avec un budget de 15 euros par contribuable, bien sûr que le système judiciaire français peut être dysfonctionnel et insatisfaisant, ici comme ailleurs. Mais les gens ne sont pas plus mal jugés en Nouvelle-Calédonie. »
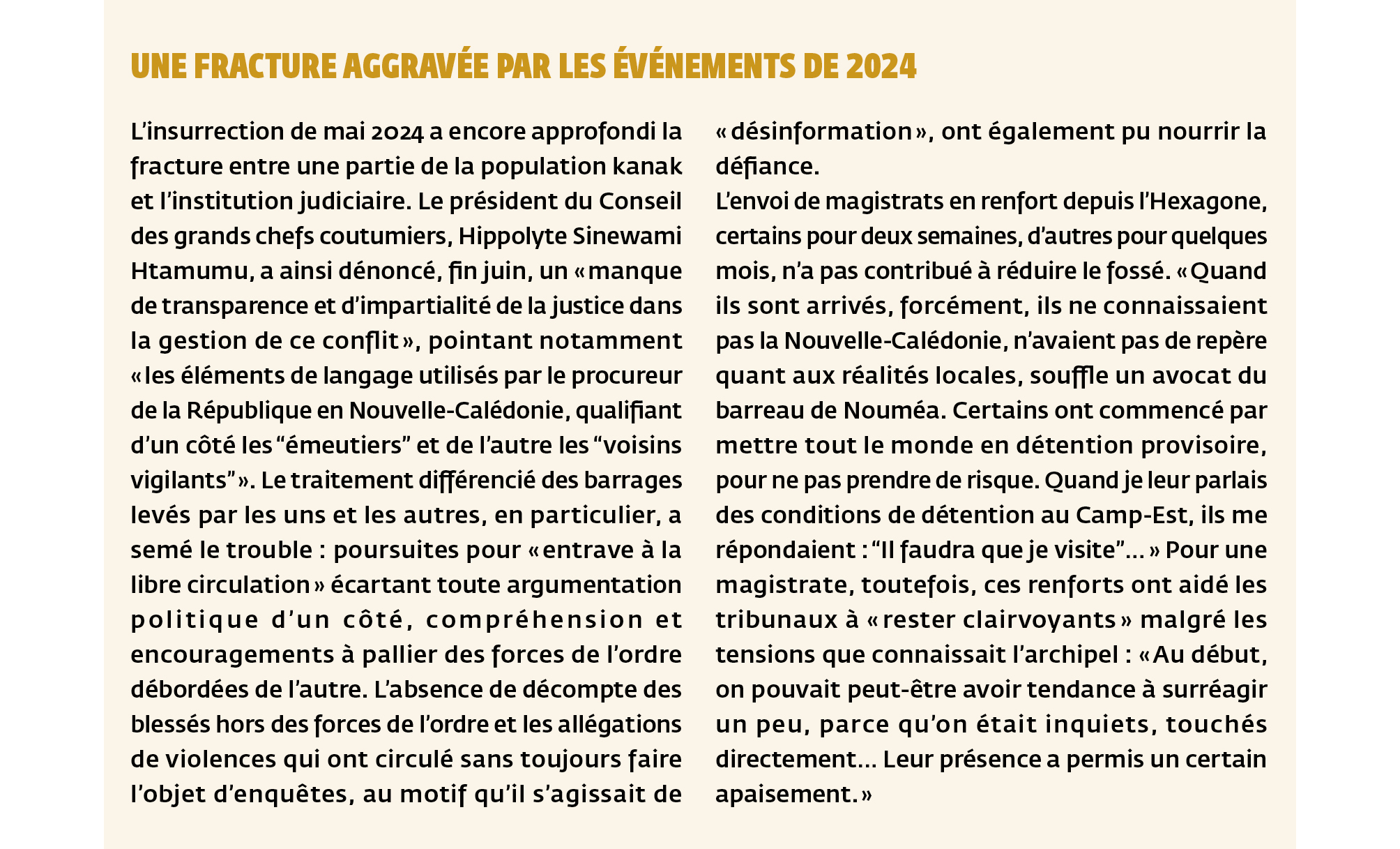
Des apparences désastreuses
La défiance s’enracine aussi dans le déséquilibre démographique qui se retrouve non seulement en prison, mais aussi en amont : « Force est de constater qu’aux audiences, la population jugée est toujours la même, observe l’avocate Sophie Devrainne. Ce qui contribue à nourrir, de façon latente, un système de représentation assez manichéen au sein de la société. » Car les juges, quant à eux, sont le plus souvent originaires de l’Hexagone et de passage sur le Caillou. Une seule magistrate d’origine kanak exerce – à titre temporaire – en Nouvelle-Calédonie. Le barreau de Nouméa, quant à lui, ne compte que deux avocats kanak.
C’est largement pour tenter de combler ce déficit de représentation, et rapprocher l’institution judiciaire de la population, que les formations collégiales des tribunaux correctionnels calédoniens incluent deux assesseurs citoyens aux côtés de trois juges professionnels. Estimant « impossible d’ignorer [la surreprésentation des Kanak en prison] dans la détermination des modalités de la “réponse pénale” », une mission diligentée par le ministère de la Justice en 2012 appelait d’ailleurs à « renforcer la participation d’assesseurs mélanésiens[15]». De la même manière, la Nouvelle-Calédonie a fait le choix de conserver des cours d’assises composées de jurés populaires : la réforme qui a instauré les cours criminelles départementales dans l’Hexagone ne s’y applique pas. Et dans les affaires de droit civil relevant du statut coutumier, des « assesseurs coutumiers » statuent aux côtés d’un magistrat professionnel.
Pas de quoi cependant altérer la perception d’une « justice coloniale » au sein d’une partie de la population, largement exprimée dans les slogans des grandes manifestations indépendantistes qui ont précédé les émeutes de mai 2024. « En pratique je pense qu’on en est très loin, mais je comprends ce ressenti : l’absence de juge ou d’avocat kanak, due à la faiblesse de l’ascenseur social, renvoie forcément cette image-là », concède une magistrate arrivée de l’Hexagone il y a quelques années. « Attention aux effets de fausse perspective, nuance l’un de ses collègues. La Nouvelle-Calédonie, c’est la population de l’Ardèche : avec un effectif aussi réduit, on peut difficilement imaginer produire localement quinze ou vingt magistrats de carrière par génération. Mais il faudrait effectivement qu’on puisse susciter davantage de vocations. Et que les personnes formées aient envie de rester : beaucoup de greffiers kanak partent en métropole, où une magistrate kanak exerce aussi. »
De la distance à la défiance
En attendant, cette configuration particulière affecte-t-elle la façon dont la justice pénale est rendue ? Pour l’avocate Louise Chauchat, « la justice française juge une population qu’elle connaît très mal. On entend souvent des noms écorchés… Comprendre cette société, s’y connecter, met du temps quand on arrive de métropole. Ce sont deux mondes différents qui se côtoient au tribunal, les codes sociaux ne sont pas les mêmes, or les audiences vont très vite. » Un contexte propice aux accusations en « paternalisme » ou en « dureté à l’égard des modes de vie locaux », qui affleurent souvent à l’encontre d’une partie de l’appareil judiciaire. « On essaie de faire attention aux représentations, proteste un magistrat. Et l’essentiel chez un juge n’est pas qu’il vous ressemble, mais qu’il ait une compétence technique et soit raisonnablement à votre écoute. » Le manque de données objectivées ne fait qu’attiser la controverse. « Pour comprendre ce qui se joue à l’audience, il faudrait pouvoir étudier sérieusement la situation qui se noue autour de l’interaction des prévenus, des juges et des avocats », estime l’anthropologue Christine Salomon.
Toujours est-il qu’entre distance sociale, asymétrie linguistique et malentendus culturels, certaines audiences sont décrites comme parsemées d’incompréhensions. « J’ai suivi un procès lors duquel le prévenu se tenait tête baissée, dans une attitude de respect envers l’autorité, mais le magistrat, pourtant sur place depuis longtemps, le prenait mal et ne cessait de lui dire : “Regardez-moi quand je vous parle !” », se souvient par exemple Christine Salomon. Vu du banc des accusés, souvent, « la justice ça reste quelque chose de blanc. […] Il y a des choses qu’on ne comprend pas, il y a des choses qu’on n’accepte pas », explique l’intervenant en détention au Camp-Est, en évoquant le fonctionnement et les rituels d’un procès[16].
C’est parfois la légitimité même de l’institution judiciaire que contestent les prévenus – par révolte contre l’ordre post-colonial, ou parce que « les interprétations kanak d’un certain nombre d’infractions constitutives d’une délinquance du quotidien, masculine et jeune, renvoient à une autre histoire et d’autres rapports sociaux que ceux qui président à la formation des magistrats et des divers agents de la chaîne pénale », souligne une étude menée pour le ministère de la Justice[17]. La dureté des sanctions prises contre ce qu’une partie de la société considérerait comme des « bêtises de jeunesse », en particulier, susciterait « énormément d’incompréhensions concernant la légitimité et le sens des peines prononcées, voire même une défiance généralisée vis-à-vis de l’institution judiciaire et de ses agents. […] A fortiori quand [ceux-ci] se montrent non seulement ignorants de l’histoire et des réalités du pays, mais aussi parfois méprisants. Une situation qui n’est d’ailleurs pas propre à la Nouvelle-Calédonie, les justiciables les plus marginalisés socialement en France se plaignant aussi de discriminations. »
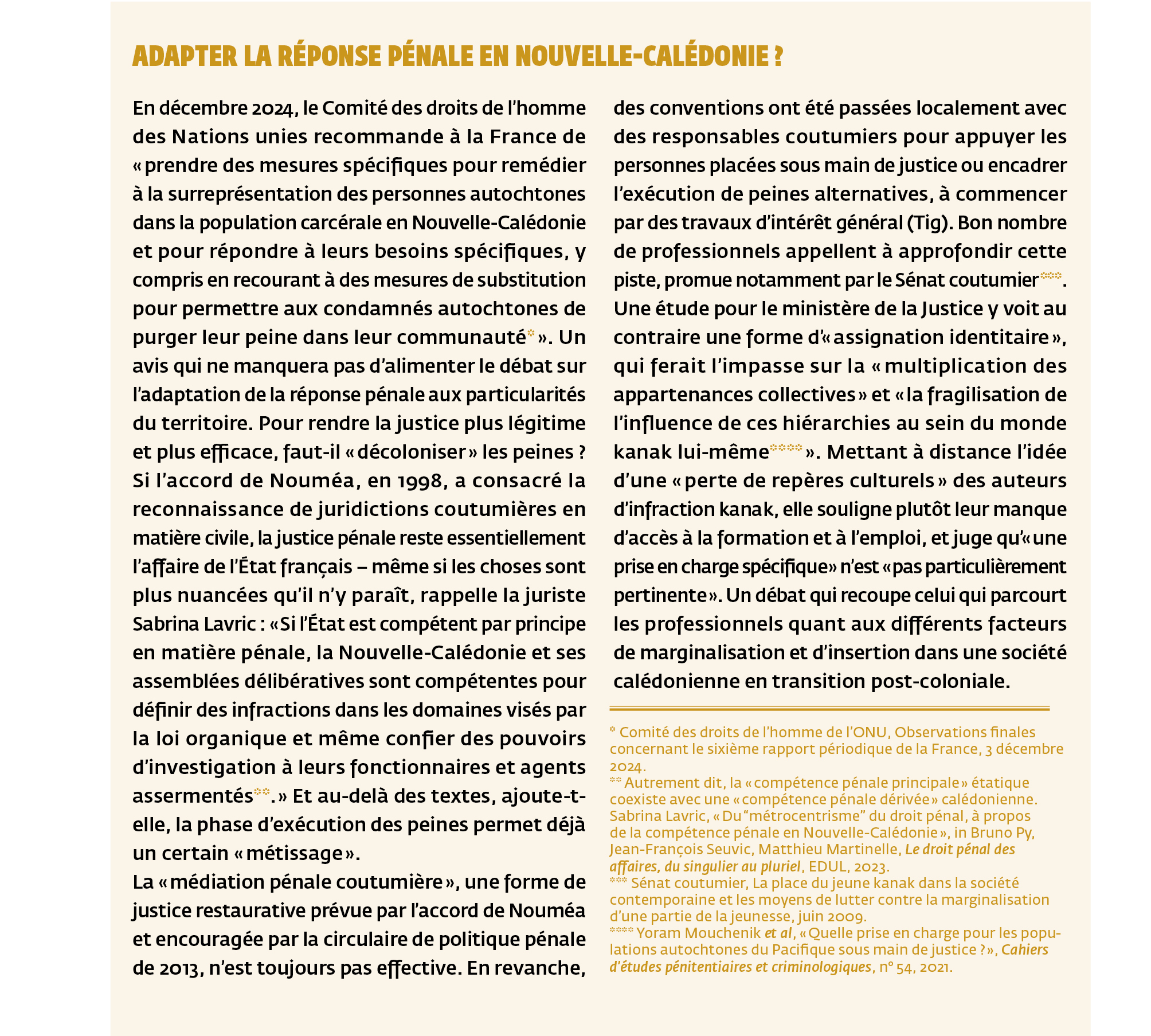
par Johann Bihr
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°125 – Kanaky – Nouvelle-Calédonie : dans l’ombre de la prison
[1] Entretien du directeur du Spip Lionel Lecomte avec Coralie Cochin, France TV-la 1ère, 26 août 2022.
[2] Source : Insee, recensement 2019.
[3] Philippe Pottier, « Le sens de la peine vu des antipodes », AJ Pénal, février 2019.
[4] Cité dans Yoram Mouchenik (coord.), Recherche-action sur la pertinence d’une prise en charge spécifique en Outre-mer pour les populations autochtones, septembre 2020.
[5] Entretien avec Antoine Perraud, « En Nouvelle-Calédonie, la réduction des inégalités stagne depuis 2009 », Mediapart, 26 mai 2024.
[6] Signé en 1998, il instaure de nombreux transferts de compétences de l’État français à la Nouvelle-Calédonie et organise une série de référendums sur l’indépendance de l’archipel.
[7] Céline Mouzon, « 10 graphiques pour comprendre la crise en Nouvelle-Calédonie », Alternatives économiques, 29 mai 2024.
[8] Yoram Mouchenik (coord.), op. cit.
[9] Mathieu Bunel, Samuel Gorohouna et alii, Discriminations ethniques dans l’accès au logement : une expérience en Nouvelle-Calédonie, TEPP n° 2016-08, 2016.
[10] Yoram Mouchenik (coord.), op. cit.
[11] Emmaüs France-Secours catholique, Au dernier barreau de l’échelle sociale : la prison, octobre 2021.
[12] Ibid.
[13] C’est-à-dire de moyens de prouver qu’ils ne vont pas se soustraire à une convocation ou un suivi judiciaire. Pouvoir produire un justificatif de domicile, d’emploi, ou divers gages d’insertion sociale et professionnelle, par exemple, peut permettre d’éviter l’incarcération.
[14] Pierre Tartakowsky, recension du livre de Gérard Sarda Le procès Konhu en Nouvelle-Calédonie : une nouvelle affaire d’Outreau ? dans Hommes & Libertés n° 151, 3e trimestre 2010.
[15] Mireille Imbert-Quaretta, Rapport sur les difficultés de prise en charge de la population pénale au centre pénitentiaire de Nouméa, novembre 2012.
[16] Yoram Mouchenik (coord.), op. cit.
[17] Ibid