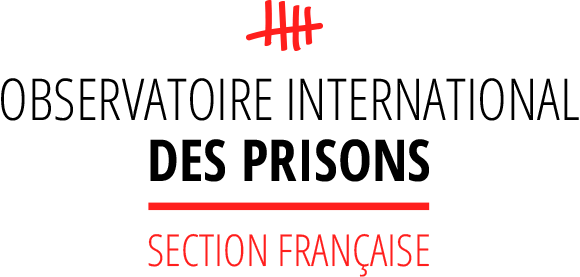La justice est très régulièrement saisie des conditions de détention indignes au centre pénitentiaire de Nouméa. Des procédures qui ont suscité une jurisprudence importante et permis quelques améliorations sur le terrain, sans pour autant mettre un terme aux traitements dégradants dénoncés. Hier comme aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie se retrouve ainsi en première ligne d’une bataille
plus vaste pour rendre ces recours effectifs.
Cela fait une quinzaine d’années que le Camp-Est est la cible de recours en justice dénonçant, inlassablement, l’indignité de ses conditions de détention. Un embrasement contentieux qui semble commencer avec les procédures engagées en 2012 par Paul Yengo et plusieurs dizaines d’autres personnes détenues. Incarcéré l’année précédente, l’intéressé conteste son placement en détention provisoire, puis sollicite sa mise en liberté, en soutenant que ses conditions de détention sont contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Une lettre signée par plusieurs codétenus, et produite au dossier, décrit leur vie dans les cellules exiguës, sous-équipées, vétustes et surpeuplées du Camp-Est. Les recours de M. Yengo sont cependant rejetés, en première instance et en appel, sans que ses conditions d’incarcération ne soient prises en compte. Pour les juges, en effet, les conditions matérielles dans lesquelles s’effectue la détention ne constituent pas un obstacle légal au placement ou au maintien en détention provisoire.
Le long combat de Paul Yengo
Yengo se tourne alors vers la Cour de cassation pour contester cette position de principe. Il dispose, pour étoffer la critique de ses conditions de détention, d’un argument de poids. Après une visite de l’établissement en octobre 2011, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) vient de faire paraître des recommandations en urgence[1], utilisant pour la première fois depuis sa création en 2007 ce mécanisme d’alerte prévu par les textes en cas de « violation grave des droits fondamentaux ». Il dresse un état des lieux effrayant des conditions d’enfermement au Camp-Est : personnes détenues « entassées dans des cellules insalubres », suroccupation atteignant 300 % dans le quartier maison d’arrêt, prisonniers contraints de dormir sur « un matelas posé à même un sol crasseux et humide où circulent des rats et des cafards », chaleur « vite éprouvante » dans les cellules, WC à la turque n’offrant aucune intimité et dont les conduites d’eau ont été « détournées pour pouvoir servir de douche, sans la moindre protection vis-à-vis des installations électriques pourtant dégradées », lavabos « privés de système d’évacuation de l’eau » ou encore « remontées d’égouts fréquentes » qui « empestent l’atmosphère des cellules »…
Se prononçant le 29 février 2012[2] sur la requête de M. Yengo, la Cour de cassation n’exclut pas qu’une demande de mise en liberté puisse exceptionnellement permettre de mettre fin à une détention provisoire se déroulant dans des conditions contraires à la dignité humaine. Mais elle conditionne strictement cette possibilité à la démonstration que la santé physique ou psychique de la personne concernée est gravement et directement mise en danger par ces conditions d’incarcération. Faute d’avoir pu apporter une telle preuve, M. Yengo voit donc le rejet de sa demande de mise en liberté confirmé, malgré l’inhumanité manifeste de ses conditions de détention. Ce faisant, la Cour de cassation confirme que les demandes de mise en liberté ne constituent pas une voie de recours efficace contre les conditions d’incarcération indignes.
Déterminés à ne pas en rester là, M. Yengo et 149 autres personnes incarcérées au Camp-Est lancent en mars 2012 une action en responsabilité contre l’État, avec le soutien de l’OIP et de l’antenne locale de la Ligue des droits de l’homme. Dans le sillage des premières actions de ce type engagées contre les maisons d’arrêt de Rouen et de Nantes[3], ils demandent à être indemnisés en réparation du préjudice moral qu’ils subissent du fait de leurs conditions de détention. Le 31 juillet 2012[4], le tribunal fait droit aux premières requêtes déposées : M. Yengo et vingt-neuf autres personnes détenues sont jugés « fondés à soutenir qu’ils ont été incarcérés dans des conditions n’assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » et obtiennent une indemnisation[5]. Quelques mois plus tard, alors que d’autres prisonniers ont rejoint la mobilisation et que de nouvelles demandes sont en préparation, l’État accepte à l’amiable d’indemniser les 120 personnes détenues restantes. Un mouvement de contestation contentieuse prend forme, avec l’espoir que l’accumulation des condamnations financières contraindra les pouvoirs publics à réagir.
Parallèlement, M. Yengo saisit en juillet 2012 la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) pour dénoncer, outre ses conditions de détention, le fait qu’aucun recours ne lui a permis d’y mettre un terme. Trois ans plus tard, la Cour lui donne raison en concluant à la violation du droit à un recours effectif[6]. Constatant qu’il n’existe pas de recours devant l’autorité judiciaire pour faire cesser les conditions indignes d’incarcération, la Cour reproche au droit interne de ne pas prévoir, « au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement [inhumain ou dégradant] contraire à l’article 3 de la Convention ». L’insuffisance des procédures indemnitaires est donc confirmée par les juges européens, dans la mesure où la réparation financière susceptible d’être obtenue ne met pas un terme, même indirectement, à l’indignité des conditions de détention. D’autant que la plupart des nombreuses requêtes déposées dans les années 2014-2015 par des personnes détenues au centre pénitentiaire de Nouméa sont rejetées, au prétexte que quelques travaux ont été engagés à la suite des recommandations en urgence du CGLPL. Comme l’explique Maître Marie-Katell Kaigre, à l’origine de plusieurs centaines de procédures indemnitaires : « Je n’avais à cette époque que des rejets. On me disait : “C’est bon, l’administration pénitentiaire a fait des travaux, voilà les factures. Tout va bien.” » Témoignant d’une forme d’accoutumance à l’intolérable, le tribunal administratif, mais aussi certains experts désignés pour décrire les conditions de détention du Camp-Est, finissent souvent par les juger acceptables. Provoquant chez les personnes détenues et leurs défenseurs incompréhension et sentiment d’impuissance, et contribuant à faire baisser la pression contentieuse sur l’administration – pour un temps.
La pression monte, ses effets restent limités
C’est au tournant des années 2020 que la guérilla juridictionnelle contre les conditions de détention dégradantes du Camp-Est va à la fois se diversifier et reprendre en vigueur, sous l’effet combiné de deux évènements majeurs. D’une part, après une seconde visite de la prison calédonienne, la CGLPL fait paraître le 18 décembre 2019 de nouvelles recommandations en urgence dénonçant, huit ans après les premières, la persistance d’une « situation qui viole gravement les droits fondamentaux des personnes détenues ». Ces recommandations sont accompagnées de photos révélant au grand jour la profonde inhumanité des conditions dans lesquelles les personnes – y compris mineures – sont incarcérées au centre pénitentiaire de Nouméa. D’autre part, quelques semaines plus tard, la Cour EDH rend son retentissant arrêt JMB c. France du 30 janvier 2020, au terme d’une campagne contentieuse initiée et soutenue par l’OIP. Par cet arrêt, les juges européens condamnent sévèrement la France pour l’indignité des conditions d’incarcération dans plusieurs prisons[7] et demandent à Paris d’adopter des « mesures générales » pour « garantir aux détenus des conditions de détention conformes à l’article 3 », en assurant notamment la « résorption définitive de la surpopulation carcérale ». Ils concluent par ailleurs à nouveau à la violation du droit à un recours effectif, estimant cette fois que les procédures de référés susceptibles d’être engagées devant le juge administratif ne garantissent pas aux prisonniers une protection adéquate contre les conditions de détention indignes. En conséquence, la Cour européenne réclame qu’un recours véritablement effectif soit créé pour y remédier.
Quelques jours après la publication de l’arrêt JMB c. France, l’OIP saisit en référé le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de la situation au Camp-Est, en s’appuyant sur les recommandations publiées par la CGLPL deux mois plus tôt. L’association réclame une amélioration notable des conditions de détention, en mettant le tribunal administratif sous la pression des critiques que vient de formuler la Cour EDH. Dans sa décision, cette dernière a en effet souligné la « portée limitée » des pouvoirs du juge des référés, qui refuse « d’exiger la réalisation de travaux d’une ampleur suffisante » et se cantonne au prononcé de « mesures transitoires et peu contraignantes [ne permettant] pas de faire cesser rapidement l’exposition des requérants à un traitement inhumain ou dégradant »[8]. Elle a également pointé le délai souvent déraisonnable pris par l’administration pour mettre en œuvre les injonctions prononcées.
L’affaire calédonienne va malheureusement offrir une illustration éclatante de la persistance de ces limites, en dépit de la condamnation européenne. Certes, de nombreuses et importantes injonctions[9] sont formulées par le juge des référés du tribunal administratif[10] puis, en appel, par celui du Conseil d’État[11], pour améliorer les conditions de vie quotidiennes des personnes détenues au Camp-Est. Mais l’administration met près de trois ans pour les exécuter entièrement, obligeant l’OIP à multiplier les procédures pour l’y contraindre[12]. Surtout, en confirmant son refus d’ordonner des mesures « structurelles » – telles que la fermeture des conteneurs maritimes transformés en cellules ou l’accroissement des moyens dédiés aux alternatives à la détention –, le juge des référés maintient son refus d’agir sur les causes profondes des traitements inhumains et dégradants dénoncés. Dans un communiqué du 17 février 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie admet en ce sens que « si des travaux et aménagements des lieux de détention [sont] intervenus en application de précédentes décisions de justice, des améliorations des conditions de détention rest[ent] indispensables » car ces dernières demeurent, « notamment en raison de la surpopulation carcérale, attentatoires à la dignité humaine ».
Les promesses vite neutralisées du recours « 803-8 »
Parallèlement aux procédures conduites devant les juridictions administratives par l’OIP, les personnes détenues et leurs conseils se tournent vers le nouveau recours contre les conditions de détention indignes ouvert devant l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale (CPP). Conséquence directe de la condamnation de la France par l’arrêt JMB, cette voie de recours, créée par la loi du 8 avril 2021[13], fait l’objet de nombreuses critiques dès son adoption. En particulier, il lui est reproché de faire du transfert vers d’autres prisons le principal instrument de protection des personnes exposées à des conditions dégradantes d’incarcération. En effet, non seulement la perspective d’un transfert peut être très dissuasive, en faisant courir à la personne détenue le risque d’être éloignée de sa famille, mais l’affectation dans un autre établissement se heurte aussi à la suroccupation alarmante qui touche l’ensemble des maisons d’arrêt.
Les possibilités de transfert étant très limitées en Nouvelle-Calédonie pour des raisons géographiques évidentes, ce territoire offre un terrain d’expérimentation particulier pour tester l’efficacité de ce nouveau recours. Or, ici encore, le bilan est mitigé. Certes, quelques personnes détenues l’ayant actionné sont libérées ou voient leur peine aménagée. À la connaissance de l’OIP, il s’agit des seules libérations intervenues dans le cadre de l’exercice de ce recours sur l’ensemble du territoire français. Mais, par contrecoup, les juridictions calédoniennes mettent en place différents filtres pour limiter au maximum leur nombre. D’abord en faisant preuve d’une exigence formelle excessive. Soulignant que la plupart de ses recours sont « immédiatement rejetés », Me Sophie Devrainne cite en exemple une requête jugée irrecevable au motif qu’elle a omis de préciser le numéro de cellule de son client.
L’examen de la jurisprudence révèle par ailleurs des appréciations contestables – voire contradictoire d’une décision à l’autre – concernant les conditions de détention au Camp-Est. Si le manque d’intimité résultant d’un défaut de cloisonnement des toilettes motive souvent le constat de l’indignité des conditions d’incarcération, un juge de l’application des peine retient par exemple qu’« au regard du temps passé hors de sa cellule, [le requérant] n’est pas légitime à invoquer le défaut d’intimité ni les mauvaises odeurs car il a tout le loisir de s’organiser avec son codétenu pour leur accès respectif aux sanitaires »[14]. En outre, alors que la prohibition des traitements inhumains et dégradants est absolue, certaines décisions avancent que « le droit à la sûreté » justifie néanmoins le rejet du recours et le maintien du requérant en détention[15], en violation flagrante des jurisprudences nationale et européenne. Enfin, les multiples requêtes contre l’indignité des conditions de détention dans la prison calédonienne mettent en lumière une carence de la loi. À plusieurs reprises, en effet, l’autorité judiciaire note que les textes ne prévoient « aucune possibilité de libération en cas de constatation de conditions indignes de détention » pour les condamnés non éligibles à un aménagement de peine et ne pouvant faire l’objet d’un transfert, instaurant « en droit français un recours inefficace pour mettre fin aux conditions indignes »[16].
Ainsi, la création du recours fondé sur l’article 803-8 du CPP ne met pas fin au dépôt massif de recours indemnitaires devant le juge administratif. Plusieurs dizaines de condamnations de l’État pour conditions indignes sont ainsi encore prononcées par le tribunal administratif de Nouméa en « 2021, 2022 et 2023 »[17]. Condamnations néanmoins souvent contestées en appel par les personnes détenues qui critiquent le faible montant des indemnisations accordées, en deçà de ce que prévoit la jurisprudence du Conseil d’État. « Mon but n’est pas de faire du contentieux pour du contentieux, ni de faire condamner la France » explique Me Marie-Katell Kaigre, particulièrement impliquée dans ces procédures. « Mais si on arrive à un référentiel qui permette de discuter d’une indemnisation juste, en fonction des situations individuelles, cela provoquera peut-être une prise de conscience et des actions préventives. »
Par Nicolas Ferran
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°125 – Kanaky – Nouvelle-Calédonie : dans l’ombre de la prison
[1] CGLPL, Recommandations en urgence du 6 décembre 2011 relatives au centre pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-
Calédonie).
[2] Crim., 29 février 2012, n° 11-88.441.
[3] TA Rouen, 27 mars 2008, n° 0602590 ; TA Nantes, 8 juill. 2009, n° 05-5548.
[4] TA Nouvelle-Calédonie, 31 juillet 2012, n° 120112.
[5] D’un montant allant d’environ 800 à 5 600 euros selon la durée de la détention.
[6] Cour EDH, 21 mai 2015, Yengo c. France, n° 50494/12.
[7] Les prisons de Fresnes, Nice (MAF), Nîmes, Faa’a Nuutania, Baie-Mahault et Ducos.
[8] §§ 218 et 219 de l’arrêt JMB c. France.
[9] Plus d’une quinzaine d’injonctions ont été émises, telles que remédier aux différents manquements à l’hygiène dans l’établissement, mettre aux normes des installations électriques, remplacer les fenêtres défectueuses et cloisonner les toilettes dans les cellules, remédier à l’insalubrité des points d’eau et sanitaires du quartier des mineurs, garantir l’intimité des visites dans les parloirs, renforcer la lutte contre les moustiques, prendre les mesures nécessaires au recrutement d’un médecin addictologue, aménager une cour de promenade au quartier disciplinaire ou encore installer des abris et urinoirs dans les cours de promenade qui en sont dépourvues.
[10] TA Nouvelle-Calédonie, 19 févr. 2020, n° 2000048.
[11] CE, 19 oct. et 18 nov. 2020, n° 439372.
[12] CE, 11 févr. 2022, 27 mars 2023 et 26 juill. 2023, n° 452354. Dans un jugement du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie vient d’ailleurs de condamner l’État à indemniser l’association – à hauteur de
1 500 euros – pour ce manque d’empressement.
[13] LOI n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention.
[14] Ord. JAP, tribunal de première instance de Nouméa, 7 oct. 2022.
[15] Ord. Psdt CHAP, CA de Nouméa, 14 nov. 2022, n° 22/00046.
[16] Ord. Psdt CHAP, CA de Nouméa, 12 octobre 2022, n° 22/00048.
[17] Ainsi que le relève le tribunal dans un jugement n° 2300307 du 18 juill. 2024.