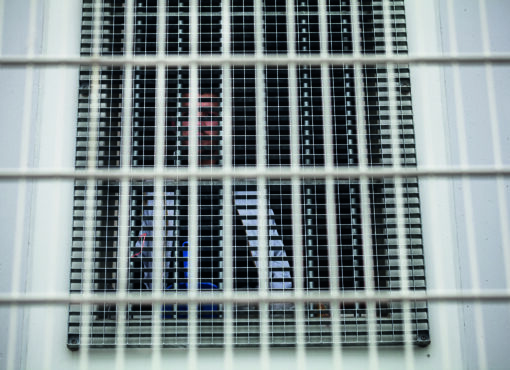À en croire certains parlementaires et praticiens, pour remédier à la problématique des malades psychiques en prison, il faudrait construire davantage d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Le salut réside-t-il réellement dans ces « hôpitaux-prison » ? Zoom sur un dispositif hybride qui, s’il apporte une indéniable amélioration de la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiques, soulève d’importantes questions sociétales et éthiques.
La situation d’incurie dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes détenues souffrant de troubles mentaux est un fait que nul ne peut contester. Devant ce constat, le groupe de travail de l’Assemblée nationale chargé de réfléchir à la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques recommandait tout récemment, dans la foulée du Sénat (1), de lancer une seconde vague de construction d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA), pour aboutir à un total de dix-sept, soit plus de 700 places. On en compte aujourd’hui neuf dans l’Hexagone – aucune en Outre-Mer : 440 places au total, pour près de 70 000 détenus.
Créées en septembre 2002 par la loi Perben I, les UHSA sont dédiées à la prise en charge des personnes détenues dont l’état psychique nécessite une hospitalisation à temps complet, que ce soit en soins libres ou sur décision du représentant de l’État (SDRE) (2). « Avant les UHSA, les personnes dont l’état était jugé incompatible avec la détention étaient sorties de prison sous le régime de l’hospitalisation d’office et prises en charge en établissement de santé mentale selon les modalités de l’article D398 », explique la sociologue Camille Lancelevée, spécialiste des pratiques de santé mentale en milieu carcéral. Problème : dans de nombreux hôpitaux, les patients venant de prison étaient, sur la seule foi de leur statut de détenus, perçus comme dangereux ou présentant un risque d’évasion. Ils étaient donc systématiquement placés dans des chambres d’isolement (sans mobilier, fermées à clef, avec seulement un matelas par terre, et parfois aucun point d’eau, ni toilettes) ou orientés vers des unités pour malades difficiles – même si ce type de traitement n’était pas nécessaire d’un point de vue clinique et risquait d’aggraver la pathologie. « La création des UHSA était censée permettre d’en finir avec ces pratiques. Mais malgré une baisse sensible de ce type d’hospitalisation, on se rend compte aujourd’hui que les UHSA ne s’y substituent pas totalement », poursuit la sociologue. Les hospitalisations en établissement psychiatrique restent même supérieures à celles en UHSA (3).
Un accès inégal suivant la prison d’origine
La persistance de ces pratiques s’explique, dans certains lieux, par l’insuffisance du nombre de lits en UHSA (60 pour 13 000 détenus en Île-de-France), mais aussi par les longues distances qui séparent certains établissements pénitentiaires de l’unité dont ils dépendent, et qui sont rarement pleines à 100 % – le taux moyen d’occupation était de 80 % en 2014 (4). La prison de Villenauxe-la-Grande, dans l’Aube, est par exemple rattachée à l’UHSA d’Orléans, dans le Loiret. « C’est à deux ou trois heures de route. Alors en cas d’urgence, on envoie plutôt à l’hôpital de proximité », reconnaît Bérénice Vannesson, psychologue au centre de détention. D’autant que les moyens dévolus par l’administration pénitentiaire (AP) aux équipes d’escortes dédiées aux UHSA sont bien souvent insuffisants. Résultat : il est quasiment impossible pour les UHSA de répondre à des demandes d’admission en urgence. Dans le cas où cela implique un changement de département, la lourdeur des procédures administratives ne fait que ralentir encore un peu plus les délais de prise en charge, si bien qu’il faut compter de 48 heures à quinze jours entre la date de la demande et l’hospitalisation (5) – certains praticiens évoquent mêmes des délais supérieurs à un mois.
« Un hôpital avec une coque pénitentiaire »
Adossés à des établissements psychiatriques, ces structures hospitalières sont sécurisées par l’administration pénitentiaire, et relèvent donc à la fois des ministères de la Santé et de la Justice. « C’est un hôpital avec une coque, une ceinture pénitentiaire », résume Thomas Fovet, psychiatre à l’UHSA de Seclin. Murs d’enceinte surmontés de grillages, barreaux à toutes les fenêtres, sas, accès sécurisés par des portiques de sécurité, zone réservée aux parloirs, le tout sous la surveillance de personnels pénitentiaires, etc. : de l’extérieur, ces unités se présentent comme des enclaves pénitentiaires en terrain hospitalier. « Mais une fois les portes de la zone de soin poussées, on est à l’hôpital », précise le médecin.
Chaque UHSA est composée de deux à trois unités d’une vingtaine de lits chacune. Outre les chambres avec douche et toilettes individuelles, chacune comprend généralement un lieu de vie qui fait aussi office de salle-à-manger, une ou plusieurs salles d’activités, des cabinets de soin et un espace extérieur. Leur conception architecturale varie en revanche considérablement d’une UHSA à l’autre : si dans certaines, comme à Toulouse, le projet de soin a clairement su s’imposer, dans d’autres, ce sont les préoccupations pénitentiaires qui l’ont emporté. À Lyon, par exemple, « l’architecture n’a pas du tout été pensée pour permettre une vie collective », témoignent des soignants : ici, pas de réfectoire, tandis que les salles d’activité sont exiguës. Et alors qu’à Toulouse, le passage d’un espace à l’autre au sein de l’UHSA se fait sans intervention pénitentiaire, à Lyon, ce sont les surveillants qui gèrent les mouvements entre les trois unités et l’accès aux cours.
Ici vie collective et autonomie, là isolement et enfermement
À Toulouse, Seclin, Rennes et Nancy, le principe est celui de la libre circulation des patients, dans toutes les unités et quel que soit le mode d’admission (en hospitalisation libre ou d’office). À Seclin, les portes des chambres sont ouvertes de 8 h à 20 h, à Toulouse de 7 h 30 à 23 h. Dans certaines d’entre elles, les patients sortent librement dans la cour et partagent activités et repas en commun. Dans chaque unité, quelques chambres d’isolement sont réservées aux situations de crise aiguë.
À Lyon et Villejuif, les conditions d’hospitalisation sont différentes et rappellent, à bien des égards, le régime carcéral. À Villejuif, qui accueille une très grande majorité de personnes hospitalisées sans leur consentement (86 % en 2014, contre 35 % à Rennes par exemple), le projet de soin défendu est celui de l’hospitalisation séquentielle : chaque patient accueilli est censé passer progressivement de l’unité 1 à 3, à mesure que son état se stabilise. À chaque unité ses règles de fonctionnement. À l’unité 1, les nouveaux arrivants, « généralement en décompensation », passent la plus grande partie du temps enfermés en chambre, « dans laquelle il n’y a absolument rien d’autre qu’un lit rivé au sol, même pas de table. Ils n’ont ni lecture, ni radio, ni TV, ni montre : tout est sous clef dans un placard dans le couloir », décrit Roch-Étienne Noto, cadre infirmier à l’UHSA de Villejuif jusqu’en mai 2017. Théoriquement, les patients doivent être sortis de leur chambre et amenés en salle commune au moins trois heures le matin et autant l’après-midi. En pratique, « les horaires ne sont pas du tout respectés, c’est une forme de contention abusive », déplore Roch-Étienne Noto. Dans l’unité 3, qui accueille les patients stabilisés, censée être beaucoup plus ouverte, « tous les mouvements sont surveillés et accompagnés par des infirmiers », regrette une soignante. D’après elle, ce problème tient aux personnels eux-mêmes, qui rechignent à laisser les patients libres de circuler dans l’unité. Même constats à Lyon. Dans l’unité C, les portes des chambres sont constamment fermées à clé, et les patients n’y ont que la télévision pour s’occuper, avec seulement trois créneaux de promenade dans la journée. De l’avis de tous, l’impossibilité de fumer dans les chambres est la principale source de tensions, notamment dans les unités où la libre circulation n’est pas la règle. « À l’UHSA, ils subissent une double contrainte : celle de la prison et celle de l’hôpital. C’est très difficile, certains demandent à repartir en détention », regrette une soignante de Villejuif.
Entre pénitentiaire et soin, une ligne parfois floue
Dans les discours comme dans les textes, la démarcation semble claire entre pénitentiaire et soin. L’AP gère les entrées et sorties, les transferts, les parloirs, le téléphone et les cantines, en restant dans la zone périphérique. Les personnels pénitentiaires ne peuvent entrer dans la zone de soin qu’en cas d’urgence et sur invitation de l’équipe soignante, hormis pour en assurer la fouille à des dates convenues par avance. Tous les responsables rencontrés par l’OIP mettent un point d’honneur à ce que le territoire du soin soit respecté, limitant les interactions au strict nécessaire. Si c’est effectivement le cas la majeure partie du temps, à lire les rapports de visite de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) et à en écouter certains soignants, on réalise que la ligne n’est pas toujours aussi nette.
D’abord, il arrive que les personnels pénitentiaires s’invitent d’eux-mêmes dans les espaces de soin, comme a pu le constater le CGLPL à Villejuif lors de sa visite de 2014. Ensuite, en cas de problème de sécurité grave, les soignants peuvent déclencher l’intervention de l’administration pénitentiaire au sein de l’UHSA. Problème : les surveillants sont parfois appelés pour prêter main forte dans des situations courantes en matière de soin sans consentement, qui devraient pouvoir être gérées sans leur concours. Camille Lancelevée rapporte un cas dans lequel, « face à une personne qui refusait de prendre son traitement, les soignants ont déclenché l’alarme de niveau 3, parce qu’ils craignaient que ça tourne mal. Finalement, la personne a pris son traitement avant que les surveillants n’aient pu intervenir… ». En outre, ces demandes d’intervention donnent parfois lieu à un usage de la force disproportionné, ou à tout le moins déplacé, comme a pu le constater le CGLPL à l’UHSA de Nancy en 2013. À Toulouse comme ailleurs, le recours aux surveillants serait de moins en moins fréquent. « Il y a des fois, où au lieu d’apaiser les situations, ça les a compliquées, parce que les choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu. C’est assez rare qu’ils soient appelés en urgence aujourd’hui », rapporte Anne-Hélène Moncany, responsable de l’UHSA. Dans certaines unités, on observe un glissement des préoccupations et réactions des soignants vers le sécuritaire, à tel point que le CGLPL en venait en 2014 à rappeler aux soignants de Seclin que « le soin doit s’imposer sur la sécurité » (6). Selon l’organe de contrôle, les équipes auraient parfois tendance à apporter une réponse disciplinaire plutôt que thérapeutique à certaines problématiques. La gestion des drogues, en particulier, s’avère propice à ce genre de dérive : dans certaines UHSA, la consommation de produits est envisagée sous l’angle du manquement au règlement et peut entraîner dénonciation à l’administration pénitentiaire et renvoi en détention (7), ruinant toute possibilité de travail thérapeutique. Cette confusion des rôles prend par endroits des tours pour le moins explicites : « J’ai vu des soignants se référer à des notes émanant du chef de détention, demandant par exemple que tel ou tel patient, dont on craignait qu’il puisse s’évader, soit confiné en chambre après 19 h. Pour eux, la note du chef de détention avait valeur de prescription médicale. On voyait un glissement : c’était pratiquement le chef de détention qui devenait leur autorité », analyse Roch-Étienne Noto.
Unanimité sur la qualité des soins
De l’avis général cependant, les UHSA représentent une avancée dans l’accès aux soins des personnes détenues – et a fortiori à des soins de qualité. « On peut faire des hospitalisations complètes de qualité. Ce n’était pas le cas avant », se félicite Anne-Hélène Moncany, à Toulouse. Une amélioration qui bénéficie aussi aux femmes détenues, généralement exclues des dispositifs de prise en charge en prison. Une enquête (8) menée auprès de patients-détenus a montré qu’ils ressortaient globalement satisfaits de leur hospitalisation à l’UHSA, que ce soit s’agissant des soins, de l’information délivrée ou du fonctionnement de l’UHSA. Cette étude établissait en outre que 85 % des patients exprimaient le souhait de poursuivre des soins en détention et 77,6 % après la détention, faisant conclure à leurs auteurs que « compte tenu des liens entre satisfaction des patients et observance », « ces structures pourraient présenter un intérêt majeur dans le parcours de soin des personnes incarcérées souffrant de troubles psychiatriques ». Un premier pas dans un parcours de soins qui, au retour en détention, montre cependant rapidement ses limites (lire page 22). Et qui condamne surtout les personnes détenues à des allers-retours sans fin entre prison et UHSA.
Des soins annihilés par le retour en prison
« C’est ce qui est le plus compliqué pour nous, je pense : soigner quelqu’un dont on sait qu’il va retourner dans un milieu pathogène et qui risque donc de décompenser à nouveau rapidement. On sait qu’il va revenir régulièrement jusqu’à ce qu’il sorte de prison », confie une soignante de Villejuif. Un constat partagé par l’ensemble des praticiens rencontrés comme par certains proches de personnes détenues malades. « Le problème est que ce milieu, outre qu’il est très mauvais pour la santé, ne permet pas non plus, à mon sens, de mettre en place des soins et de stabiliser des gens qui ont des tableaux cliniques compliqués. Forcément, l’état des gens se redégrade et ils reviennent. C’est le cas de beaucoup de nos patients », reconnaît Thomas Fovet, à Seclin. À Toulouse, « faute de mieux », les soignants ont tenté dans certains cas d’intégrer ces allers-retours dans un projet de soins : « Il y a des patients pour lesquels on établit, avec les psychiatres des établissements pénitentiaires qui nous les adressent, que l’on va faire du séquentiel. Parce qu’ils décompensent trop ou trop vite. On essaie de les aider à tenir comme ça… », confie Anne-Hélène Moncany.
Une autre pratique questionne : à Villejuif, certains patients seraient, des dires d’une soignante, hospitalisés pendant de très longues durées, pour certains plusieurs années. « Ce sont des patients dont on sait qu’ils ne pourront pas retourner en prison. Parce qu’ils sont beaucoup trop fragiles et qu’on considère que leur place n’est pas là-bas. Ceux qui restent le plus longtemps sont généralement des patients en détention provisoire dont on pense qu’ils vont être déclarés irresponsables. » Et la situation de Villejuif est loin d’être isolée. « Ces durées d’hospitalisation hors norme se reproduisent pour quelques cas dans chaque UHSA », alerte la Commission des affaires sociales du Sénat : à Toulouse, un patient serait ainsi resté à l’unité plus de cinq ans. Pourtant, « l’UHSA n’est pas faite pour que des gens dont l’état est durablement incompatible avec la détention y fassent leur peine », rappelle le docteur Giravalli, responsable de la toute nouvelle UHSA de Marseille.
« Aider à tenir » les patients le temps de leur peine en multipliant les hospitalisations ; offrir asile à ceux qui n’ont pas leur place en prison et qui auraient dû (ou dont on pense qu’ils devraient) être déclarés irresponsables ou bénéficier d’une remise en liberté pour raison psychiatrique : voilà probablement la fonction la plus inavouée des UHSA, car la plus politiquement et éthiquement dérangeante. « Les UHSA ne doivent pas servir de caution aux déficiences réelles ou supposées de notre système de prise en charge psychiatrique », rappelle la Commission des affaires sociales du Sénat dans son rapport. Aussi, à ceux qui affirment que l’urgence est à la construction d’UHSA, Anne-Hélène Moncany rétorque : « Il faut surtout arrêter de mettre les malades mentaux en prison. »
Par Laure Anelli et Amid Khallouf
Des « détenus de seconde zone »
Le transfert de l’établissement pénitentiaire à l’UHSA suppose un changement d’écrou dans la prison la plus proche. Ce qui peut entraîner des délais de plusieurs semaines avant que les détenus n’aient à nouveau accès à leur compte nominatif et puissent cantiner tabac et autres produits d’hygiène ou alimentaires, ou téléphoner à leurs proches. Les soignants se trouvent souvent contraints de faire tampon, ce qui pèse parfois sur la relation de soin. Le temps passé en UHSA n’est en outre pas comptabilisé pour l’octroi de remises de peines supplémentaires. « On considère qu’ils ne font pas d’efforts de réinsertion », explique le Dr Douceron de l’UHSA d’Orléans. Autant de discriminations qui font dire à certains soignants que les patients sont traités comme des « détenus de seconde zone ».
Des cas isolés de mauvais traitements
À l’UHSA de Villejuif, des patients accueillis dans l’unité 1 subiraient des mauvais traitements, d’après Roch-Étienne Noto, qui y a été cadre jusqu’en mai 2017. S’il précise que « la plupart des soignants sont d’excellents professionnels de santé », il dénonce chez certains infirmiers des pratiques de « surdosage de médicaments, à l’insu des psychiatres ». Il rapporte également le cas de patients « mis à l’isolement et attachés au lit avec une contention mécanique », qui seraient, « par facilité », « nourris à la paille avec des compléments alimentaires liquides (du Fortimel) », qui devraient, comme leur nom l’indique, servir à compléter les repas, pas s’y substituer. De graves manquements dont Roch-Étienne Noto dit avoir alerté la direction. Des mesures auraient été prises, sans que la situation n’ait réellement changé, à en croire les dernières informations qui lui sont remontées.
(1) Commission des affaires sociales du Sénat, Rapport d’information sur les UHSA, 5 juillet 2017.
(2) En 2014, 928 personnes détenues avaient été hospitalisées sans leur consentement, 1029 « librement », et 632 de façon mixte (entrée d’office, puis prolongation en soins libres, et vice versa). Source : ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Rapport de visite de l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Seclin (Nord) réalisée du 12 au 15 mai 2014. (7) Lire notamment Caroline Protais, « La gestion des drogues et des conduites addictives en UHSA. Note de synthèse d’une enquête effectuée dans les 7 UHSA de France », OFDT, note 2015- 07, décembre 2015.
(8) De Labrouhe D. et al., « Hospitalisation en unité hospitalière spécialement aménagée : enquête de satisfaction auprès des patients », Revue d’épidémiologie et de santé publique (2017). Enquête réalisée auprès de 125 patients sortant des UHSA de Villejuif et Seclin entre février et juin 2015.