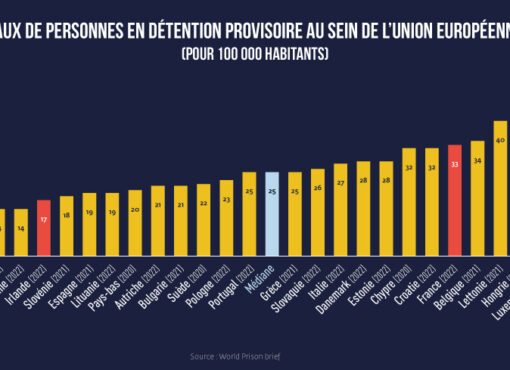Depuis 2008, la Cour municipale de Montréal a mis en place un programme de prise en charge spécifique visant à éviter la prison aux personnes atteintes de troubles mentaux. Ce dispositif, d’abord expérimental, s’est déployé dans la province. Et fait des émules jusqu’à Marseille, où Médecins du Monde lance une recherche-action qui s’en inspire. Entretien avec le professeur Anne Crocker, qui dirige une équipe de recherche sur les questions de justice et de psychiatrie à l’Université de Montréal.
Comment est né le Programme d’accompagnement justice-santé mentale (PAJSM) de Montréal ?
Anne Crocker : En fait, le Canada s’inspire beaucoup de ce qui se fait aux États-Unis, où les premiers tribunaux en santé mentale ont été mis en œuvre à la fin des années 1990. Au Québec, on a commencé à s’intéresser à ce type de programmes parce qu’il y avait en prison beaucoup de personnes souffrant de troubles mentaux. Une concertation a été menée entre les ministères de la Santé et des Services sociaux, de la Justice et de la Sécurité publique, et l’idée du projet est née en 2006 pour un début d’implantation en 2008. L’objectif du programme est d’éviter l’incarcération et de (re)mettre la personne en lien avec le réseau de la santé. Et, finalement, de réduire la récidive et l’effet « porte tournante » entre les systèmes de la justice et de la santé. Plus qu’un tribunal, c’est en fait un véritable programme d’accompagnement.
Comment fonctionne-t-il ?
Le PAJ-SM est basé dans la Cour municipale de Montréal, qui tranche notamment les litiges relatifs aux délits mineurs. L’avocat de la Couronne (procureur) examine le dossier, voit si la personne est éligible et l’invite le cas échéant à intégrer le programme – la personne reste libre de refuser. Pour être éligible, il faut un problème de santé mentale qui justifie l’accompagnement (1) et qu’il n’y ait pas un risque trop élevé de violence. Le programme dispose d’une équipe dédiée, formée de personnes qui ont toutes été volontaires pour en faire partie. Elle est composée de juges, d’un avocat de la Couronne, d’un avocat de la défense, et travaille avec des intervenants psychosociaux. Tous se réunissent pour étudier la situation des personnes qui intègrent le programme et proposer un suivi psychosocial. Les audiences du tribunal ont davantage une approche de « résolution de problème » que de coercition. On laisse à l’accusé la possibilité de s’exprimer et il y a un travail de concertation entre la Couronne et la défense pour convenir des conditions de suivi les plus adaptées à la personne. Elle est ensuite suivie par l’équipe du programme mais sous une autre forme : les audiences, beaucoup moins formelles, sont fixées en fonction des besoins, donc fréquentes au début et plus espacées avec le temps. Si la personne ne respecte pas les conditions de son suivi, elle peut être renvoyée vers un tribunal régulier mais ce n’est pas automatique : en fonction de la situation, il y a réévaluation avec les intervenants psychosociaux. Si elle respecte ces conditions, on peut retirer les charges ou réduire le type de peine. À la fin, on lui remet un certificat qui souligne que toutes les étapes ont bien été franchies et qui l’encourage à continuer. C’est une autre manière de voir la justice, beaucoup plus centrée sur les besoins de l’individu, dans un processus de réadaptation plutôt que de punition. Aujourd’hui, il y a une dizaine de programmes de santé mentale au Québec qui sont inspirés de celui de Montréal, avec des petits ajustements en fonction des régions et des ressources disponibles localement.
Est-ce que tous ne s’occupent, comme à Montréal, que de délits mineurs ?
Oui, la plupart du temps. Mais en fait, cela concerne l’essentiel du public qui cumule troubles psychiques et problèmes avec la justice. Le plus souvent, il commet des délits liés à des questions de survie (vols de produits alimentaires ou de première nécessité), provoque des nuisances dans l’espace public, ou multiplie les infractions liées à ce qu’on appelle l’administration de la justice (non-paiement d’amendes, etc.) Le PAJ-SM a aussi fait des « petits » avec le Programme d’accompagnement justice-itinérance à la Cour (PAJIC) : c’est un dispositif centré sur les problèmes des personnes sans domicile fixe. On se rendait compte qu’il y avait toute une série d’individus qui, quel que soit le trouble mental et la façon dont il était exprimé, ne faisaient qu’accumuler les contraventions et enchaîner les petits délits en lien avec cette problématique. Aujourd’hui, une dizaine de programmes s’en inspirent au Québec.
Pour vous, on ne doit pas limiter son intérêt à un programme isolé…
Oui. Toute la question de la psychiatrie dans le champ pénal doit se voir comme un continuum de points d’intervention, comme un ensemble d’étapes pour favoriser, en amont puis en aval, la déjudiciarisation, les alternatives à l’incarcération et enfin, s’il y a incarcération, le type d’intervention qui doit être mise en place en détention. Cela commence dès les premiers contacts avec les services policiers et va jusqu’à la réintégration dans la communauté si les personnes ont été incarcérées.
Des modes de diversion sont donc proposés dès les premiers contacts avec la police ?
Oui. À Montréal, suite à une étude sur le nombre d’interventions policières en lien avec des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, le service de police de la Ville a mis en place plusieurs programmes, dont une équipe spécialisée. Ce sont des policiers volontaires qui ont reçu une formation en santé mentale et qui sont donc capables de gérer ce genre de situations et d’orienter les personnes interpellées vers le réseau de santé plutôt que vers la justice. Il existe aussi d’autres programmes plus anciens, comme les Urgences psychosociales-justice (UPS-J), montées par les services de santé : en cas de difficulté, les policiers peuvent téléphoner à cet organisme qui va envoyer un intervenant psychosocial pour évaluer la situation de la personne, indiquer si elle est connue d’un service de santé et aider à son orientation.
Qu’en est-il de l’offre de prise en charge proposée en aval ?
Il reste encore beaucoup de travail sur ce volet-là. Que se passe-t-il après que la personne a été incarcérée ou hospitalisée dans un milieu de psychiatrie légale en période prolongée (2) ? Qu’est-ce qu’on met en place pour que le retour dans la communauté soit bien préparé, avec des logements appropriés ? Au Québec, il y a très peu d’hébergements adaptés à la clientèle psycho-légale, avec des professionnels formés. On a fait une étude il y a deux ans qui montre que parmi les personnes déclarées irresponsables pénalement qui, au bout d’un moment, sont libérées, celles qui passent par des structures intermédiaires d’hébergement ont un taux de récidive beaucoup moins élevé que celles qui se retrouvent directement dans des logements indépendants. Il y a un processus de réintégration qui est essentiel. Pour moi, c’est là la prochaine priorité, si l’on veut éviter que ces personnes se retrouvent encore devant le PAJ-SM ou les tribunaux avec les mêmes problématiques.
De manière générale, ces programmes sont-ils soutenus par les pouvoirs publics au Québec ?
Le plan d’action santé mentale a comme principe directeur de promouvoir les prises en charge globales orientées vers le rétablissement. Des programmes multisectoriels comme le PAJ-SM s’inscrivent donc clairement dans cette logique. Ils participent également des politiques qui visent à adapter la réponse judiciaire aux besoins et aux capacités des justiciables. Le PAJIC trouve lui aussi sa place dans le plan d’action interministériel sur l’itinérance qui vise à éviter la sur-judiciarisation des sans-abris. Une des plus grandes difficultés est de faire en sorte que les ministères, au-delà des paroles, partagent des budgets. Il faut des enveloppes multisectorielles pour que chaque acteur concerné se sente en mesure de s’engager. L’autre problème, c’est qu’il n’y a pas de financement gouvernemental pour l’évaluation de ces programmes. Tout le monde en est très content, mais en réalité on n’a pas d’évaluation formelle de leurs résultats : est-ce que les taux de récidive diminuent, est-ce qu’on a moins d’incarcération… ? Quand on a une dizaine de programmes dans une province et qu’on veut changer les politiques, il faut être capable de dire si ça marche ou pas, pour qui et pourquoi.
Vous collaborez avec l’équipe française chargée de l’expérimentation marseillaise. Quels sont selon vous les préalables à sa mise en œuvre ?
La partie la plus importante, avant même de commencer, c’est toute la préparation des partenariats avec les réseaux d’hébergement, les réseaux de ressources communautaires, les réseaux hospitaliers pour réserver des lits si nécessaire, les postes de police, les tribunaux, les juges d’instruction, etc. C’est d’autant plus long que ça implique un changement de culture. Mais c’est absolument nécessaire car les besoins se situent à plusieurs niveaux. L’objectif n’est pas juste de réduire les symptômes psychiatriques, c’est aussi d’améliorer le fonctionnement psychosocial, d’offrir des lieux de vie adaptés, de comprendre que l’augmentation du casier judiciaire est peut-être due à des procédures administratives trop rigides, que ce n’est pas parce qu’une personne commet un délit qu’il faut automatiquement l’amener devant un tribunal, etc. Il faut que tous les partenaires aient la même vision.
Propos recueillis par Cécile Marcel
À Marseille, un toit et un suivi intensif plutôt que la prison
Que faire des personnes qui cumulent trouble psychique et précarité résidentielle et sont régulièrement confrontées à la justice ? À Marseille, l’association Médecins du Monde s’est inspirée des programmes québécois pour développer un projet expérimental d’« alternative à l’incarcération par le logement et le suivi intensif dans la communauté ». La philosophie : éviter les allers-retours entre hôpital, prison et centres d’hébergement d’urgence en proposant un accompagnement global, dans tous les domaines qui sont potentiellement affectés par le désordre mental : santé, hébergement, travail, relations sociales, etc. L’association a donc conçu une recherche-action qui devrait débuter tout début 2019 et s’étaler sur cinq ans. Un volet « prise en charge » proposera, en lieu et place de la prison, un suivi intensif en milieu ouvert, dans le cadre d’une décision de justice. Un volet « recherche » en évaluera l’impact, en le comparant notamment avec un groupe témoin non suivi par le programme.
Pour être pris en charge, il faut réunir plusieurs critères : présence d’un trouble psychique sévère, absence de domicile, volonté d’être accompagné et consentement à participer à l’étude. « Il faut aussi qu’il y ait un risque de récidive élevé », précise Thomas Bosetti, le médecin psychiatre coordinateur du projet. « Pour écarter du dispositif les personnes qui n’ont pas besoin d’un suivi rapproché, qui pourrait même être contreproductif. » Un premier repérage sera fait, au niveau des geôles du tribunal, par l’association chargée de l’enquête sociale rapide qui précède le procès. Après une rencontre entre l’intéressé et l’équipe « recherche », composée d’un chercheur et d’un médecin, l’inclusion dans le dispositif pourra ensuite être demandée. « L’idée c’est de faire des propositions qui puissent être suivies par les magistrats, comme une aide à la décision », explique le Dr Bosetti. S’il suit, le magistrat pourra proposer l’intégration de la personne dans le programme dans le cadre d’une mesure de milieu ouvert telle que la contrainte pénale. L’accompagnement, prévu pour durer deux ans, consistera ensuite en un suivi intensif pluridisciplinaire. Autour d’un chef de projet clinique, l’équipe sera composée d’un psychiatre, d’un infirmier, de travailleurs pairs, de travailleurs sociaux et d’un agent d’insertion professionnelle. Chaque personne suivie disposera d’un référent au sein de l’équipe : « intervenant pivot », celui-ci fera le lien avec les autres pour répondre, au jour le jour, aux besoins d’accompagnement de la personne, en fonction d’objectifs qui auront été fixés avec elle. L’accompagnement se fera sur son lieu de vie. « Une bonne visite commence chez la personne et se termine dehors : pour explorer les ressources du quartier, savoir où faire des courses, s’occuper de son linge, trouver des espaces de socialisation », relève Thomas Bosetti. Qui rappelle qu’« on peut vivre avec la maladie, à partir du moment où certains besoins sont satisfaits ».
(1) Un diagnostic clair n’est pas nécessaire et la présence d’indicateurs suffit.
(2) Les personnes qui sont reconnues irresponsables ou inaptes à subir un procès mais hospitalisées en institution psychiatrique car considérées comme dangereuses.