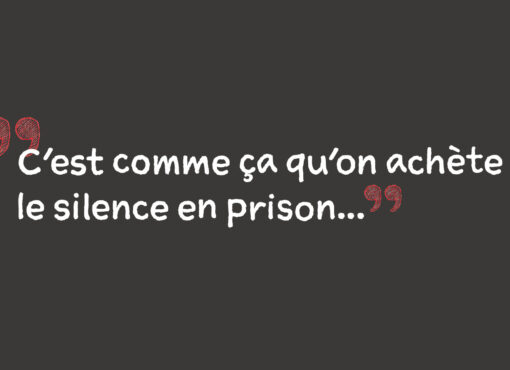Constatant l’échec évident de la prévention du suicide en prison, l’ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté Jean-Marie Delarue dénonce le refus de l’administration pénitentiaire de considérer les causes du passage à l’acte des détenus. Empêchant ainsi toute amélioration de la prévention. Entretien.
Jean-Marie Delarue a été Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2008 à 2014 et membre du Comité consultatif national d’éthique de 2013 à 2017.
Quel regard portiez-vous sur le suicide lorsque vous étiez Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) ?
Jean-Marie Delarue : C’était évidemment un sujet de préoccupation, d’autant que le nombre de suicides est très vraisemblablement sous-estimé, et ce dans des proportions que l’on ne sait pas déterminer. Je m’étais à l’époque dressé des statistiques un peu personnelles. Je recevais tous les jours le relevé des incidents qui parvenait à la Direction de l’administration pénitentiaire. Dans ces incidents, il y a toujours les décès ; dans ces décès, il y a les suicides et les morts ; dans ces morts-là, il y a deux catégories : les morts expliquées (gravement malade, crise cardiaque dans une cour, etc.), et puis il y a les morts inexpliquées, l’autopsie n’ayant pas encore eu lieu. Une mort inexpliquée, c’est par exemple celui que l’on trouve mort sur sa couchette. Il est vraisemblable que dans ces morts-là, il y ait beaucoup de suicides par produits médicamenteux. J’avais estimé qu’il fallait ajouter 15 à 25 % aux chiffres officiels pour s’approcher de la vérité.
Comment analysez-vous la réaction de l’administration pénitentiaire (AP) face à ce phénomène ?
Pour moi, la pénitentiaire pèche par défaut en ne s’interrogeant pas sur les causes du suicide en détention. Ce qui l’intéresse, ce n’est pas pourquoi les gens se suicident, mais comment, dans le but d’empêcher l’acte. Elle a donc développé dans les années 2000, à la suite des rapports des docteurs Terra et Albrand, un certain mode d’action : repérer les suicidaires d’une part, et empêcher le passage à l’acte d’autre part, en les plaçant dans des conditions telles qu’ils ne pourront plus se suicider. Je me permets d’insister sur le point du repérage : on va repérer les suicidaires à l’entrée en détention, à l’aide d’une grille d’évaluation. Ensuite, on va scruter la manière dont ils se comportent durant toute la durée de la détention. Le suicide vient justifier cette espèce de surveillance que l’on fait incessante du détenu : c’est l’alibi parfait pour resserrer le carcan de cette surveillance de tous les instants. La caricature de cela, ce sont les mesures de surveillance dite « spéciale » : la nuit, au lieu de deux rondes à l’œilleton et deux rondes à l’écoute, on leur en fait quatre à l’œilleton, on allume la lumière, on leur demande de bouger. On pense qu’en passant quatre fois par nuit pour leur demander s’ils sont en vie, on va minimiser les chances de passage à l’acte. Quant aux instruments que l’on a inventés – la cellule de protection renforcée (CProU) et la dotation de protection d’urgence (DPU)* – il ne s’agit que de supprimer la corde que l’on se passe au cou. Mais dans tout cet attirail – qui n’est pourtant pas mince – il n’y a pas la question du pourquoi les gens se suicident. Pour moi, c’est structurellement l’attitude de la pénitentiaire.
La tendance à ne pas s’intéresser à l’origine des problèmes ?
Oui. Je rapproche cette attitude de la manière dont elle envisage les gens qui se comportent mal en détention. Quand une personne pose des problèmes de discipline, on la punit. Et lorsqu’on ne sait plus quoi faire d’elle, lorsqu’on a conscience que les punitions demeurent sans effet, on la transfère dans une autre prison, sans avoir cherché à s’expliquer le comportement réfractaire. C’est exactement la même chose pour le suicide. On est, sur cette question en particulier, face à un grand paradoxe de la pénitentiaire : d’un côté, il n’y a pas de dossier mieux documenté que le suicide en détention – les morts sont recensées, analysées, si bien que l’on connaît les lieux, les jours ou encore les catégories d’infracteurs les plus à risques, etc. Et en même temps, l’institution fait preuve d’une grande inaptitude à interroger le pourquoi du passage à l’acte. On est devant une espèce de constat de faillite : en éludant la question, la pénitentiaire se condamne elle-même à une certaine forme d’impuissance. C’est aussi une sorte de refus de lucidité.
Parce que s’interroger sur les causes impliquerait de remettre en question certaines logiques institutionnelles ?
Cela risquerait de révéler l’impuissance de l’administration à juguler un certain nombre de phénomènes et de comportements. En tant que CGLPL, on peut en effet, avec toute la prudence nécessaire, essayer d’identifier certains facteurs à travers les courriers que l’on reçoit, les entretiens que l’on a lors de visites. En dehors de l’incapacité des individus à assumer leur propre acte, d’autres causes me paraissent importantes : les rapports avec les autres détenus d’abord. Ces rapports ne sont pas de tout repos. On peut s’arranger pour les fuir, mais ce n’est pas toujours simple. Par exemple, on peut avoir besoin de choses comme des cigarettes que l’on n’a pas les moyens de se payer, donc on a recours à une tierce personne. Et puis comme on est toujours pauvre, on ne peut pas rembourser. Alors il y a des remboursements en nature (planquer un téléphone portable) mais qui ne suffisent pas à effacer la dette. Les rapports se font alors plus violents, les menaces plus précises ; on peut menacer la famille à l’extérieur par exemple. Le suicide est parfois un moyen de régler le problème. J’ai aussi correspondu avec des personnes mises en cause dans un certain type d’affaires, des infanticides par exemple, qui décrivent le véritable calvaire qu’elles subissent en détention. Là encore, le suicide est une façon d’y échapper. Et puis il y a les rapports avec les personnels.
Qui peuvent jouer un rôle dans le passage à l’acte ?
Je raconte souvent cette affaire qui m’avait beaucoup frappé, dans laquelle j’étais intervenu sans aucun succès. C’est l’histoire d’un homme, à peu près 50 ans, qui passe de Casabianda à Mauzac. Plutôt intello, instruit, il a un ordinateur, qui disparaît pendant son transfert. Arrivé à Mauzac, il demande à plusieurs reprises à l’administration de le dédommager. Impossible. Alors il rachète, à ses propres frais, un ordinateur. Mais ses demandes répétées de remboursement ont agacé. Quand il reçoit son nouvel ordinateur, on se met à le surveiller de très près : on le saisit sans arrêt, pour vérifier son contenu, qu’il n’a pas accès à Internet… Cette surveillance est pesante. Et un jour, on lui détruit des fichiers, ce qu’il supporte très mal. Les relations s’enveniment et deviennent telles qu’il demande son transfert pour Poitiers. Là, le surveillant en charge de l’informatique recommence la même pression, qu’en d’autres lieux on nommerait harcèlement. Notre homme s’emporte, cela lui vaut un rapport d’incident disciplinaire. Là, j’ai senti dans ses courriers qu’il commençait à désespérer. Une chargée d’enquête du CGLPL est allée voir ce qu’il se passait à Poitiers-Vivonne au mois de novembre. Interrogée sur ce cas, l’administration se rend alors compte que le détenu n’avait pas été sanctionné pour cet incident, qui avait eu lieu en juillet. Le 23 décembre, elle le colle au quartier disciplinaire pour cette histoire qui remonte à plusieurs mois. Les fêtes sont pourtant une période sensible, l’administration le sait et évite généralement ce genre de pratique. Le 24, cette personne se passe la corde au cou : elle est morte la veille de Noël.
J’ai demandé une enquête de l’inspection pénitentiaire. Selon elle, tout était conforme. Il n’y a pas eu de suites. Pour moi, la cause du suicide ne fait aucun doute : c’est cette succession de persécutions qui a conduit cet homme au suicide. Qui pourrait résister à ce traitement ? Personne. C’est ce genre de choses que l’administration ne veut pas voir et sur lesquelles il est préférable pour elle de mettre l’oreiller. Or, tant qu’on sera dans cet aveuglement volontaire, on aura beau faire, on ne réglera pas le problème.
Parmi les facteurs structurels pouvant expliquer le fort taux de suicide en prison, on avance souvent celui de la surpopulation, ou encore de la taille démesurée de certaines prisons, comme Fleury-Mérogis.
La sur-suicidité carcérale ne s’explique pas par la surpopulation. C’est si vrai d’ailleurs que tandis que le taux de suicide monte, dans les années 1980-1990, le taux de surpopulation décroît. Quant au deuxième facteur que vous évoquez, oui, il y a plus de suicides dans les établissements de grande taille. Cela ne reflète que l’état des violences générales. On est dans des situations où plus personne ne connaît personne, par conséquent il ne faut pas attendre des surveillants la moindre parole de réconfort. Le repérage se fait beaucoup moins bien. J’avais comptabilisé le nombre de surveillants qui consignaient des observations dans le cahier électronique de liaison (CEL) dans ce type d’établissement : c’est un tout petit nombre. Au quartier arrivants, cela se fait parce que c’est une préoccupation, et les personnels savent que les observations faites au début d’une détention pèsent sur tout le reste. Mais, dans un grand établissement, le surveillant ordinaire, qui est dans la coursive du bâtiment A au troisième étage simplement le matin, pour la semaine, et qui, la semaine d’après, sera dans le bâtiment D… lui, n’écrit pas dans le CEL, parce qu’il ne sait pas dans quelle mesure une attitude qui pourrait être jugée bizarre pourrait être consubstantielle à la personne ou non. Donc il ne consigne rien. Ce fameux repérage a donc de cruelles faiblesses, même entendues au sens de l’AP. On peut d’ailleurs peut-être s’en féliciter, car on serait dans un monde non seulement kafkaïen, mais aussi orwellien !
C’est d’ailleurs pour compenser cet échec dans le repérage que l’administration entend étendre le dispositif des codétenus de soutien à tous les établissements de plus de 600 places…
Ce raisonnement est inacceptable : ce faisant, la pénitentiaire se défausse de son devoir de protection, mais en plus, elle fait porter la responsabilité du suicide des détenus sur d’autres détenus, et fait porter aux plus faibles les fragilités d’autres encore plus faibles qu’eux.
D’autant plus que, lorsqu’ils découvrent leur codétenu en situation d’urgence vitale, les appels à l’aide ne sont pas toujours entendus, notamment la nuit… Avez-vous eu connaissance de ce type de situation, lorsque vous étiez au CGLPL ?
Tout le monde a peur de la nuit, les gens ont peur d’être isolés, de ne pas pouvoir appeler au secours. C’est particulièrement vrai en prison. J’ai rencontré quelqu’un qui a fait une crise cardiaque la nuit. Il n’a été emmené à l’hôpital que le lendemain à 11 heures, où il a pu être sauvé in extremis. C’est par chance qu’il a survécu. En revanche, le nombre de personnes qui ont appelé la nuit sans succès, on ne peut pas le comptabiliser. Je pense, mais seule l’autopsie peut le dire, qu’il y a des gens qui meurent la nuit en prison parce qu’ils n’ont pas été entendus. On a mis des interphones dans les établissements modernes. Il y a un système d’alarme qui est théoriquement bien fait, mais ce n’est pas qu’une question de technique… Les équipes de nuit ont horreur d’être dérangées par interphone, je l’ai vu. En même temps, c’est vrai qu’il y a des détenus qui s’amusent à jouer avec pour les ennuyer. Au milieu de cela, l’appel au secours a toutes les chances de ne pas être entendu.
Il faut donc, d’abord, que les gens répondent au bout de l’interphone, écoutent ce qui se dit et que ce qui se dit soit pris au sérieux par le surveillant. C’est rarissime qu’on arrive à la quatrième étape qui est : « On alerte le premier surveillant qui va ouvrir la porte de la cellule. » Et puis, même quand on y arrive, il faut que ce gradé se rende compte de la gravité de la situation. Pour anecdote, je me souviens d’une personne détenue qui avait fait une chute de son lit, la nuit, et qui est tombée inconsciente à cause du choc. Son codétenu a donné l’alerte et l’a remise tant bien que mal sur son lit. Les secours ont fini par arriver, le premier surveillant a passé la tête et a dit : « Qu’est-ce que vous me chantez ? Regardez comme il dort bien ! » Et il a refermé la porte. Ce type de chose angoisse énormément.
Lorsqu’un décès survient, des protocoles sont mis en place pour prendre en charge les personnels, mais pas la communauté des détenus, à part les cocellulaires.
Il faudrait déjà enquêter sur la manière dont ces protocoles s’appliquent aux personnels. J’ai les plus grands doutes là-dessus. « Chacun se débrouille comme il peut » : c’est ça, la règle, dans l’établissement ordinaire. Pour les détenus, il n’y a évidemment rien. Pour la bonne raison que structurellement, la pénitentiaire ne peut pas se permettre de concevoir la population carcérale comme une communauté : ce serait l’ériger en interlocuteur avec des intérêts collectifs. Pour les proches, c’est la même chose : on se contente souvent du service minimum, c’est-à-dire de l’appel aux familles. Pourtant, la mort en prison est une chose assez présente, qui est l’objet de toutes les rumeurs possibles et imaginables. Il n’y a pas une mort dont la rumeur ne prête la responsabilité à la pénitentiaire. C’est pour partie vrai, c’est pour partie faux. Mais il n’y a pas un suicide qui ne soit attribué plus ou moins ouvertement à l’administration : on accuse l’administration d’avoir déguisé les choses en suicide ou on accuse l’administration d’avoir acculé la personne au suicide. Mais parce que les détenus s’y retrouvent, en réalité. Bien peu échappent à cette envie de mourir, on le voit à travers les courriers, lors des visites…
C’est là encore l’un des paradoxes de la pénitentiaire : la mort est à mon sens le seul acte qu’elle reconnaisse comme un acte grave. Mais elle ne prend pas les mesures nécessaires pour appréhender la gravité de cet acte avec les détenus, avec les proches et avec le personnel. La mort est un acte grave, mais tout est fait pour en minimiser la portée. Fondamentalement, si la pénitentiaire ne s’intéresse pas à la mort des détenus, c’est sans doute parce qu’elle ne s’intéresse pas à leur vie.
Recueilli par Laure Anelli
Mort, la nuit, sous les yeux d’un surveillant impuissant
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2010, à la maison d’arrêt de Rouen, le surveillant du « rond-point » reçoit un appel de la cellule de David G. Ce dernier, « atteint de troubles psychiatriques susceptibles d’entraîner des comportements agressifs, suicidaires ou d’automutilation », se trouve au service médico-psychologique régional (SMPR) de la prison, où il a été placé sous surveillance renforcée. David G. ne va pas bien, il veut se pendre et le fait savoir au rondier, qui prévient immédiatement le major T., son gradé de service, qui n’en n’a cure et lui demande de poursuivre sa ronde. Le surveillant ne l’écoute pas et préfère rester à proximité de la cellule. De l’autre côté de la porte verrouillée, David G. retire la housse de son matelas, l’accroche aux barreaux de la fenêtre de sa cellule et s’y pend. Impuissant, le rondier assiste à la scène à travers l’œilleton : simple surveillant, il ne dispose pas des clefs pour ouvrir la cellule. Tout en tentant de maintenir le contact avec le pendu, il prévient à nouveau le major T., installé avec l’équipe d’intervention en salle de repos. Cette fois, le message est clair, un détenu s’est pendu, ils peuvent mettre en place le protocole qui décline « les pratiques professionnelles associées à l’intervention des personnels pénitentiaires en cas de passage à l’acte suicidaire d’une personne détenue par pendaison ». Première étape : rejoindre le bureau du major, dans lequel se trouvent, dans un coffre verrouillé, la clé de la cellule, la clé de circulation et la clé de l’infirmerie. Puis gagner la cellule de David G. Sauf que pour l’atteindre, il faut ouvrir et refermer sept grilles de sécurité. Presque autant de grilles que de minutes écoulées. Le second appel du rondier a été passé à 1 h 30 du matin ; l’équipe d’intervention ne serait arrivée sur les lieux qu’à 1 h 39. Neuf longues minutes qui n’ont pas permis d’empêcher la mort par asphyxie de David G. Neuf minutes qui auraient pu être évitées, a fait remarquer le tribunal administratif de Rouen. Dans sa décision, le juge a reconnu l’existence d’un « défaut dans l’organisation et le fonctionnement du service, à l’origine du retard dans l’intervention du personnel pénitentiaire porteur des clefs » et a condamné l’État à indemniser la famille de David G. – Amid Khallouf
* La CProU est une cellule « lisse », équipée du strict minimum, et dépourvue de points d’accroche pour limiter les risques de pendaison. La DPU est un kit constitué de deux couvertures indéchirables et résistantes au feu et de vêtements déchirables à usage unique.