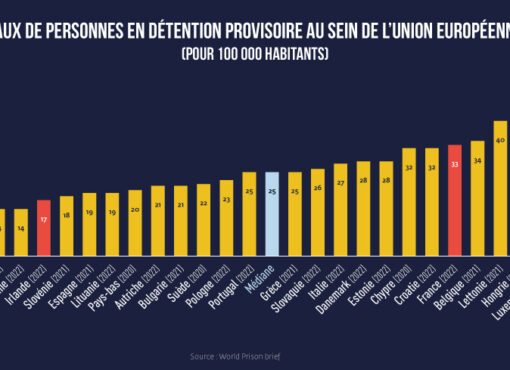Alors que le recours à l’enfermement tend à se banaliser, l’association Seuil mise sur une autre méthode pour répondre à la délinquance des mineurs : la marche éducative. Entretien avec son fondateur, Bernard Ollivier.
En quoi consiste le projet de Seuil ?
Nous proposons à des jeunes qui sont en très grande difficulté, y compris des jeunes incarcérés, de s’en sortir par un exploit : marcher dans un pays étranger sans téléphone, sans musique et sans Internet pendant trois mois et sur une distance de 1800 à 2000 kilomètres. Il n’y a pas de groupe : le jeune – garçon ou fille – est seulement accompagné d’un adulte (homme ou femme). L’idée, c’est de faire franchir le seuil de la société à des jeunes qui se sont désocialisés et qui la rejettent.
Comment cette idée vous est-elle venue ?
Je me suis inspiré de ce que faisait une association belge qui s’appelle Oïkoten. Cela veut dire « hors de la maison et par ses propres forces » en grec, je trouve que cela résume bien le projet. J’en avais entendu parler en 1998, alors que je marchais sur le chemin de Compostelle. Moi-même parti en mauvais état, j’avais découvert la vertu de résilience de la marche. J’ai trouvé l’idée formidable, à tel point que j’ai décidé de faire la même chose – j’avais du temps puisque j’entrais en retraite. Je suis allé voir l’association en Belgique, pour observer leur mode de fonctionnement et j’ai créé Seuil en mai 2000.
Comment votre projet a-t-il été accueilli par les institutions ?
Il n’a pas été bien reçu par la direction régionale de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de l’époque. Le directeur était contre le fait que des gens dont ce n’était pas le métier prétendent avoir des vues sur l’éducation. C’est finalement grâce au livre tiré de mon expérience personnelle(1), qui a bénéficié d’une belle couverture médiatique, que j’ai pu « vendre » l’idée de Seuil, mais aussi la financer. Nous avons aussi reçu le soutien de fondations, sans quoi nous n’aurions pas pu continuer. Treize ans plus tard, en 2013, la PJJ a fini par nous accorder le statut de « lieu de vie et d’accueil ». Mais l’aide financière de la PJJ et de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ne couvre aujourd’hui que 75% du prix d’une marche. Il manque 50 € par jour, soit 5 000 € par marche. Cela nous contraint à limiter leur nombre et à faire appel à des fonds privés. Pourtant, une marche avec Seuil est jusqu’à moitié moins cher qu’un séjour en centre éducatif fermé ou en prison pour mineurs(2).
Combien de jeunes accompagnez-vous et quel est leur profil ?
Pour l’instant, nous faisons marcher plus de quarante jeunes par an. La moitié provient de l’Aide sociale à l’enfance, l’autre de la Protection judiciaire de la jeunesse. Parmi ces derniers, près de la moitié étaient incarcérés ou risquaient de l’être. Le juge des enfants signe alors une liberté conditionnelle ou un aménagement de peine qui permet le départ du jeune.
Le programme est-il adapté à toutes les problématiques ?
Nous ne prenons pas en charge les jeunes qui ont des problèmes psychologiques graves, parce qu’ils peuvent perdre très rapidement la notion de ce qu’ils sont en train de faire. C’est trop difficile et ça n’a pas d’effet. Pour les autres, ma philosophie a toujours été de dire : « Je ne veux pas savoir ce que le jeune a fait, je veux savoir ce qu’il a envie de faire. » Cela peut marcher pour tous, à condition qu’ils aillent jusqu’au bout. Pour beaucoup de jeunes, au départ, c’est surtout une opportunité de sortir de prison, une occasion, pensent-ils, de partir en vacances. Mais ils se rendent vite compte que marcher 25 kilomètres par jour, ce n’est pas si simple. D’autant plus qu’ils doivent se séparer de leur téléphone.
Comment se passent concrètement les marches, quelles sont les éventuelles difficultés ?
Au départ, ils n’écoutent pas ce qu’on leur dit – ils ne lacent pas leurs chaussures, ne boivent pas assez d’eau – et ils ont des problèmes d’abord physiques : ampoules, tendinites… Puis vient le coup de blues : l’abandon du cadre habituel, la distance vis-à-vis de la famille ou de la petite copine ou petit copain… Leur volonté ne dépasse généralement pas les trois premiers jours. Beaucoup ont envie de se faire la malle, mais ils ne fuguent pas parce qu’ils sont dans un pays étranger dont ils ne parlent pas la langue – on a eu une seule fugue, mais le jeune s’est rendu à la police au bout de trois heures pour dire qu’il était perdu et a donné notre numéro. Il faut donc les soutenir, les pousser à tenir un jour de plus, puis un autre. L’accompagnant doit faire preuve de beaucoup d’écoute. La marche est une thérapie qui doit permettre la libération de la parole des jeunes. On leur impose deux heures de silence par jour pour les pousser à la réflexion personnelle. Le premier mois est extrêmement difficile, mais tous ceux qui passent ce cap iront jusqu’au bout. Un jeune m’a dit récemment « quand j’ai passé le 300e kilomètre, j’ai compris que j’irai jusqu’au bout et que je m’en sortirai ».
Gardez-vous contact avec les jeunes après la marche ?
Après la marche, c’est l’éducateur de la PJJ ou de l’ASE qui nous l’a orienté qui reprend la main sur le suivi du jeune. Certains d’entre eux gardent le contact avec nous, mais ce n’est pas systématique. Ce n’est de toute façon pas le but. J’utilise souvent l’image de quelqu’un qui est en train de se noyer : on lui tend la main, on le sort de l’eau ; après, on ne va pas guider sa vie et le mettre sous surveillance. On leur offre une chance, souvent la dernière.
Recueilli par Katy Diouf
Des résultats positifs
Cinquante-six jeunes âgés de 14 à 17 ans – des garçons pour les trois quarts – ont participé au projet Seuil en 2015 et 2016. La moitié des adolescents ont tenu une marche complète (91 à 120 jours) ou conséquente (61 à 90 jours), un sur cinq a interrompu sa marche dans les quinze premiers jours. D’après le rapport d’évaluation commandé par l’association au cabinet Pro-Éthique, 76 % des participants qui ont marché plus de 60 jours ont connu une évolution positive dans l’année ou les deux ans qui ont suivi cette expérience : pour 36 %, le cabinet parle de « transformation » et d’«insertion stable ». 32 % seraient « sur un chemin sérieux d’insertion », 8 % auraient connu une « évolution positive sans aboutissement complet ». 12 % auraient connu une « stagnation », 12 % une « évolution négative ».
(1)Bernard Ollivier, Longue marche , Phébus, 2000.
(2) La prise en charge d’un mineur s’élève à environ 690€ par jour et par jeune en centre éducatif fermé (données 2018), et à 536€ en EPM (données 2016).