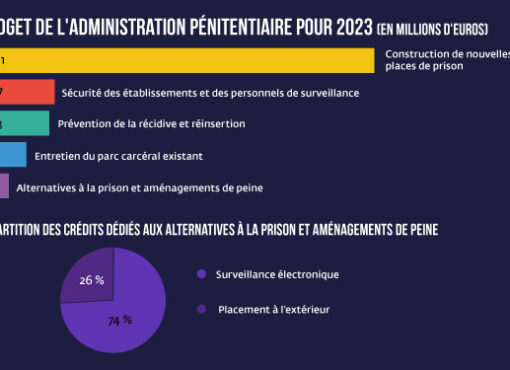Les nouvelles prisons reproduisent un modèle architectural datant du XIXe siècle, fondé sur l’enfermement cellulaire et l’interdiction de toute vie sociale. Christian Demonchy met en cause la responsabilité du politique, qui s’est affranchi de toute réflexion sur le contenu à donner au quotidien en détention. Un « trou noir de la pensée » qui a pour conséquence de perpétuer une architecture « contre nature ».
Christian Demonchy, architecte, a conçu avec son associée Noëlle Janet, le centre de détention de Mauzac avant de participer au programme 13 000 et de concevoir le centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Il a écrit de nombreux articles sur l’architecture carcérale.
Vous avez décrit le « modèle général d’architecture carcérale » auquel répondent l’ensemble des établissements pénitentiaires français construits depuis 1830. Les prisons du XXIe siècle ont-elles renouvelé le genre ?
Ce modèle général, qui perdure jusqu’à aujourd’hui, présente trois caractéristiques architecturales. La première est la continuité du bâti : malgré les différentes fonctions qu’il assure, la prison est un bâtiment unique plus ou moins tentaculaire qui englobe toutes les circulations de liaison. La deuxième tient au mode de gestion des différentes unités destinées aux détenus : chaque unité – cellule, atelier, cour de promenade, etc. – est conçue comme une prison dans la prison. La troisième porte sur les circulations de liaison qui constituent le principal lieu de travail des surveillants et ne sont jamais un lieu de vie pour les détenus : gardiens et gardés ne vivent pas dans les mêmes espaces.
La topologie du centre de détention de Mauzac, réalisé entre1984 et1986, s’oppose en tous points à ce modèle général. Par exemple, la cour de promenade traditionnelle a été remplacée par une grande place arborée qui sert de liaison entre les pavillons d’hébergement et les espaces d’activités. Elle est le lieu privilégié de rencontres entre détenus, mais également avec le personnel. Mais la construction était à peine terminée qu’Albin Chalandon, succédant à Robert Badinter, préparait déjà ce qui allait aboutir au programme 13 000, avec un cahier des charges des plus classiques. Pour ne reprendre que l’exemple de la cour de promenade, elle devait être entourée de murs et de grillages, jamais contiguë aux façades de bâtiments, contrôlée par un poste surélevé de façon à en surveiller plusieurs si possible.
Les nouvelles prisons du XIXe siècle étaient des « prisons-salles d’attente », conçues pour le prévenu en attente de jugement, le condamné en attente de libération ou de transfert. Ce modèle continue-t-il d’imprégner les nouvelles prisons ?
Oui, et cela révèle l’extraordinaire histoire de la prison dite «pénale». Ce qu’on appelle «système pénitentiaire» est un système qui a été adopté dans les années 1830. Importé des États-Unis, il prescrit dans sa version française l’isolement cellulaire des condamnés de nuit et le travail en commun de jour dans des ateliers avec application de la règle du silence. Il a pour objectif l’amendement du coupable et implique une architecture spécifique où la vie sociale entre détenus est proscrite afin que la prison ne soit pas « l’école du crime ». Mais une architecture cellulaire coûte cher. Les responsables politiques de l’époque se sont contentés d’investir dans des nouvelles prisons pour stocker ceux qui troublaient l’ordre public et venaient d’être arrêtés. C’est pourquoi toutes les nouvelles prisons pour hommes ont été, jusque dans les années 1960, des maisons d’arrêt et non des établissements pour peine. Dans ce type d’établissement, prévu initialement uniquement pour prévenus et accusés, la cellule individuelle était une salle d’attente où le détenu « présumé innocent » était censé être préservé de la vie sociale carcérale. Il n’y avait donc aucun « traitement pénal », aucune activité. Le plan était entièrement conçu pour rationaliser la gestion d’un nombre de plus en plus important de détenus avec le minimum de personnels. Puis on s’est dit : « Le prévenu a attendu un mois son procès, il peut bien attendre quelques mois de plus sa libération s’il est condamné à une courte peine ». Des ateliers ont alors été intégrés dans les plans. La maison d’arrêt devenait ainsi, pour partie, un établissement pour peine. La cellule judiciaire du prévenu devenait, sans modification, la cellule pénitentiaire du condamné. Et, dans tous les cas, les responsables politiques étaient dispensés de réfléchir à ce qui constitue réellement la peine de prison, à savoir le mode de vie qu’on impose aux occupants de ce lieu, avec ses privations et ses ressources. Les pratiques pénitentiaires se sont formées dans ce modèle de maison d’arrêt et les établissements pour peine construits depuis s’en inspirent directement.
La doctrine pénitentiaire se refuse à envisager un projet de vie sociale ou collective en détention, alors que cette dimension devrait être au cœur de la conception d’un établissement.
Cette absence de réflexion, que vous qualifiez de « trou noir de la pensée », s’explique-t-elle simplement par cette priorité politique accordée à la maison d’arrêt ?
Il y a autre chose de plus profond et de plus tenace qui tient à la nature même de la doctrine pénitentiaire. Celle-ci est une récupération politique, un détournement de la notion religieuse de pénitence selon laquelle le pécheur est seul responsable de sa peine. En responsabilisant le détenu, en affirmant qu’il doit être « acteur de sa peine », qu’il « fait sa peine » la doctrine déresponsabilise le pouvoir politique qui punit. A partir de cette imposture intellectuelle, la réflexion sur la conception de la peine que nous infligeons est totalement évacuée au profit d’interminables discours plus ou moins démagogiques sur le sens de la peine: dissuasion, rétribution, réparation, réinsertion, lutte contre la récidive. De là vient le dogme de l’individualisation de la peine appliqué en prison alors qu’elle est, que cela plaise ou non, une peine collective. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant de constater que, dans la loi pénitentiaire de 2009, le Parlement n’a rien à dire concernant la conception des nouveaux établissements en dehors de la vidéosurveillance dans les espaces collectifs. Or, lorsque le promoteur d’un projet de construction ne définit pas de projet de vie, l’architecture devient forcément contre-nature, il lui manque une dimension essentielle. Tout projet architectural est bâti sur une idée de la vie que l’on souhaite permettre dans ce nouveau lieu. Or la doctrine pénitentiaire se refuse à envisager un projet de vie sociale ou collective en détention, alors que c’est précisément cette dimension qui devrait être au cœur de la conception d’un établissement.
Quelles sont les conséquences sur l’architecture carcérale de la généralisation de la vidéosurveillance « dans les espaces collectifs présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes », prévue par la loi pénitentiaire de 2009 ?
Il s’agit d’« une simple idée de technologie », pourrait-on dire en paraphrasant Jérémie Bentham quand il vantait au monde entier son modèle panoptique comme étant « une simple idée d’architecture ». On est en droit de s’interroger sur l’effet que peut produire une vie sociale sous vidéosurveillance pendant des mois ou des années. On force des personnes à vivre sous vidéosurveillance lorsqu’elles sont en groupe, alors qu’on est censé les préparer à vivre à l’extérieur. Je suis ainsi convaincu de l’incohérence de l’article 58 sur la vidéosurveillance avec l’article premier de la loi, qui confie à l’administration la mission de « préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ».
Les prescriptions des cahiers des charges des nouveaux programmes, écrivez-vous, « permettent à l’architecte de travailler, en les respectant, mais elles ne dévoilent pas les intentions réelles du client. Le projet, dans son essence, n’est pas dit. » Est-ce une manifestation de ce « trou noir de la pensée » ou y-a-t-il un projet « non dit » ?
En l’absence d’un débat démocratique sur la question: « quelle peine de prison, quelle vie souhaitons-nous instaurer en prison ? », l’administration pénitentiaire fait ce qu’elle veut, ou ce qu’elle peut, on ne saurait le lui reprocher. Pour elle, un projet de nouvelle prison doit être compatible avec ses pratiques, conforme à la législation, adapté à ses personnels, et donc très semblable à la majorité des établissements existants. N’ayant aucune compétence politique pour changer de modèle carcéral, elle est nécessairement conservatrice, quelles que soient les améliorations qu’elle envisage. Alors, le cahier des charges qu’elle établit décrit très précisément les dispositions architecturales qui figuraient dans celui établi pour la précédente réalisation, en y intégrant les modifications qui lui paraissent souhaitables. Evidemment, la philosophie de ce modèle, dont elle n’a pas à être responsable, n’apparaît jamais. A l’inverse, le projet du CD de Mauzac a bénéficié d’une intervention politique très forte sur la philosophie générale du temps de détention, ce qui s’est traduit dans le cahier des charges par une définition claire de la fonction sociale de chaque partie de l’établissement.
Au centre de détention de Mauzac, dont vous avez assuré la conception avec Noëlle Janet, les hébergements pavillonnaires comprennent cuisine commune et lieux de rencontre, les détenus ont la clé de leur cellule… L’argument opposé à la multiplication de ce type de prisons est qu’elles ne conviendraient qu’à un petit nombre de détenus triés sur le volet. Que répondez-vous ?
Je réponds que c’est faux. Et à l’époque, beaucoup de personnels pénitentiaires le pensaient aussi. Dans les prisons fédérales canadiennes, 60 % des condamnés peuvent vivre de cette façon. Ce qui est en revanche complètement irréaliste, pour ne pas dire « angélique », mais bien conforme à la doctrine pénitentiaire, c’est de croire qu’il est possible de n’accueillir en prison que la partie criminogène des arrivants, leur péché en somme, afin de la faire traiter par des spécialistes cliniciens et criminologues. Ce faisant, on oublie l’essentiel. La réalité est qu’il faut bien les accueillir et les faire vivre dans la globalité de leur être, avec leurs désirs, leurs goûts, leurs capacités de réflexion, leurs qualités et leurs défauts. C’est toute cette matière humaine ordinaire, qui constitue le quotidien de la vie en détention, qui devrait être prise en compte, dans la conception de la communauté carcérale. Cette idée – révolutionnaire ? – a émergé juste après l’abrogation de la règle du silence en 1972 : puisque les détenus peuvent désormais se parler, ils pourraient également « vivre » ensemble. En fait, les détenus n’avaient pas attendu 140 ans pour communiquer entre eux et pour se resocialiser avec les moyens du bord, c’est-à-dire illicites. La nouveauté était la reconnaissance officielle de la vie collective et la volonté de l’organiser. C’est ainsi qu’il y a eu des tentatives d’ouverture des cellules à certaines heures, la coursive faisant office d’unité de vie. Mais l’architecture existante n’était pas adaptée et les personnels n’étaient pas non plus formés pour que cela marche. La conception du centre de détention de Mauzac a élargi ce concept de « vie sociale » à l’intérieur de tout le centre, dans des infrastructures adaptées.
De quelle manière le programme 13 000 lancé en 1987, a-t-il « marqué un point d’arrêt à la volonté de changer la vie en détention » ?
Les décideurs politiques ont voulu faire preuve d’efficacité en réalisant un vaste programme immobilier dans un délai relativement court et avec un souci d’économie, en construction comme en gestion. A cette fin, ils ont considéré que la prison n’était qu’une addition de prestations nécessaires et suffisantes qu’il fallait précisément identifier pour les faire chiffrer, puis gérer, par des opérateurs privés. Le système pénitentiaire s’est alors trouvé divisé : un système régalien assuré par l’administration pénitentiaire en charge de la direction, de la gestion et de la sécurité ; tout le reste (formation, santé, travail…) pouvait être délégué à des prestataires de service. De ce fait, les prérogatives de l’AP se sont trouvées concentrées et renforcées sur la sécurité (agressions, mutinerie, évasions, suicides…) et sur la gestion administrative. La mission de l’administration devait dès lors assurer aux détenus l’accès à ces services de la façon la plus sécurisée possible.
Lorsque le promoteur d’un projet de construction ne définit pas de projet de vie, l’architecture devient forcément contre-nature, il lui manque une dimension essentielle.
Les constructions pénitentiaires réalisées ces dernières décennies font aussi apparaître un gouffre entre les déclarations d’intention des architectes et le vécu des usagers (détenus et personnels). Pouvez-vous l’expliquer ?
L’architecte se situant dans un rapport de travail avec un client ne peut pas se permettre de critiquer le programme quand il est censé le développer. Pour gagner un concours, il faut tenir un certain discours attendu par le client, qui lui-même va l’utiliser pour persuader sa hiérarchie ou le public que son programme a permis l’innovation. Les déclarations d’intention des architectes sont ainsi très souvent biaisées. Il n’est pas rare aussi que, une fois le projet de l’architecte sélectionné, l’administration décide de certaines modifications afin de mieux l’adapter à ses pratiques habituelles. Par exemple, toutes les cours de promenade de notre projet du CP de Ducos en Martinique, initialement prévues engazonnées, ont finalement été bétonnées.
J’ai eu également l’occasion de faire partie d’un groupe de travail en 1994-1995, chargé de faire des propositions pour l’élaboration des futurs programmes. Afin de limiter les circulations et leurs désagréments pour les personnels comme pour les détenus – contrôles, sas, ouvertures à commande électrique, temps d’attente etc. – nous avions proposé de créer, y compris en maison d’arrêt, des quartiers équipés d’activités décentralisés et organisés autour d’un espace extérieur ouvert directement sur les unités de vie, un peu comme à Mauzac. L’AP a retenu l’idée de quartiers relativement autonomes pour avoir moins de déplacements à gérer, mais n’a pas repris l’idée de vie de quartier. Résultat dans le cahier des charges du programme 4 000 : cloisonnements habituels, unités d’hébergement classiques, cour de promenade classique et sentiment de confinement chez les détenus encore plus grand que dans les précédents programmes. Mais encore une fois, tout cela résulte du fait que les responsables politiques et donc les citoyens ont laissé à l’administration la responsabilité de la politique carcérale.
Propos recueillis par Barbara Liaras