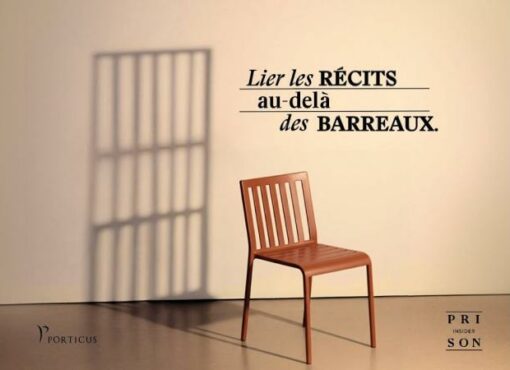Dans une thèse soutenue en 2019*, la sociologue Marine Quennehen explore le traitement très genré de la parentalité en prison. Contrairement à la maternité, valorisée mais étroitement contrôlée, elle décrit une paternité reléguée aux marges de la détention, placée sous le sceau du soupçon et volontiers disqualifiée. À rebours des idées reçues, elle observe une grande diversité dans l’attitude des pères incarcérés à l’égard de leurs enfants – et suggère que le désintérêt le plus patent est celui de l’institution.
Qu’est-ce qui vous a poussée à vous intéresser à la paternité en détention ? Et comment votre démarche a-t-elle été reçue ?
Marine Quennehen : La première fois que je suis rentrée en détention, je participais aux entretiens psychologiques avec les prisonniers au sein du SMPR [service médico-psychologique régional]. J’ai été surprise de voir que la question de la famille était peu abordée, cela me semblait contre-intuitif. Des études montraient d’ailleurs que la moitié des hommes incarcérés étaient des pères : pourquoi si peu d’attention à la question, alors que la maternité est un sujet prédominant dès que l’on s’intéresse aux femmes en prison ?
Quand j’ai commencé à travailler sur la paternité des prisonniers, je me suis tout de suite heurtée à ce discours : « Si ça les intéressait, ils ne seraient pas là ! Ils vont essayer de se victimiser, de t’amadouer… » Les prisonniers ont si peu de moyens d’obtenir des avantages que s’ils peuvent s’appuyer sur la paternité, pourquoi pas, mais je ne pouvais pas croire que tout se résume à cela. Et pourtant, chaque fois que je me présentais dans un nouvel établissement, la réaction était assez semblable : « Pourquoi s’intéresser à ce sujet ? Qu’est-ce qu’ils vont bien pouvoir vous en dire ? » Avec souvent un fort mépris de classe : « Ils font des enfants comme des lapins… » Bien sûr, beaucoup de surveillants et de Cpip [conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation] étaient tout simplement sous l’eau et n’avaient pas les moyens de traiter cette question. Mais d’une manière générale, force était de constater que la paternité suscitait un grand désintérêt.
Au premier abord, de nombreux prisonniers semblaient eux aussi rejeter l’idée de se définir en tant que pères. Mais finalement, j’ai eu l’impression que la plupart appréciaient de pouvoir avoir cette discussion. C’est revenu souvent dans leur bouche : « On ne s’intéresse jamais à moi de ce point de vue-là. » Ce n’est pas ce qui est attendu, en détention, de se présenter d’un point de vue émotionnel, vulnérable. Nos entretiens constituaient un rare espace où c’était possible.
Vous observez que la paternité a peu de place dans les échanges quotidiens entre personnes détenues et agents pénitentiaires, contrairement à la maternité. Comment l’expliquez-vous ?
Les travaux de Coline Cardi et de Myriam Joël[1], notamment, ont bien montré que la quasi-absence de mixité en détention de femmes aboutit à la constitution d’un entre-soi féminin, et qu’on attend des surveillantes qu’elles adoptent une posture sensible, une certaine capacité à susciter la confidence. Cette proximité est aussi le résultat de facteurs structurels : des prisons plus petites, où les échanges sont plus quotidiens… Détenues et surveillantes se voient, se connaissent ; ce n’est pas comme à Fresnes, où l’on a du mal à reconnaître un surveillant d’un jour sur l’autre. Le fonctionnement carcéral en détention féminine favorise donc de tels échanges.
Le contrecoup, d’après ces travaux, c’est un surcontrôle de la maternité : les prisonnières doivent se définir avant tout comme mères. Et si l’on considère qu’elles n’ont pas les dispositions pour bien s’occuper de leurs enfants, cela conduit à une prise en charge particulière pour les pousser à se conformer au rôle de la « bonne mère ». Les activités proposées au sein de la détention féminine sont souvent tournées vers le foyer. Pour travailler sur le logement, l’emploi, c’est plus compliqué.
C’est l’inverse chez les hommes, où l’on considère – tout comme dans la population générale – que la paternité est moins importante que la maternité. Les prisons d’hommes sont souvent tellement énormes, avec une telle surpopulation et un souci sécuritaire tellement fort, que ce ne sont de toute façon pas des espaces adaptés. Par ailleurs, les professionnels que j’ai pu rencontrer attendaient généralement des prisonniers qu’ils se comportent « comme des hommes », c’est-à-dire qu’ils ne se plaignent pas, qu’ils ne fassent pas preuve de « sensiblerie », etc. Si un prisonnier était triste de quitter ses enfants en sortant du parloir, il était immédiatement rappelé à l’ordre pour ne pas le montrer. Ce qui est attendu de la part des femmes est donc refusé aux prisonniers hommes, parce que cet espace où la « virilité » est attendue, normalisée, n’est pas propice à l’expression d’un sentiment paternel.
Par ailleurs, pour beaucoup de prisonniers, stigmatisés avant même leur entrée en détention du fait de multiples facteurs d’exclusion, se présenter sous une posture ultra-virile, en mettant par exemple en avant un parcours délictueux héroïsé, est une façon de se revaloriser et de renverser le stigmate.
Vous affirmez qu’en détention de femmes, la parentalité est omniprésente et la sexualité reléguée, tandis que chez les hommes, c’est l’inverse. Qu’entendez-vous par là ?
Mes collègues qui ont travaillé en détention de femmes soulignent que le statut de mère y est le statut suprême. Les pouponnières sont la vitrine des prisons, alors que très peu de femmes sont incarcérées avec leur enfant. Les femmes incarcérées sont incitées à se présenter comme mères dans toute la détention : dans les espaces communs, leurs rendez-vous avec les agents, les activités qui leur sont proposées… Myriam Joël rapporte que dès le début de ses entretiens, les femmes se décrivaient comme mères, avant de parler d’elles-mêmes. Tous ces travaux ont donc montré que la maternité se déployait dans tous les espaces de la prison, et non juste dans les pouponnières ou les parloirs.
À l’inverse, chez les hommes, on me disait que m’intéresser à la paternité ne servait à rien, que cela n’avait pas de sens. Et quand je demandais aux prisonniers s’ils pouvaient parler du fait qu’ils étaient pères avec les surveillants ou leurs codétenus, beaucoup me disaient : « Absolument pas, ils savent que j’ai des enfants, mais ça s’arrête là. » Ils ne pouvaient pas se permettre de se raconter davantage. Il ne leur restait plus que le parloir et l’UVF [unité de vie familiale] pour vivre leur paternité, elle ne pouvait pas dépasser ces espaces-là. À la fin du parloir, plusieurs me racontaient qu’ils devaient tout de suite se remettre « en mode prisonnier ». Cela donnait vraiment un sentiment de scission totale entre les espaces.
Le discours sur la sexualité, en revanche, était diffus, omniprésent, il pouvait donner lieu à des joutes avec les surveillants… C’était sans doute exacerbé par le fait que je sois une femme, avec une certaine volonté de me choquer. Mais du moins, c’était autorisé de parler de sexualité de manière crue, alors qu’en détention de femmes, Myriam Joël soulignait à quel point c’était négocié, un peu clandestin, réprimé, déconsidéré… C’est ce contraste que j’ai voulu rendre visible.
Vous soulignez la diversité des discours sur la paternité des personnes détenues avec lesquelles vous vous êtes entretenues. Pouvez-vous nous en donner une idée ?
Beaucoup décrivaient ce que j’ai appelé une « paternité marginale[2] », peu préparée, inscrite dans des conjugalités assez fragiles, qu’ils avaient peu endossée et mise en pratique avant l’incarcération. Or, la détention est un espace compliqué pour apprendre à le faire. L’autre extrémité, c’était la « paternité-ressource », parfois idéalisée, mais qui pouvait servir d’appui pour imaginer la suite. Ces pères avaient cependant bien conscience de ne pas vraiment pouvoir la valoriser hors de nos entretiens, et que s’ils faisaient une demande de libération conditionnelle parentale, par exemple, elle avait peu de chances d’aboutir.
Certains parlaient très difficilement de leurs enfants, parce qu’ils n’avaient aucun lien avec eux, voire étaient en rupture généralisée de liens sociaux : ce que j’ai appelé la « paternité suspendue ». Et d’autres encore vivaient une « paternité brisée », très investie et même placée au cœur de leur trajectoire avant leur incarcération, puis interrompue de façon très douloureuse par la prison.
L’idée de cette typologie n’est pas de caractériser, de figer, mais au contraire de montrer qu’au-delà des clichés sur les pères incarcérés, supposés désengagés et indifférents, les attitudes sont en réalité variables et peuvent évoluer selon la trajectoire de chacun, le moment dans la peine, etc. Qu’il y a par exemple des « paternités marginales » au départ qui deviennent « ressources » avec le temps, des éléments biographiques qui peuvent contribuer à faire changer les perceptions.
Quelles attitudes avez-vous observées à l’égard de la paternité des personnes détenues parmi les différents professionnels intervenant en détention ? Vous soulignez une tension entre les logiques de maintien des liens et de protection des enfants, pourriez-vous y revenir ?
Cela mériterait une enquête approfondie sur les trajectoires professionnelles de chacun. La plupart des surveillants que j’ai côtoyés ne savaient pas trop quoi faire de la paternité des prisonniers et n’avaient de toute façon pas le temps de s’y intéresser – sauf dans certains espaces, notamment les prisons plus petites, plus « familiales ». De nombreux Cpip me semblaient plutôt frileux à prendre en charge cette question, avec beaucoup de suspicion et cette crainte de pénétrer dans l’intimité des hommes. Des effets de génération pouvaient jouer : les Cpip les plus âgés paraissaient souvent plus réticents que les jeunes à considérer que c’était une ficelle à tirer. Mais de toute façon, quand un Cpip a 80 ou 100 dossiers à suivre en même temps, ce n’est pas évident de le faire. Surtout que les liens familiaux ne rentrent pas dans une grille d’évaluation quantifiable, mesurable… On peut mesurer si la personne verse bien les indemnités qu’elle doit à ses parties civiles, mais quant à savoir si elle s’intéresse à ses enfants… Des Cpip tentaient de le faire en regardant si elle leur envoyait des mandats, mais cela me semble un critère assez faible pour évaluer l’intérêt qu’on porte ou non à ses enfants, surtout au regard des possibilités de travailler en prison et d’envoyer de l’argent à sa famille.
De nombreux surveillants et soignants partageaient l’idée que la prison n’est pas un espace pour les enfants, et que dans la mesure du possible, il vaut mieux les en protéger en les maintenant à distance. En revanche, chez les professionnels travaillant sur le soutien à la parentalité, j’ai plutôt entendu le discours selon lequel il est malgré tout nécessaire de confronter les enfants à ce qu’est leur père, à leur histoire familiale, pour éviter la mise en place d’un récit imaginaire.
Quelles attitudes avez-vous observées à l’égard des « bébés-parloirs », conçus en détention ?
Je n’ai suivi que quelques cas, mais pour certains pères concernés, ces bébés représentaient un second souffle, un peu d’espoir, de motivation à sortir plus vite, même s’ils se sentaient souvent coupables de faire vivre cela à l’enfant et à leur conjointe. Cela dit, ils étaient confrontés à de grandes difficultés. Un prisonnier n’arrivait pas à obtenir sa reconnaissance de paternité, et il vivait cette attente comme une forme de punition, une manière de lui rappeler qu’on n’est pas censé faire des enfants en étant incarcéré. Mon impression générale est que c’était décrié. D’autant que les couples qui avaient réussi à « passer entre les gouttes » révélaient ce qui pouvait être perçu comme un mauvais fonctionnement de l’établissement.
Je me souviens d’une Cap [commission de l’application des peines] lors de laquelle un père qui avait fait un bébé-parloir demandait à sortir pour l’accouchement. Il s’est vu répondre : « Vous n’aviez pas à faire d’enfant en prison, ce n’était ni l’endroit ni le moment. Et si Madame arrive à s’en sortir avec les autres enfants, elle arrivera à s’en sortir avec celui-là. » De manière générale, quand des hommes demandaient des permissions de sortir pour aller voir leurs enfants ou leur conjointe qui venait d’accoucher, on ne les croyait pas. Et pour demander une conditionnelle parentale, il fallait pouvoir justifier d’avoir vécu au moins six mois avec l’enfant, et que la situation familiale rende nécessaire la présence du père : maladie grave de l’enfant, incapacité de la mère de s’en occuper… Donc s’agissant d’un bébé-parloir, c’était généralement impossible.
Quel regard portez-vous sur la prise en charge de la paternité en détention ?
C’est très dommage qu’il y ait si peu d’accompagnement : cela aurait tellement de sens dans le cadre d’un travail global ! Il ne s’agit pas de maintenir les liens familiaux à tout prix, je comprends bien que la séparation est parfois primordiale. Mais il est possible de travailler ces liens sans forcément mettre directement les personnes en relation.
Un Cpip impliqué dans des ateliers de soutien à la parentalité soulignait que ne pas travailler cette question contribuait à ce que ces hommes idéalisent fortement le lien parental, de façon totalement déconnectée de ce que pouvaient vivre leurs enfants, en imaginant qu’ils retrouveraient automatiquement leur place auprès d’eux en sortant. Travailler avec les prisonniers sur leur paternité lui semblait donc essentiel pour mieux préparer leur sortie et anticiper des incompréhensions, voire d’éventuelles violences. Pour travailler sur la masculinité, aussi. Mais ce Cpip m’a appris plus tard qu’il avait dû mettre fin à ces ateliers, parce que l’administration pénitentiaire n’était pas convaincue de leur utilité : « Qu’est ce qu’on peut mesurer à la fin, qu’est ce qui a vraiment changé ? » Toujours cette difficulté à évaluer les liens. Alors on l’incitait plutôt à travailler avec les hommes rencontrant des problèmes d’alcool au volant, parce que les protocoles d’évaluation étaient plus faciles à mettre en place.
Entretien recueilli par Johann Bihr
Cet article est paru dans la revue DEDANS DEHORS n°121 – Décembre 2023 – « Ils grandissent loin de moi » : être père en prison
*Marine Quennehen, La paternité « ordinaire » en prison, thèse soutenue le 13 décembre 2019 à l’EHESS.
[1] Voir par exemple : Myriam Joël, La sexualité en prison de femmes, Presses de Sciences-Po, 2017 et Coline Cardi, La déviance des femmes. Délinquantes et mauvaises mères : entre prison, justice et travail social, Université Paris Diderot Paris 7, 2008.
[2] Marine Quennehen, « Expérience carcérale et exercice de la paternité : le point de vue de pères détenus », Champ pénal/Penal field, no 16, 15 février 2019.