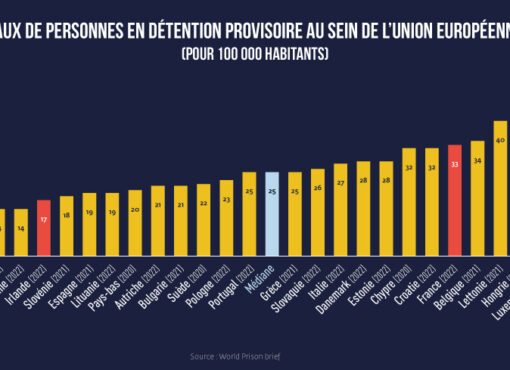Parce que les structures pénitentiaires françaises restent « défaillantes » et l’administration peu encline à y admettre le regard extérieur, un contrôle « militant et critique » reste de mise, relève Sandra Lehalle. Au Canada, la tradition d’ouverture des prisons vers la société favorise une approche consultative et collaborative. La criminologue dresse une étude comparative des modalités de contrôle à l’oeuvre dans les deux pays.
Un membre du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) que vous avez interviewé a qualifié la France « d’Etat récalcitrant » à l’égard des contrôles. Qu’entendait-il par là ?
Il évoquait une certaine attitude « à la française », qui n’aime pas recevoir de critiques telles que celles formulées par le CPT, surtout venant de pays considérés moins importants sur la carte géopolitique. Il y a ainsi de véritables fins de non recevoir de la France face à certaines recommandations. Par exemple, le CPT recommande depuis très longtemps une présence soignante dans les prisons la nuit. Depuis 1997, la France dit non ! Beaucoup d’exemples concrets montrent que le CPT ne réussit pas à faire fléchir les positions des autorités pénitentiaires. Ce commentaire du membre du CPT avait été fait dans un contexte particulier : suite à une fuite du rapport du Comité, le ministre de la Justice de l’époque [Dominique Perben] avait critiqué son contenu, invoquant des erreurs, des approximations, des recommandations inadaptées à la France… Ces attitudes demeurent sources de tensions, même si le ministre change. Et la France reste un mauvais élève, qui attend toujours le délai maximum d’un an avant de répondre au rapport de visite du CPT, le publie un an et demi, voire deux, après la visite…
Cette réticence des autorités française à l’égard des regards extérieurs se manifeste-t-elle sur les autres formes de contrôle ?
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté n’est fonctionnel que depuis 2008 – alors que l’enquêteur correctionnel, son pendant canadien, existe depuis 1973. L’intervention de la société civile n’est pas non plus perçue de la même manière dans les deux pays. Par exemple, nous avons à l’Université un projet de cours qui va se donner en détention, avec des élèves pour moitié détenus et pour moitié étudiants qui viendront à la prison. L’administration pénitentiaire ne fait pas obstacle, bien au contraire ! La même initiative serait très compliquée à mettre en œuvre en France.
En quoi les « contrôles citoyens » sont-ils différents aujourd’hui dans les deux pays ?
L’activisme militant sur les prisons tel qu’il existe en France se trouve peu au Canada, où, en revanche, le bénévolat est très répandu. L’intervention des citoyens n’a pas la même optique, car elle ne rencontre pas les mêmes obstacles : depuis les années 1970, le Canada a mis en place des programmes et structures pénitentiaires qui restent très défaillants en France. Les pénitenciers sont ouverts à la société, aux contrôles. Peu de personnes y sont opposées. Depuis cette époque, les comités consultatifs de citoyens intervenant en prison ont joué un rôle important.
Quel est leur rôle ?
Ces comités sont gérés et orchestrés par le service pénitentiaire : le directeur sélectionne les membres, considérés comme des citoyens partenaires. Ils sont présents dans l’établissement, peuvent s’y déplacer et sont consultés pour certaines décisions. L’idée est d’intégrer des membres de la communauté à la vie de la prison et aux décisions et aussi, d’intégrer l’établissement pénitentiaire au sein de la communauté.
Leur rôle n’est pas de critiquer le système, ils essaient de changer les choses à l’intérieur, cherchent des solutions.
Je n’ai jamais vu un membre d’un comité consultatif citoyen dénoncer dans la presse. N’y a-t-il rien à dénoncer ? Je ne me risquerais pas à le dire. Sont-ils institutionnalisés ? Peut-être.
Leur troisième rôle, c’est d’être des agents de liaison avec la communauté, afin d’informer le grand public. Par exemple, lors de la libération conditionnelle d’un cas médiatique, ils peuvent intervenir dans les médias pour rassurer. Ils sont porte-parole de ce qui se passe à l’intérieur, pour l’expliquer à la société. Le comité se réunit tous les mois, mais chaque membre peut aller en détention autant que de besoin, selon le dossier dont il s’occupe.
Ont-ils des liens avec les comités de détenus ?
Ils les rencontrent à chaque visite. Les comités de détenus sont des interlocuteurs privilégiés pour s’informer, et ils sollicitent aussi les comités citoyens. Dans les deux cas, il y a l’idée de consulter, d’impliquer dans les décisions de l’établissement.
C’est la philosophie du système correctionnel canadien.
Les détenus ont un avis à donner sur les décisions prises. Ce qui ne veut pas dire qu’on les écoute à chaque fois.
Existe-t-il des associations indépendantes ?
L’Office des droits des détenus a été très actif dans les années 70-90, mais il a aujourd’hui quasiment disparu. Les associations s’impliquent pour soutenir les femmes judiciarisées et incarcérées, ou dans l’aide à la réinsertion sociale. Notamment les maisons de transition, qui offrent un hébergement, une aide à la recherche d’emploi pour les personnes en libération conditionnelle. Mais des ONG critiques comme l’OIP, on n’en a pas !
L’« enquêteur correctionnel » canadien joue-t-il un rôle similaire à celui du Contrôleur général (CGLPL) en France ?
L’enquêteur correctionnel est un hybride du CGLPL et du Défenseur des droits. Il s’occupe de la gestion des griefs, des litiges. Il joue un rôle de médiateur plus que de contrôleur ou de critique d’un système. Mais il peut également enquêter lorsqu’il constate un problème systémique. Son intervention ressemble alors davantage au CGLPL. Il reçoit les vidéos réalisées dès lors que des agents correctionnels utilisent la force au cours d’une intervention. Il est aussi informé de chaque décès. Dans une affaire récente, son enquête sur le décès d’une jeune femme en détention a déclenché une enquête du Coroner [officier public nommé par le gouvernement pour enquêter sur certains décès, ndlr] puis un procès, qui a fait l’objet d’une médiatisation à grande échelle.
Comment fonctionne cette instance ?
Elle intervient dans les 150 prisons fédérales, celles prévues pour les peines supérieures ou égales à deux ans. Une trentaine d’enquêteurs assure une à deux fois par mois des permanences dans les établissements qui leurs sont assignés, pour les détenus et les membres du personnel. Ils peuvent aussi être appelés sur un mode plus réactif, pour apaiser des tensions qui auraient pu, sans leur intervention, dégénérer en mini-soulèvement ou en mini-émeute. La problématique de l’enquêteur correctionnel – à la différence du CGLPL – c’est qu’il est chapeauté par le même ministère que le service correctionnel.
Ils ont le même boss, lui et le directeur de la prison.
Pour l’indépendance, ce n’est pas l’idéal. Je ne pense pas que cela ait un impact sur la qualité du travail, mais plus sur le suivi des recommandations. Au lieu de remettre son rapport au Parlement, ce qui serait l’idéal, il le remet au ministre… qui décide de l’allocation des fonds !
Quels contrôles sont prévus dans les prisons provinciales, où les conditions de détention sont plus dures ?
Des ombudsmans provinciaux interviennent, mais ils ne sont pas spécialisés en matière pénitentiaire, et desservent toutes les administrations provinciales. Cependant, les détenus sont à l’origine d’une grande proportion des requêtes qu’ils reçoivent et certains désignent des équipes ou personnes spécifiques pour gérer ces problématiques. Leur implication varie selon les provinces et les besoins (certains font des visites sur place, des rapports spécifiques sur la détention, d’autres pas). Les contrôles citoyens et politiques sont eux aussi très variables selon les provinces.
Cette question pourrait expliquer que le Canada n’a toujours pas signé le protocole de l’ONU auquel est rattaché le sous-comité de prévention de la torture (OPCAT). Car il faudrait, pour se conformer au Protocole, uniformiser le contrôle d’un bout à l’autre du territoire. Il semble que ce soit l’enjeu qui retarde cette ratification : qui fera quoi (un organisme national ou un par province) et surtout qui payera la facture (le fédéral ou les provinces) ?
Les « contrôles politiques » exercés par les parlementaires fonctionnent-ils de la même façon dans les deux pays ?
Il y a beaucoup plus d’intérêt et de mobilisation des parlementaires français, surtout suite aux commissions d’enquêtes dans lesquelles beaucoup se sont impliqués en 2000. Certains se sont sentis investis de poursuivre le travail, par exemple par des visites – ils y ont été encouragés par des associations. Au Canada, ils ont le même droit, mais c’est extrêmement rare de les voir visiter un établissement. Ce n’est pas dans leurs priorités et c’est très peu médiatisé. Les médias canadiens parlent très rarement des conditions de détention, alors qu’en France, c’est récurrent.
Il est souvent reproché aux instances de contrôle supranationales leur impact limité, vos observations vous conduisent-elles à cette même conclusion ?
Ces instances n’ont en effet pas de pouvoir contraignant. En amont, c’est l’Etat qui décide de s’y soumettre ou non. Ce sont souvent des enjeux politiques qui font que l’Etat accepte d’être contrôlé, de crainte d’être mal vu. En aval, c’est aussi l’Etat qui décide de mettre en œuvre le contrôle, de bien le recevoir, de publier les rapports. Il établit ainsi les limites dans lesquelles il accepte d’être contrôlé.
Les fruits ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ces contrôles sont néanmoins importants : ils participent à l’élaboration de normes relatives aux conditions de détention et de traitement des détenus ; des normes ensuite relayées et utilisées par d’autres. Le CPT s’est emparé de la flexibilité de son mandat pour l’étendre aux conditions de détention, sans se limiter à la torture et aux traitements inhumains et dégradants.
Il a ainsi contribué à ce que les conditions de détention en elles-mêmes puissent être assimilées à des traitements inhumains et dégradants.
Les rapports du CPT fournissent enfin des outils de formation, des méthodes de travail. Des ONG utilisent ces normes, qui influent sur les autres mécanismes de protection : l’œuvre accomplie par le CPT se retrouve dans les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme. Les Etats introduisent des changements en rapport avec leurs recommandations, sans le reconnaître explicitement. Il serait injuste d’évaluer leur impact uniquement en regardant si les Etats ont appliqué les recommandations et dans quels délais.
Les mécanismes de contrôle, dans leur diversité, parviennent-ils faire évoluer les pratiques pénitentiaires ?
L’action conjuguée des différents mécanismes permet d’obtenir un impact. Les contrôles sont très divers, dans leurs méthodes de travail, leurs objectifs, mais aussi dans leur type : politique, scientifique, de proximité. On constate cependant que leurs conclusions et recommandations se rejoignent ; ce sont les mêmes problématiques qu’ils dénoncent au gouvernement, qui ne peut éternellement faire la sourde oreille.
Si le CPT, l’OIP, le CGLPL, envoient le même message, ils parviennent à se faire entendre.
Mais il faut veiller à ne pas devenir un outil de légitimation. Il est important de veiller à ce que l’Etat et le service pénitentiaire ne s’emparent pas de ces mécanismes de contrôle pour paraître meilleurs qu’ils ne sont, et évitent de se questionner par exemple sur ces peines si longues. On peut craindre que cette ouverture à la société occulte les questions de fond : que fait-on avec les prisons ? Pourquoi existent-elles ? En a-t-on réellement besoin ? Disposer de nombreux contrôles, agrandir la taille des cellules, ne doit pas empêcher de s’interroger sur l’usage intensif qu’on fait actuellement de la prison.
Recueilli par Barbara Liaras