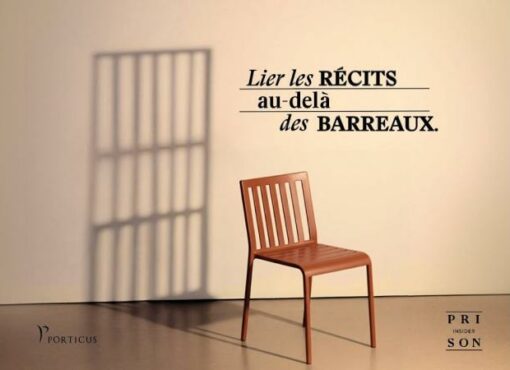Plus de quatre personnes détenues sur dix sont des pères de famille. Une part d'identité souvent occultée dans le système binaire et viriliste organisé par la prison. Comment ces pères et leurs proches vivent-ils cette situation ? Quels liens peuvent-ils entretenir ? Et comment cette réalité est-elle prise en compte par la justice et l'administration pénitentiaire ? Entre silence, suspicion et préjugés, la paternité incarcérée sort de l’ombre.
« C’est dur de savoir que mon fils grandit loin de moi », écrit Monsieur C., incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin. Comme lui, pas moins de 44 % des hommes détenus déclaraient avoir au moins un enfant au 1er septembre 2023[1]. Mais au-delà de ce constat, les données précises sur ces pères incarcérés et leurs familles restent rares. Le nombre d’enfants concernés, quant à lui, ne fait l’objet que d’extrapolations[2]. La dernière grande enquête statistique sur la paternité en prison remonte à 2002[3] : « Les détenus sont aussi souvent pères que les autres hommes et ils ont un plus grand nombre d’enfants », relevait alors l’Insee, qui notait que pour beaucoup, « ils ont été pères plus jeunes » et « ont élevé des beaux-enfants plus souvent que les autres hommes ».
Si le droit au maintien des liens familiaux en prison a été consacré par une loi pénitentiaire en 2009, le regard sur la parentalité des personnes détenues est encore très genré. Au 1er décembre 2023, 96,6 % des personnes détenues sont des hommes[4] – mais ce sont les pouponnières, accueillant quelques dizaines d’enfants en bas âge avec leur mère, qui sont souvent érigées en vitrines de la parentalité en détention. Si « la maternité est envisagée comme un levier de réinsertion, […] les hommes incarcérés sont d’abord pensés par les professionnels comme des détenus et non comme des pères », observent les sociologues Marine Quennehen et Anne Unterreiner, au terme de deux enquêtes en milieu carcéral[5] (voir l’article « on m’a dit que m’intéresser à la paternité ne servait à rien », Dedans Dehors N°121). « Quand la paternité est assumée par les pères, elle semble être, dans la majorité des cas, l’objet d’un stigmate […], une correspondance étant établie entre délinquance et irresponsabilité parentale. »
Ce peu de considération, que les deux sociologues ont notamment mis en évidence dans les interactions quotidiennes entre personnes détenues et surveillants, se retrouve aussi dans le traitement des demandes d’aménagement de peine (voir article « La parole de l’enfant doit être entendue », Dedans Dehors N°121) ou de permissions de sortir (voir l’encadré de l’article « Voir son enfant en prison : un parcours d’obstacles », Dedans Dehors N°121) : quand elle n’est pas passée sous silence, la place des hommes auprès de leurs enfants est fréquemment regardée avec suspicion – et en tout cas, quasiment jamais considérée comme essentielle.
Autant de paternités que de pères incarcérés
Cette relative marginalité serait-elle le reflet d’un désintérêt des pères détenus à l’égard de leurs enfants ? Derrière ce cliché éculé, aucune généralité ne saurait résumer la diversité des vécus de la paternité en prison, qui évoluent souvent au fil du temps (voir l’article « Je suis rayé de sa vie », Dedans Dehors N°121). De part et d’autre des murs, les relations peuvent aussi bien être nourries qu’inexistantes, épisodiques, rêvées, brisées, nouvellement investies… Elles sont marquées par la trajectoire biographique de chaque père détenu, sa relation à l’autre parent, ou encore l’empreinte des faits à l’origine de l’incarcération. Les enfants peuvent être décrits comme une source de joie, de peine, d’amour ou de malaise ; un support affectif pour tenir au quotidien, un motif de fierté retrouvée, un point d’ancrage pour l’avenir, une preuve d’humanité dans la machine carcérale. D’autres pères préfèrent tenir à distance leurs enfants, qu’ils n’aient jamais vraiment eu de relations avec eux ou qu’ils aient du mal à mettre des mots sur ce qui leur arrive, qu’ils en aient trop honte, ou qu’ils cherchent à se protéger, ou les protéger d’un univers carcéral vu comme antinomique avec la paternité. D’autres encore vivent la rupture des liens comme une peine supplémentaire – qu’ils s’y résignent ou fassent tout pour s’y opposer.
Au-delà des parcours des personnes détenues, souvent marqués par la précarité et de multiples ruptures, « le vécu de la parentalité est très dépendant de la réalité carcérale et judiciaire, souligne la psychologue Charlotte Haguenauer, intervenant à Fleury-Mérogis. On ne se vit pas père de la même façon quand on est incarcéré pour deux ou vingt-cinq ans, à trente ou à huit cents kilomètres de chez soi. » Sociologues et professionnels soulignent la différence des problématiques parentales en maison d’arrêt et en établissement pour peine, où la moyenne d’âge est plus élevée et le suivi un peu moins dominé par les urgences de tous ordres, mais où les liens sont souvent mis à mal par des incarcérations plus longues.
Dans tous les cas, « les hommes incarcérés disposent de très peu d’espace pour exprimer leur parentalité, mais quand on leur en donne un, ils le prennent », observe la chercheuse Ariane Amado[6], en évoquant notamment les parloirs, les interventions de différentes associations, ou encore l’affichage de photos en cellule[7]. « Cette facette de leur identité est assez tue en détention, elle touche à l’intime et c’est un point vulnérable, mais ils recherchent d’autant plus les espaces que l’on propose », confirme Benjamin Ourghanlian, éducateur spécialisé de l’association ARS95, qui anime des ateliers sur la parentalité au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. « C’est un moment qu’ils attendent et investissent, où ils peuvent créer une identité commune autour de leur paternité, s’identifier autrement que ce à quoi ils sont souvent résumés, abonde sa collègue psychologue, Lucille Courtot. Cela leur fait du bien d’exister autrement. »
« Derrière les stéréotypes de genre, ce ne sont pas tant les pères qui investissent moins le sujet que les professionnels », résume Ariane Amado. Une négligence qui lui semble révélatrice d’une « conception masculiniste et hétéronormée du “bon père de famille”, qui passe surtout par le rôle de pourvoyeur, donc la réinsertion professionnelle. »
Les liens entravés
Pour les pères comme pour les mères, la parentalité en détention est entravée dans toutes ses dimensions : « Vouloir exercer ses droits et devoirs parentaux est extrêmement compliqué, sans parler de prendre soin de l’enfant au quotidien et de vivre l’expérience intime de la parentalité », résume la psychologue Charlotte Haguenauer, en référence aux trois axes de la parentalité définis par le pédopsychiatre Didier Houzel[8]. En outre, « il est difficile, paradoxal, d’exercer une fonction parentale quand on est soi-même infantilisé par la prison : on n’a plus prise sur rien, on est complètement dépendant d’une institution qui prend toutes les décisions à notre place. » « Être confiné dans un espace clos, où l’autre est nécessairement suspect, nourrit une attitude méfiante et décourage de s’exposer sur un plan affectif », ajoute le psychologue Alain Bouregba, directeur du Relais enfants parents (Rep) d’Île-de-France.

Mais les entraves à la parentalité en détention sont aussi très concrètes. Même quand aucune décision de justice ne l’interdit, la personne détenue dépend largement de l’autre parent pour pouvoir être en contact avec son enfant. Et si celui-ci s’y oppose, peu de recours sont réellement effectifs. Des associations spécialisées, comme les Relais enfants parents, peuvent tenter un travail de médiation pour accompagner l’enfant en détention (voir article « La parole de l’enfant doit être entendue », Dedans Dehors N°121), et le juge aux affaires familiales (Jaf) peut être saisi, mais ses décisions ne sont pas systématiquement exécutées. « Quand l’autre parent s’y oppose, le droit de visite n’est déjà pas simple à mettre en œuvre à l’extérieur, mais en prison, c’est encore plus dur », résume Céline Martinache, coordinatrice de l’association Arlequin, intervenant à la maison d’arrêt de Douai. Ainsi, malgré une autorité parentale pleine et entière et trois jugements du Jaf en sa faveur, Monsieur J., incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, n’a plus aucun contact avec ses deux fils depuis son incarcération en 2015 et n’a jamais vu le troisième, né au début de sa détention.
Il ne suffit pas non plus que l’autre parent soit coopératif pour que le maintien des liens soit effectif. Les visites, en particulier, se heurtent à de nombreux obstacles pratiques (voir l’article voir son enfant en prison : un parcours d’obstacles, Dedans Dehors 121) : les difficultés habituelles, liées à la réservation des parloirs et à la distance géographique, sont décuplées dans le cas des mineurs, qui doivent être accompagnés. Malgré des aménagements ces dernières années, les conditions d’accueil en parloir ordinaire restent souvent hostiles aux enfants et peu propices à des interactions de qualité, à tel point que certains pères préfèrent y renoncer. Les parloirs familiaux et les unités de vie familiale (UVF), qui permettent aux personnes détenues de recevoir leurs proches dans de meilleures conditions, sont encore rares, et leur accès est soumis au bon vouloir des directions d’établissement ainsi qu’à la disponibilité du personnel pénitentiaire.
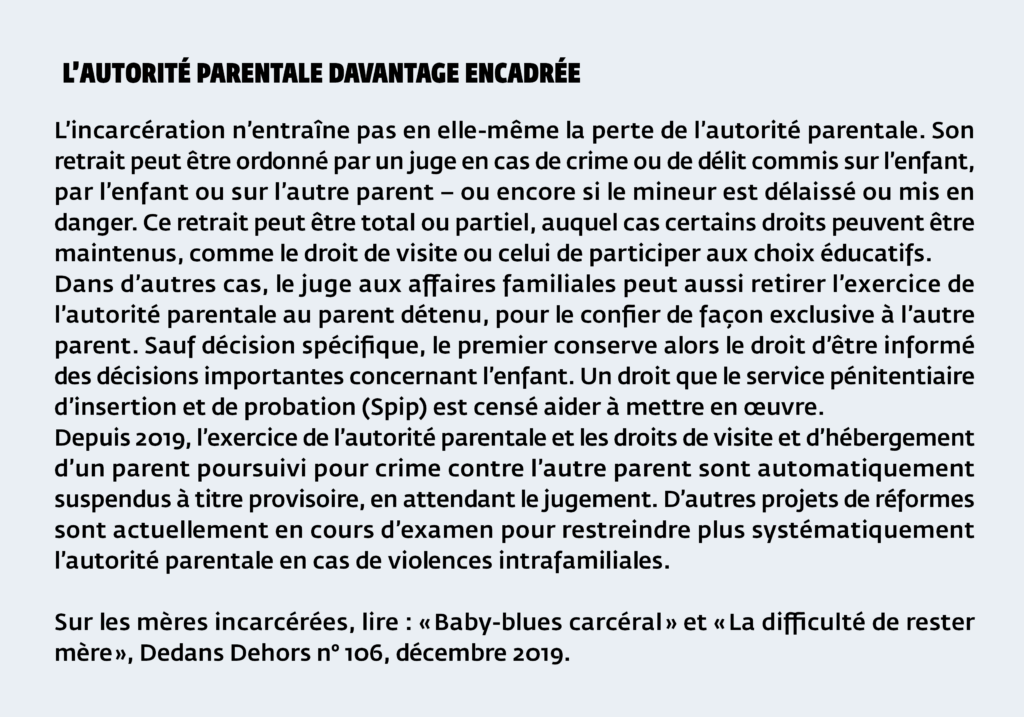
De fait, les personnes détenues se retrouvent largement dépendantes de l’administration pénitentiaire pour pouvoir être en contact avec leurs enfants. Si les refus de permis de visite sont censés être motivés, les explications du chef d’établissement se bornent parfois à l’évocation d’« éléments en [sa] possession ». Ce droit de regard, hors de toute décision de justice, peut se retrouver jusque dans la transmission du courrier : « J’avais écrit une lettre à mon fils, mais elle a été retenue, raconte un père incarcéré au centre pénitentiaire de Caen. Quand j’ai protesté, la directrice adjointe m’a répondu qu’effectivement j’avais le droit d’écrire à mon fils, mais qu’elle doutait de mon appréciation quant aux conséquences que ce courrier pourrait avoir sur lui. »
Cette dépendance est également manifeste quand il s’agit de faire reconnaître les enfants conçus lors des parloirs malgré l’interdiction des relations sexuelles. Si les parents ne sont pas mariés, un officier de l’état-civil doit venir en prison – ce qui suppose le concours de la direction de l’établissement, mais aussi du Procureur de la République pour autoriser le déplacement des registres. Un avocat témoigne : « L’autre jour, le procureur m’a répondu : “Je ne vois pas comment reconnaître la filiation alors que Monsieur est détenu.” Il était dans le déni des bébés-parloirs, faisait semblant de ne pas connaître cette réalité. »
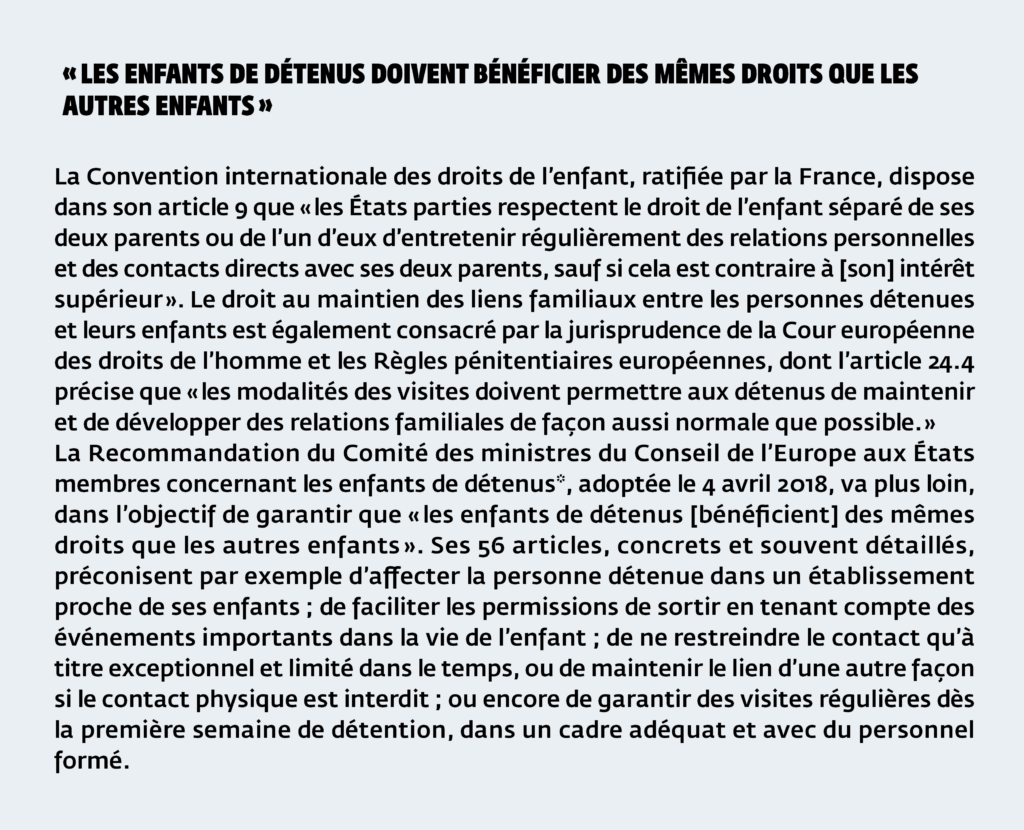
Violences intrafamiliales : quel maintien des liens ?
L’explosion du traitement judiciaire des violences intrafamiliales, ces dernières années, pose avec une nouvelle acuité la question des contacts entre l’enfant et son père incarcéré. Au 31 décembre 2022, plus de 30 % des personnes détenues condamnées l’étaient pour des violences conjugales ou sexuelles[9] – essentiellement des hommes. Une proportion qui, d’après les professionnels, continue de croître à vue d’œil, avec des répercussions évidentes sur le maintien des liens familiaux : « Les faits de violences intrafamiliales s’accompagnent quasi systématiquement d’interdictions de contact et les retraits d’autorité parentale sont de plus en plus fréquents, notamment si l’enfant était présent », observe Estelle Carraud, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (Cpip) à Lutterbach et secrétaire nationale du syndicat Snepap-FSU. En cas de violences conjugales, « l’enfant est fréquemment considéré comme covictime, et les juges comme l’administration pénitentiaire refusent souvent les permis de visite », ajoute Martine Noally, vice-présidente de la Fédération internationale des relais enfants parents (Frepi). Même effet sur les demandes d’aménagements de peine et de permissions de sortir : « Si c’est pour aller voir l’enfant de la victime, c’est quasiment impossible, de peur que ce soit un moyen de contacter la victime, de maintenir une emprise sur elle », rapporte un Cpip du centre de la France.
« L’administration pénitentiaire est prise dans une contradiction, résume Alain Bouregba : elle doit favoriser le maintien des liens familiaux, mais celui-ci est pratiquement impossible quand le père est incarcéré pour violences intrafamiliales. » La question est délicate : au-delà des jugements moraux, dans quels cas l’intérêt de l’enfant commande-t-il la rupture des liens, ou leur maintien ? Impossible d’y répondre autrement qu’au cas par cas (voir article « La parole de l’enfant doit être entendue », Dedans Dehors N°121). « Le juge des enfants considère souvent qu’il faut absolument couper les liens, ou au contraire les maintenir coûte que coûte… Mais il faut avant tout entendre le désir de l’enfant, et non plaquer une décision idéalisée, souligne la psychologue Charlotte Haguenauer. Ce n’est pas la distance physique qui va créer la distance psychique. Certains ont besoin de voir leur parent incarcéré pour se confronter à lui, ou bien pour s’assurer qu’il est vivant… La privation de contact peut parfois compromettre le développement psycho-affectif de l’enfant, ne pas savoir où est son parent peut susciter beaucoup d’angoisse. Le maintien de relations, même à distance, peut permettre de se positionner et d’éviter les écueils de l’idéalisation comme de la diabolisation. » Même si, insiste la psychologue, tout dépend des situations concrètes.
Pour ceux des enfants qui ont besoin de voir leur père incarcéré, les professionnels s’accordent sur l’intérêt de visites accompagnées par un tiers, souvent un bénévole d’une association spécialisée comme les Relais enfants parents. « On sait que certains détenus vont essayer de prendre attache avec la victime pour avoir des nouvelles des enfants, parfois malgré une interdiction de contact. On leur parle des visites médiatisées, pour avoir un cadre qui sécurise tout le monde », témoigne une juge de l’application des peines (Jap) de l’ouest de la France. Les visites accompagnées, qui peuvent être mises en place de façon consensuelle ou ordonnées par un juge, permettent aussi de préparer la rencontre avec l’enfant et ses parents, de la faciliter si besoin et de l’inscrire dans un suivi plus large. « Il est important de travailler les choses en amont, de bien s’assurer qu’il n’y ait pas de lien d’emprise et que la rencontre n’ait pas un retentissement traumatique », souligne Charlotte Haguenauer.
D’après la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap), « plus de 8 000 accompagnements d’enfants au parloir sont effectués chaque année », essentiellement par les Rep, « et plus de 5 000 parents incarcérés en bénéficient[10] ». Ce dispositif est loin d’être réservé aux situations de violences intrafamiliales, mais avec l’explosion du contentieux dans ce domaine, de nombreux Cpip ont désormais intégré le recours aux associations spécialisées dans leur boîte à outils, et nombre d’entre elles voient affluer les demandes. « Les situations de violences intrafamiliales représentent actuellement près d’un tiers des demandes d’accompagnement de l’enfant que nous recevons », témoigne Alain Bouregba. Mais paradoxalement, dans la plupart des cas, « nous ne pouvons rien faire : les demandes se heurtent non pas au refus de la mère mais à celui du juge, qui s’y oppose sans nuance. »
« Beaucoup des demandes reçues cette année n’aboutissent pas forcément à un accompagnement, mais nous travaillons avec les parents qui le souhaitent à leur réflexion et à leur apaisement, ainsi qu’à la préparation des démarches à mettre en œuvre à la sortie », nuance Martine Noally. « Il y a plein de façons de travailler sur la paternité, avec ou sans rencontre, détaille la psychologue Lucille Courtot, de l’association ARS95 dans le Val-d’Oise. Quand les parloirs ne sont pas possibles, nous pouvons proposer aux papas des entretiens individuels ou la participation à un groupe de parole. Cela nous est arrivé d’en accompagner dans la rédaction de courriers, qu’ils puissent les envoyer ou qu’ils les gardent de côté pour le jour où, peut-être, ils pourront les transmettre. Parfois, il peut même s’agir de les accompagner au deuil de leur paternité, pour un temps ou de manière définitive, et de voir comment faire avec cette réalité. »
Les associations en première ligne – là où elles le peuvent
Les associations jouent un rôle central dans la prise en charge de la parentalité en prison. « Dès qu’un père n’arrive pas à voir ses enfants, on active le Rep », résume B., Cpip dans le sud de la France. « Nous pouvons aussi bien être saisis par le parent incarcéré que par un Cpip, l’autre parent, un avocat, ou encore les services sociaux, énumère Martine Noally. Parfois même, c’est le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants qui nous mandate directement dans son ordonnance. » Outre les visites accompagnées, le travail de médiation familiale et le suivi individuel de certains pères, des associations organisent dans certains établissements, avec les directions et les Spip (services pénitentiaires d’insertion et de probation), des groupes de parole sur la paternité ou encore des animations collectives réunissant plusieurs pères ou plusieurs familles : création de contes, fabrication de cartes de vœux ou de petits cadeaux… « Ces ateliers créatifs pourraient paraître anodins, mais ils sont loin de l’être, souligne Benjamin Ourghanlian, de l’association ARS95 : si nous nous contentions de mener des entretiens individuels, cela pourrait être très pénible pour les pères de cogiter avec cela pendant un mois. Il nous semble très important de faire coïncider cette parole avec une pratique de la parentalité. En écrivant à son enfant, en lui dessinant ou en lui fabriquant quelque chose, il s’agit de continuer à être papa concrètement. » En 2023, ARS95 a également coordonné avec le Spip la création d’un livret intitulé Où es-tu papa ?, destiné à aider le père incarcéré et ses proches à répondre aux questions de l’enfant et à mettre des mots sur la situation.
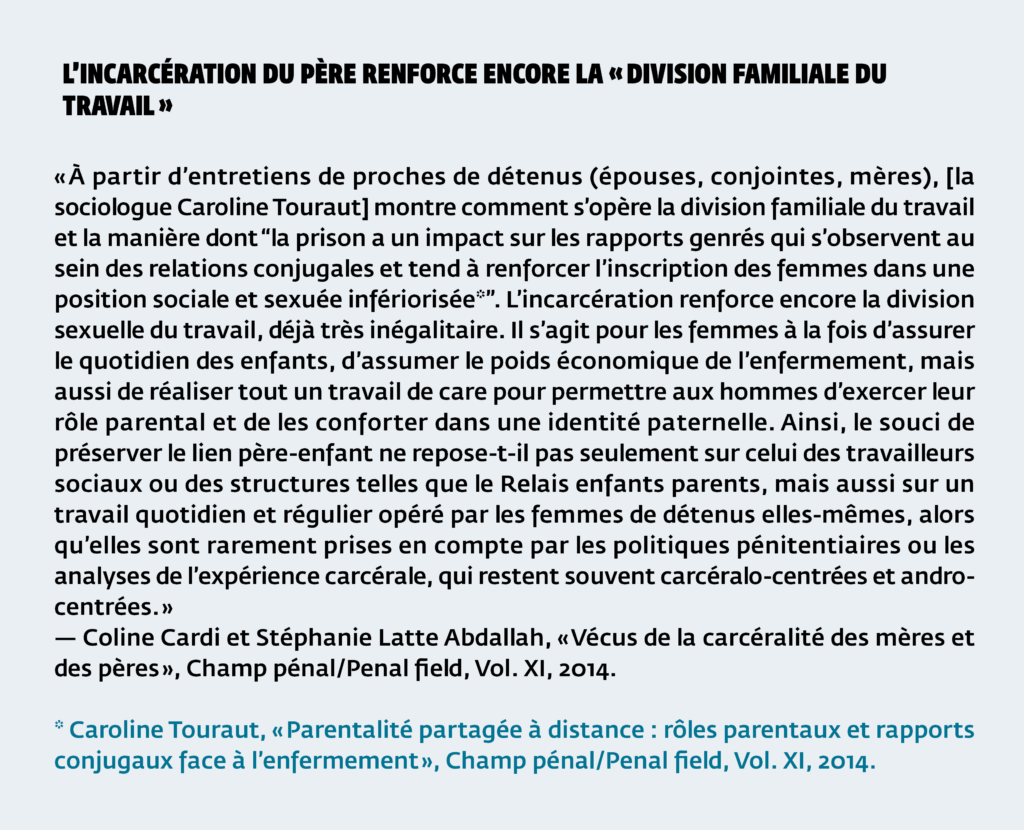
La place du secteur associatif est d’autant plus prépondérante dans l’accompagnement de la parentalité en prison que les Cpip se sentent souvent démunis : si leurs missions incluent le maintien des liens familiaux, ils doivent suivre tant de personnes détenues à la fois que la paternité passe fréquemment au second plan dans leur suivi – loin derrière d’autres questions plus attendues par les magistrats, plus facilement objectivables et moins touchées par les stéréotypes de genre (voir article « Paternité et aménagements de peine : un critère délaissé », Dedans Dehors N°121). « Sur le papier, cela fait partie de nos missions, mais c’est sûr que comme on est dans le jus, on ne fait pas ce qu’il faut », soupire N., Cpip de l’est de la France. C’est particulièrement le cas en maison d’arrêt, où la surpopulation carcérale est à son comble : « En maison d’arrêt, on gère les urgences. On a un livret fait par l’Uframa[11], mais on ne le distribue presque jamais. En entretien arrivant, on leur demande s’ils ont des enfants, mais on ne creuse pas assez le sujet », regrette B.
Les autres personnels pénitentiaires, quant à eux, ne sont pas spécifiquement formés aux questions parentales. « Si les dispositifs de notre association peuvent exister dans ces établissements, c’est qu’ils portent un regard bienveillant sur la question de la parentalité, mais on observe clairement un manque de sensibilité et de formation des professionnels, qui sont très contents de nous déléguer ce sujet sur lequel ils ne sont pas à l’aise », témoigne un éducateur intervenant en détention. « Cela vaut aussi pour les Cpip : ils sont très outillés pour accompagner les détenus sur les questions de travail, de logement, de santé, mais les questions de parentalité sont plus absentes. Et cela ne semble pas avoir changé ces dernières années. »
À défaut de muscler la formation initiale du personnel, l’administration pénitentiaire mise sur la capacité des chefs d’établissement à sensibiliser leurs équipes (voir l’article voir son enfant en prison : un parcours d’obstacles Dedans Dehors 121). En 2023, elle a fait circuler un Guide de l’accueil des enfants en visite au parloir, réalisé avec l’Uframa et la Frep (structure française de la Frepi). De manière générale, « nos actions de soutien à la parentalité reposent sur des partenariats bien établis, notamment avec l’Uframa et la Frep, et des appels à projets annuels qui visent à faire remonter des initiatives portées par les acteurs locaux », à hauteur de 121 000 euros pour 2024, indique François-Marie Tarasconi, adjoint au chef de département des politiques sociales et des partenariats de la Dap. Une collaboration qui n’est pas sans nécessiter parfois des explications et ajustements pour que chacun reste à sa place : « Il est arrivé que l’administration pénitentiaire nous demande des comptes sur ce qui s’était passé lors de parloirs où les émotions étaient fortes, témoigne une responsable associative. Nous signalons les incidents qui le nécessitent, mais nous veillons à protéger la relation intime entre l’enfant et son parent. Nous veillons aussi à ce qu’elle ne soit pas instrumentalisée dans le parcours pénal du parent, ou dans un seul objectif de réinsertion. »
La place dévolue aux initiatives associatives et au bon vouloir des directions d’établissement rend toutefois la prise en charge de la parentalité très hétérogène d’une prison à l’autre. « Dans certains établissements, de très belles choses se font. Dans d’autres, rien… Tout dépend de l’établissement, des personnes qui sont en poste et des initiatives locales, souligne un responsable associatif. Si une association a les moyens d’organiser un atelier parent-enfant et que le directeur d’établissement y est ouvert, cela se fera. Mais si le personnel et le chef d’établissement n’y voient aucun intérêt, ça ne se fera pas, quand bien même ce serait préconisé par la Disp [Direction interrégionale des services pénitentiaires]. »
Au risque d’une politique à deux vitesses, et d’interventions à la portée limitée : « Tant mieux si cela existe mais ce sont des initiatives isolées, il y a des milliers de personnes incarcérées et d’enfants qui n’en bénéficient jamais, pointe Ariane Amado. Il s’agit de missions de service public déléguées, mais les pouvoirs publics ne mettent en place aucune politique nationale, structurelle, sur la parentalité en détention. À la différence du travail par exemple, du moins dans les textes… On en revient au fait que le droit soit genré : la prison est pensée pour les hommes, donc l’accès au travail est envisagé de manière beaucoup plus importante que l’accès à la famille. »
par Johann Bihr
Cet article est paru dans la revue Dedans Dehors n°121 – Décembre 2023 : « Ils grandissent loin de moi » : être père en prison
[1] Source : ministère de la Justice, cité dans Mikaël Corre, « Pères absents : enquête sur ces hommes qui ont abandonné leurs enfants », La Croix L’Hebdo, 6 décembre 2023
[2] Les estimations de Children of Prisoners Europe se fondent sur les chiffres de la population carcérale et une moyenne d’1,3 enfant par homme détenu, établie en 2002 par l’enquête de l’Insee. D’après ce calcul, au 1er décembre 2023, plus de 95 000 enfants auraient un père incarcéré, et plus de 3 300 auraient une mère incarcérée.
[3] Francine Cassan (coord.), L’histoire familiale des hommes détenus, Insee, 2002.
[4] Direction de l’administration pénitentiaire, Statistique des établissements et des personnes écrouées en France, 1er décembre 2023.
[5] Marine Quennehen et Anne Unterreiner, « Le stigmate de la paternité incarcérée en France », Sociologie, N° 1 vol. 13, 2022. Ces travaux font écho à ceux de Coline Cardi et Stéphanie Latte Abdallah, entre autres, qui décrivaient huit ans plus tôt la préoccupation des liens familiaux en détention comme « très largement genrée » : « Alors que pour les hommes la question reste relativement marginale, elle est omniprésente s’agissant des femmes. » Corine Cardi et Stéphanie Latte Abdallah, « Vécus de la carcéralité des pères et des mères », Champ pénal/Penal field, Vol. XI, 2014.
[6] Autrice de L’enfant en détention en France et en Angleterre : Contribution à l’élaboration d’un cadre juridique pour l’enfant accompagnant sa mère en prison, Mare & Martin, 2020.
[7] Sur ce point, voir : Lucie Bony, « La domestication de l’espace cellulaire en prison », Espaces et sociétés, n° 162, 2015.
[8] À savoir l’exercice, la pratique et l’expérience. Voir Didier Houzel, Les Enjeux de la parentalité, Eres, 1999.
[9] Ministère de la Justice/SG/SDSE, cité dans « Violences faites aux femmes : la prison est-elle la solution ? », Dedans Dehors n° 118, avril 2023.
[10] Direction de l’administration pénitentiaire, fiche « Maintien des liens familiaux et soutien à la parentalité », 2023.
[11] Union nationale des fédérations régionales des associations de maisons d’accueil de familles et proches de personnes détenues