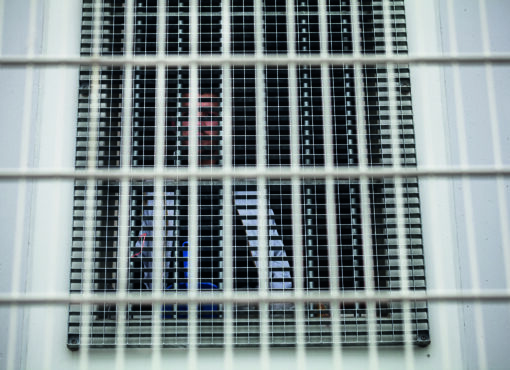La loi permet la libération des détenus souffrant de graves troubles mentaux. Mais, mal adapté, le texte rate complètement son objectif.
Ce devait être LA solution, le moyen de mettre un terme à la détention de personnes souffrant de troubles psychiques tels que la peine ne peut avoir de sens et que la prison devient traitement inhumain et dégradant. À l’été 2014, le législateur a explicitement intégré les pathologies mentales parmi les motifs pouvant conduire à une mise en liberté pour raisons médicales. Mais le dispositif n’a pas pris. C’est un flop.
Du côté de la pénitentiaire, personne ne semble en mesure de dire combien de mesures ont été prononcées. Mais on ne cache pas, en coulisses, que la question est surtout de savoir si même une seule décision positive a été prise. Et du côté de la Direction générale de la santé ? On ne sait pas non plus, mais le fiasco est admis. Pour en mesurer l’ampleur, un groupe de travail interne envisage de lancer une étude pour évaluer la proportion de personnes qui pourraient bénéficier de cette mesure et le nombre de demandes émises. Mais le financement n’est pas encore acquis. Sur le terrain, c’est aussi le désarroi. Tous les psychiatres interrogés disent être confrontés à des cas cliniques très graves, ou à des états tellement dégradés qu’ils se demandent ce que les gens font encore en prison. Cependant, aucun n’a l’expérience d’une mise en liberté pour raisons psychiatriques. Soit parce que les personnes sont décédées avant la fin de la procédure, soit parce qu’elles se sont heurtées à des refus.
La principale critique porte sur le texte. Le législateur a placé le consentement au cœur du dispositif. La personne doit pouvoir accepter et être consciente des conditions de la mise en liberté définies par le juge (1). Si bien qu’en sont expressément exclues les personnes détenues hospitalisées d’office, généralement les plus lourdement malades. Toutes celles dont la santé psychique est suffisamment altérée pour qu’elles ne puissent plus accepter ne serait-ce que les soins qu’elles requièrent. Il faut donc que leur état s’améliore et se stabilise un peu pour pouvoir déposer une demande : c’est « idiot et un peu tordu », s’alarme Michel David, président de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Ce n’est pas la seule absurdité : si, une fois libérée, la personne va mieux parce qu’elle bénéficie d’un cadre et de prestations que le milieu carcéral ne permet pas, elle risque une révocation de la mesure et donc… un retour en prison. On tourne en rond. Pour échapper à cette tenaille, une suspension de peine pour trouble mental peut, sous certaines conditions (2), être transformée en libération conditionnelle. Mais le système est si alambiqué que cela limite les demandes.
Les soignants doivent se frayer un chemin dans ces méandres procéduraux. Et, même s’ils s’y retrouvent, ils ne maîtrisent pas tous les leviers. Ils peuvent initier le processus en transmettant au juge un certificat d’incompatibilité de l’état de santé avec la détention. Cependant, sans soutien extérieur ni avocat, la demande a toutes les chances de s’enliser. Or, les gens concernés sont souvent « dans une situation inextricable », rappelle une psychiatre. « Ils sont tellement mal psychiquement qu’ils ne sont pas en capacité de demander un avocat et leurs familles peuvent s’être désinvesties. » Il faut aussi leur trouver une place à l’extérieur, ce qui relève souvent de la gageure. « Toutes les structures de psychiatrie générale sont saturées », déplore une praticienne. Sans compter qu’elles sont souvent réticentes à voir débarquer un patient qui sort de prison. Les magistrats ont en outre tendance à n’envisager que l’hospitalisation comme alternative à la prison, quand d’autres solutions pourraient être déployées. Pour Michel David, on est surtout face à « un problème de société ». Inconsciemment ou non, « on préfère savoir ces personnes en prison », quelles que soient les conditions de leur détention. Dans une société non inclusive, où maladie mentale se confond encore avec dangerosité, un texte de loi, même remanié, comme l’a proposé récemment le groupe de travail parlementaire sur la psychiatrie en prison (3), ne peut à lui seul être la clé.
Par Marie Crétenot
(1) Dans le cadre d’une suspension de peine pour les condamnés, d’un contrôle judiciaire pour les prévenus.
(2) À mi-peine en principe, projet d’insertion à l’appui ; ou sans condition de délai par rapport à l’exécution de la peine, si la personne bénéficie d’une suspension de peine depuis trois ans et que son état reste incompatible avec la détention.
(3) Rapport en conclusion des travaux des groupes de travail sur la détention, Assemblée nationale, 21 mars 2018.