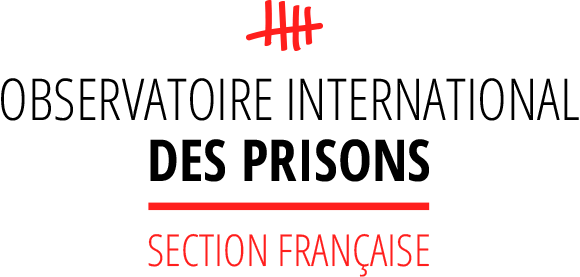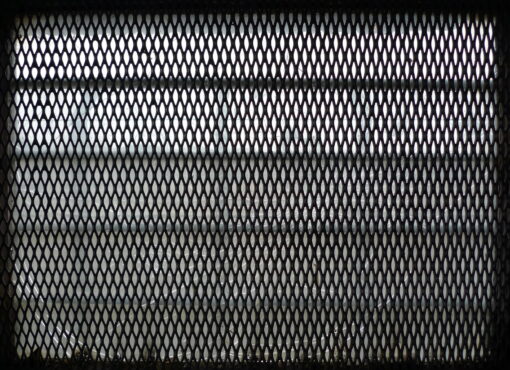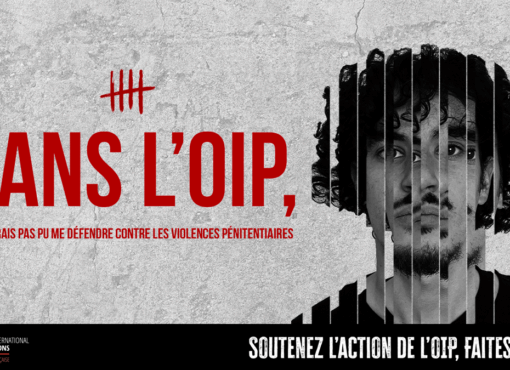Depuis l’insurrection qui a embrasé la Nouvelle-Calédonie en mai 2024, des dizaines de personnes incarcérées au centre pénitentiaire de Nouméa ont été transférées vers des prisons de l’Hexagone, à 17 000 kilomètres de chez elles. Qualifiés de « déportations » par plusieurs associations, qui y voient l’expression d’une justice post-coloniale, ces transferts ont eu lieu dans la plus grande opacité, sans que les personnes concernées aient été prévenues ni y aient forcément consenti, loin s’en faut.
L’incarcération inopinée de sept militants indépendantistes kanak dans l’Hexagone, le 22 juin 2024, a fait grand bruit. En revanche, le transfert de dizaines de prisonniers du Camp-Est vers des établissements pénitentiaires hexagonaux, ces derniers mois, est passé très largement inaperçu. Dans une rare prise de parole à ce sujet, fin novembre, le procureur de la République de Nouméa, Yves Dupas, a évoqué « une soixantaine »[1] de personnes concernées. Mais il est bien difficile de savoir précisément qui elles sont, où elles ont été affectées, et en combien de trajets. Ces transferts n’ont fait l’objet d’aucune communication officielle de la part de l’administration pénitentiaire, qui n’a pas non plus répondu aux questions de l’OIP – mais a fini par lui transmettre quelques chiffres.
En croisant la liste établie par le collectif Solidarité Kanaky, qui vient en aide aux personnes détenues de Nouvelle-Calédonie présentes dans les prisons de l’Hexagone, et celle que l’OIP a dressée au fil des derniers mois, on compte au moins 63 personnes arrivées du Camp-Est entre juin et novembre 2024. Un chiffre qui recoupe les données transmises par la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap), faisant état de 35 transferts en juin, 23 en juillet, puis « moins de 5 » en octobre comme en novembre. L’OIP a identifié a minima cinq convois différents sur cette période, en plus de celui qui a acheminé les sept militants de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT)[2]: un premier serait parti le 8 juin, suivi d’un convoi distinct de celui de la CCAT le 22 juin[3], puis d’autres le 10 juillet, le 18 octobre et le 11 novembre.
Si la pratique du transfèrement dans l’Hexagone de personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, et plus généralement d’Outre-mer, est ancienne, elle semble prendre des formes nouvelles depuis le mois de mai, tant dans son ampleur que dans ses formes. Entre 2021 et mai 2024, d’après la Dap, le nombre de transferts mensuels avait toujours été nul ou inférieur à cinq, à deux exceptions près[4]. Et outre ceux qui en faisaient la demande, cela concernait principalement des personnes soumises à une évaluation à la suite de leur condamnation à une longue peine, ou à une « évaluation de la dangerosité » en fin de peine, dans le cadre d’une demande d’aménagement. Aucun des six centres nationaux d’évaluation (CNE) n’est en effet situé en Outre-mer. En début de peine, les personnes ainsi transférées se voient le plus souvent proposer une affectation dans l’Hexagone, les établissements pour peine d’Outre-mer étant peu nombreux et saturés[5]. Si cette pratique perdure, malgré les critiques dont elle fait l’objet et les demandes faites à la Dap de développer une procédure plus respectueuse des droits des personnes détenues[6], les transferts de 2024 répondent à une logique différente.
Des opérations longtemps nébuleuses
Dès le mois de mai, au plus fort de l’insurrection en Nouvelle-Calédonie, Éric Dupond-Moretti, alors garde des Sceaux, disait envisager le transfèrement de « criminels arrêtés et placés sous mandat […] pour qu’il n’y ait pas de contamination des esprits les plus fragiles, et pour assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires[7]». Outre le flou de l’expression – les personnes venant alors d’être arrêtées n’étaient pas encore jugées, sauf par des procédures rapides dont sont exclus les auteurs présumés d’actes criminels –, la démarche semblait donc s’inscrire dans une réaction sécuritaire face aux tensions qui embrasaient l’archipel. Pourtant, si l’on peut supposer que certains transfèrements effectués depuis mai ont pu viser les participants aux mutineries qui ont alors affecté le Camp-Est, ils semblent ne pas avoir concerné, pour l’essentiel, les personnes arrêtées dans le cadre des émeutes. D’après le procureur de la République Yves Dupas en novembre, il s’agit plutôt de personnes condamnées à de longues peines ou ayant encore des reliquats conséquents à effectuer. L’opération est ainsi présentée comme une tentative de désengorgement du centre pénitentiaire de Nouméa, dont le taux d’occupation menaçait d’exploser sous le double effet des incarcérations liées aux événements et des incendies de cellules lors des mutineries au sein de la prison : « Cela a été très important pour […] avoir une capacité de
traitement judiciaire [des émeutes], une capacité d’incarcération pour les faits les plus graves », indiquait le procureur de la République[8].
D’après les informations collectées par l’OIP, toutefois, s’il y a bien des personnes condamnées à de longues peines ou devant encore effectuer plusieurs années derrière les barreaux parmi les personnes transférées, beaucoup d’autres étaient condamnées à des peines plus courtes, avec parfois des dates de sortie proches. L’une d’elles, arrivée contre son gré en juin, est ainsi sortie de prison au mois de novembre, et se trouve contrainte de rester dans l’Hexagone pendant les 18 mois de sa libération conditionnelle. La majorité des personnes détenues contactées dans le cadre de cette enquête ont entre 20 et 30 ans et plusieurs sont en couple, voire parents. Le fils de l’une d’elles venait de naître lorsqu’elle a été transférée. Des liens familiaux qui n’ont pourtant pas fait obstacle aux transferts, pas plus que certains parcours de réinsertion. « [Mes clients] ne comprennent pas. Ils avaient des parcours familiaux, un étayage, il leur restait des peines inférieures à un an pour certains. Cela me semble ubuesque ! », commente Sophie Devrainne, avocate au barreau de Nouméa. « Et l’administration ne semble avoir aucun élément officiel à produire concernant les décisions de transfert, c’est très nébuleux ».
En la matière, l’État dispose d’une latitude importante : le transfèrement relève de l’autorité du ministère de la Justice ou de la direction interrégionale des services pénitentiaires, et il peut concerner toute personne détenue, avec tout de même l’obligation, en principe, de faire valoir « un fait ou élément d’appréciation nouveau » lorsqu’elle est déjà affectée en établissement pour peine. Si l’administration peut y procéder « dans l’intérêt de la personne détenue » (en lien avec un projet de sortie, une prise en charge médicale, etc.), elle peut aussi invoquer son « comportement », son « profil » ou le « maintien du bon ordre et de la sécurité », ce qui peut s’appliquer à une multitude de situations. Quand les transferts visent à « réguler le taux d’occupation » des maisons d’arrêt, la circulaire de 2012 préconise certes de « se fonder, autant que possible, sur le volontariat » et d’« éviter » de transférer les personnes qui reçoivent des visites, sont scolarisées, suivent une formation ou ont un projet d’aménagement de peine ; mais ces principes s’effacent devant toute « urgence caractérisée ». La procédure est d’ailleurs simplifiée « en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles », et la procédure contradictoire n’est plus requise[9].
En ce qui concerne les transfèrements depuis le Camp-Est, l’omerta est telle que de nombreux avocats et familles ont été pris de court, sans nouvelles de leur client ou proche détenu et ne parvenant pas à savoir où il se trouvait (voir p.45). Et pour cause : les personnes promises au transfert n’ont pas été autorisées à prévenir leur famille. « La détention avait coupé toutes les cabines pour qu’on ne puisse pas les joindre », assure Monsieur B., ce que confirme l’ensemble des proches interrogés. « Normalement, quand j’écris à un détenu qui a été transféré sans que je le sache, le Camp-Est me renvoie le courrier en me précisant sa nouvelle adresse », ajoute Marie-Katell Kaigre, avocate au barreau de Nouméa. « Sauf que là je n’ai eu aucun retour, pour l’instant c’est assez hermétique pour moi ».
« Ils m’ont dit de signer un papier »
Les conditions dans lesquelles ont eu lieu les transfèrements renforcent l’impression d’une administration s’efforçant d’agir en toute discrétion. Outre l’impossibilité de prévenir les proches, l’ensemble des témoins directs décrivent un départ précipité, sans qu’on leur demande véritablement leur avis. « Ils sont venus à 15h, m’ont dit de signer un papier et que je partais dans la nuit », raconte Monsieur B. « Sinon, j’allais direct dans les geôles sans faire mes affaires ». En effet, les personnes ayant refusé de signer le document qu’on leur tendait ont dû partir sans aucune affaire personnelle : « Ils m’ont demandé si j’étais d’accord pour partir faire ma peine en France. J’ai dit non ! Ils m’ont dit que je ne pouvais pas aller chercher mes affaires. Les Eris[10] m’ont mis à nu et m’ont mis de nouveaux linges, je n’ai plus revu les miens. Les autres, ils avaient leur paquetage, mais pas moi. » Pris par surprise, certains ne se souviennent même pas s’ils ont signé, ou disent l’avoir fait avant de revenir en arrière, en vain : « Un de mes clients était d’accord sur le moment, mais il a voulu annuler sa signature, parce qu’il ne s’était pas rendu compte de ce que cela signifiait. Je ne suis pas sûre qu’on leur ait toujours précisé la destination du transfert », s’interroge Sophie Devrainne. Beaucoup considèrent qu’on leur a arraché leur signature, par le double effet de la surprise et de l’impossibilité de récupérer leurs affaires en cas de refus. Mais il semble de toute façon que ce n’était qu’une formalité : « Ils nous ont fait signer un papier en nous disant : “C’est de gré ou de force” », indique Monsieur O. De fait, le seul document auquel l’OIP a pu avoir accès est un « ordre de transfert », sur lequel la signature n’indique pas un accord mais seulement une « notification ».
Certains ont cependant accepté leur transfert, à commencer par ceux qui en sollicitaient un depuis longtemps, et qui ont vu leur demande soudainement débloquée. D’autres s’y sont résignés pour quitter un centre pénitentiaire déjà régulièrement épinglé par la justice pour ses conditions indignes de détention, et où la surpopulation exacerbée par l’incendie de dizaines de cellules pendant les mutineries rendait le quotidien intenable. « J’ai accepté parce que j’en avais marre des conditions dans lesquelles j’étais incarcéré », explique l’un d’eux. « Mais mes cousins, mes amis, ont été transférés de force ! J’ai vu des petits frères effrayés, d’autres en pleurs ! » « Ils nous ont foutu dehors. Ils nous ont dit que si on refusait d’entrer dans l’avion, ils nous tabasseraient et nous y mettraient de force », témoigne quant à lui Monsieur N.
Placés dans des cellules d’attente sans même repasser par leur cellule, ceux qui ont refusé de signer disent avoir été progressivement rejoints par ceux qui avaient signé, et avaient pu récupérer une partie de leurs affaires. « Ils nous ont donné juste un carton pour mettre les affaires, donc pas assez pour emporter tout », remarque Monsieur B. Tous ont dû passer plusieurs heures ainsi entassés : « Après m’avoir fouillé trois fois, dont une fouille intégrale, “à poil”, ils m’ont mis avec onze personnes dans une petite cage pour attendre le départ. Il s’est écoulé 4 heures d’attente dans un endroit prévu pour une personne », se souvient Monsieur E.
Menottés pendant tout le trajet
Tous les transférés, ainsi que les sept membres de la CCAT placés en détention provisoire dans l’Hexagone, ont d’abord été conduits vers l’aéroport militaire de Magenta, où ils ont pris place à bord d’un avion militaire vers l’aéroport international de la Tontouta. De là, la plupart des convois ont fait escale à Tokyo, avant d’atterrir à Paris. D’autres ont atterri à I’aéroport militaire d’Istres, après un transit, dans le cas des membres de la CCAT, par Hawaï et la Nouvelle-Orléans. « C’était digne des films d’Hollywood, du grand cinéma en réel ! », ironise Brenda Wanabo, responsable communication de la CCAT, arrivée au matin du 24 juin à la maison d’arrêt de Dijon après un ultime atterrissage à l’aéroport militaire de Vélizy-Villacoublay (voir p.36). « L’État français a mis en œuvre un gros dispositif, qui a dû coûter beaucoup d’argent ! »
Plusieurs personnes détenues au Camp-Est décrivent un déploiement impressionnant de forces de l’ordre venues de l’Hexagone, comme des équipes du Raid (unités de Recherche, assistance, intervention, dissuasion) ou des équipes régionales d’intervention et de sécurité (Eris). Un nombre important de surveillants était également présent. D’après une source pénitentiaire, des appels à volontariat avaient été lancés dans les établissements de l’Hexagone pour participer aux opérations de transfert.
Les personnes détenues sont généralement restées menottées pendant tout le trajet, soit plus de 24 heures, y compris pour prendre les repas et aller aux toilettes, et n’ont pas pu sortir de l’avion pour se dégourdir les jambes lors des courtes escales. « Le jour du transfert, j’étais hyper mal, j’étais malheureux de quitter ma famille. Dans l’avion j’avais peur, j’avais froid, j’ai cru que j’allais mourir », confie Monsieur T. « [Les surveillants] m’ont donné des cachets de Séresta », indique Monsieur I., ce que confirment plusieurs témoins : « Ils lui en ont donné pendant tout le trajet. Dans l’avion, il n’y avait que des surveillants, aucun infirmier, aucun médecin. Il était tellement pris dans les cachets que quand il s’est réveillé, il ne savait pas où il était ! », précise Monsieur N.
Contrairement aux militants de la CCAT, conduits à leur établissement de destination dès leur arrivée dans l’Hexagone, les personnes arrivant du Camp-Est ont d’abord transité – parfois une nuit, parfois plusieurs – dans une prison d’Île-de-France, généralement le centre pénitentiaire du Sud-Francilien, plus rarement celui de Fresnes, avant d’être dispersées à travers tout le territoire. Si la plupart ont été affectées dans des établissements pour peine, certaines personnes se retrouvent en maison d’arrêt ou en quartier maison d’arrêt, comme à Aix-Luynes, à Troyes ou à Tarbes, où le taux d’occupation atteignait 177% à l’arrivée de monsieur H. « Aujourd’hui je suis dans un établissement fermé [quartier maison d’arrêt d’un centre pénitentiaire]. J’attends d’être affecté dans un établissement pour peine et le délai est long, 18 mois minimum », se désole Monsieur R.
Après le choc d’un transfert soudain, les personnes transférées subissent celui du déracinement et de l’isolement (voir p. suiv.). « Ça a été un grand saut imposé vers l’inconnu », résume Monsieur B., arrivé en juillet dans un centre de détention du nord de la France. Monsieur I., affecté dans un autre centre de détention du nord de la France, confie pour sa part : « Je ne m’attendais personnellement pas à tout ça, et maintenant je suis perdu. »
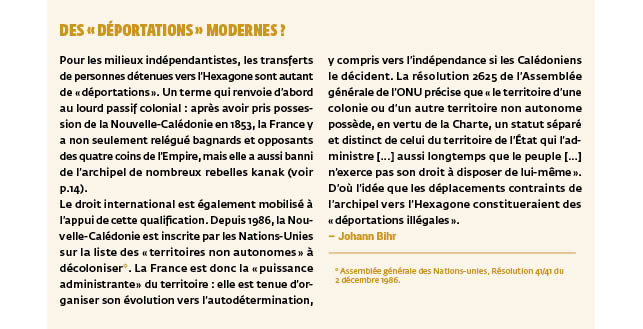
Par Odile Macchi
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°125 – Kanaky – Nouvelle-Calédonie : dans l’ombre de la prison
[1] Entretien sur Radio Rythme Bleu, 29 novembre 2024.
[2] Le Comité de soutien aux prisonniers politiques de Kanaky (CSPPK), lié à la CCAT, évoque quant à lui des départs « réguliers et continus » de Nouméa vers l’Hexagone, par « groupes de vingt ».
[3] Une liste de 23 personnes transférées à cette occasion a été publiée sur les réseaux sociaux par plusieurs groupes de solidarité ou d’information sur la situation des prisonniers de Nouvelle-Calédonie.
[4] À savoir six transferts en juillet 2021, puis cinq le mois suivant.
[5] Certains acceptent cette affectation, dans l’espoir de meilleures conditions de détention et en l’absence de réelle opportunité de réinsertion sur le Caillou. D’autres la refusent, préférant sacrifier un suivi plus adapté au profit de leur ancrage local et de leurs liens familiaux. Sur le premier cas, voir : Yoram MOUCHENIK, Recherche-action sur la pertinence d’une prise en charge spécifique en Outre-mer pour les populations autochtones, Université Sorbonne Paris Nord, septembre 2020, p. 395-396.
[6] François Bès, « Centre national d’évaluation en Outre-mer. Pour la DAP, c’est non », Dedans Dehors, n°109, juillet 2019, p. 35.
[7] « “Fermeté, rapidité, systématicité” : Dupont-Moretti détaille la “circulaire pénale” appliquée en Nouvelle-Calédonie », Outremer La 1ère, 17 mai 2024.
[8] Entretien sur Radio Rythme Bleu, op. cit.
[9] Circulaire JUSK1240006C du 21 février 2012 relative à l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues.
[10] Equipes régionales d’intervention et de sécurité, faisant partie de l’administration pénitentiaire et spécialisées dans les situations de crise.