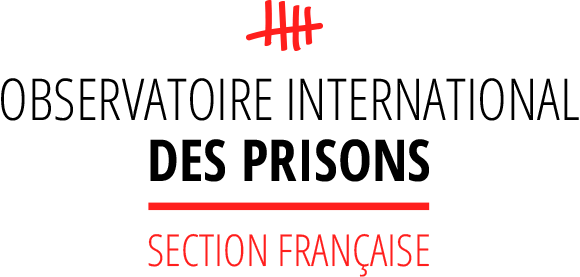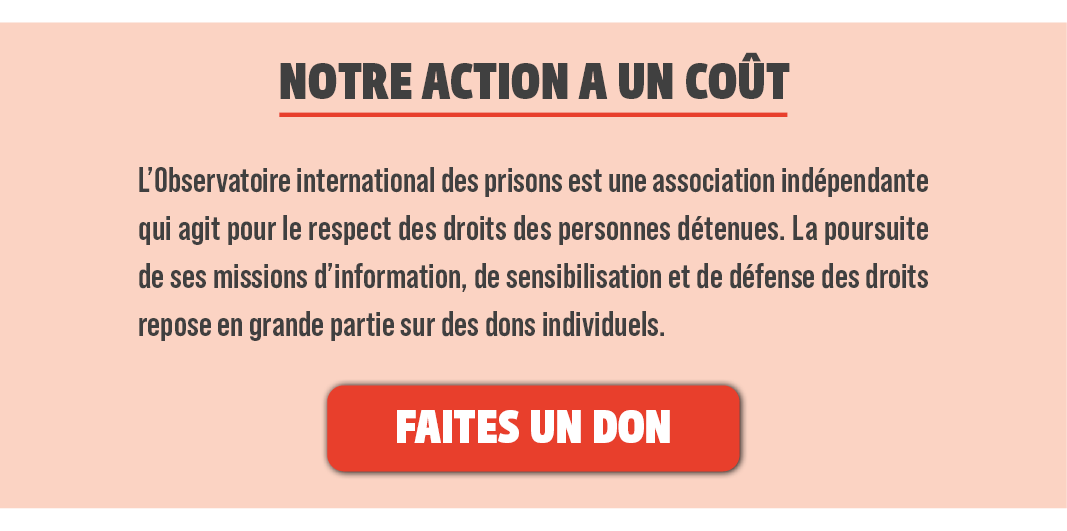Au vu des nombreuses atteintes aux droits fondamentaux subies en prison par les personnes LGBT+, en particulier transgenres, l’élaboration d’un document opérationnel à ce sujet par le ministère de la Justice est à saluer. L’initiative n’en reste pas moins largement insuffisante.
Le 5 mars 2024, la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap) produisait un Référentiel national de prise en charge des personnes LGBT+ placées sous main de justice. L’objectif : rassembler l’ensemble des ressources sur le sujet et lister les bonnes pratiques pour « répondre aux interrogations des personnels pénitentiaires », « sécuriser les pratiques professionnelles » et « garantir une prise en charge respectueuse et adaptée des publics LGBT+[1] ». Ce référentiel a donné lieu à la consultation de la Dilcrah[2] et de trois associations spécialisées (Flag !, SOS homophobie et Pastt[3]), avant d’être adopté par les organisations syndicales de l’administration pénitentiaire. Sans grande surprise, les personnes détenues, première concernées, n’ont pas eu droit à la parole. Et le document, non publié, ne semble pas davantage leur être accessible.
Selon la Dap, ce référentiel traduit les engagements pris en matière d’action pour l’égalité des droits et de lutte contre les actes LGBT+phobes[4]. Il y a urgence : les atteintes aux droits fondamentaux des personnes transgenres[5], en particulier, sont légion en prison, au point que leur cumul « est susceptible de constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant au sens de la Convention européenne des droits de l’homme », concluait le Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL) dans un avis publié en 2021. Estimées à une trentaine par le ministère de la Justice en 2020 bien que probablement plus nombreuses, les personnes transgenres – principalement des femmes trans – sont en effet ostracisées et discriminées en prison[6]. Soulignant la persistance de ces atteintes depuis son premier avis rendu en 2010, l’autorité administrative indépendante appelait à « garantir le plein respect de la dignité et des droits des personnes transgenres privées de liberté, notamment leurs droits à l’autodétermination, à la libre disposition de leur corps, à l’accès aux soins, à l’intimité et à la vie privée[7]».
L’affectation genrée en prison, un enjeu essentiel
Les quartiers de détention étant organisés sur un principe de stricte séparation des sexes, l’affectation est un enjeu essentiel dans la prise en charge des personnes transgenres. Dans le sillage de la réponse du ministère de la Justice à l’avis du CGLPL en 2021, le référentiel prévoit la possibilité, « de façon dérogatoire », d’affecter une personne transgenre « dans un quartier différent du sexe inscrit à son état civil » afin qu’il soit « le plus adapté à sa situation ». Il est précisé que la demande de changement d’affectation peut être formulée « à l’initiative de la personne détenue » ou « de l’établissement pénitentiaire d’accueil ». La France se rapproche ainsi des standards internationaux : pour la Cour européenne des droits de l’homme, le respect de l’identité de genre est en effet une composante du respect de la dignité humaine[8], et le principe d’autodétermination fait partie intégrante du droit à la vie privée. Les principes de Jogjakarta prévoient également, dans la mesure du possible, « que tous les prisonniers puissent participer à la prise de décisions concernant le lieu de détention le plus approprié à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre[9] ».
Dans le même temps, le référentiel entérine cependant le caractère subsidiaire du principe d’autodétermination derrière les murs : l’administration pénitentiaire conserve le pouvoir discrétionnaire qui la caractérise. En théorie, rien n’interdit même de changer une personne détenue transgenre d’affectation contre son gré. Le référentiel prévoit certes de recueillir par écrit l’avis de la personne détenue, mais celui-ci ne suffit pas à obtenir une affectation vers un quartier ou un établissement en adéquation avec son identité de genre. En effet, si une telle demande se présente, le personnel pénitentiaire est invité à remplir une « fiche pratique sur l’affectation des publics transgenres », qui doit être étudiée en commission pluridisciplinaire unique (CPU), présidée par le chef d’établissement qui détient le pouvoir décisionnaire. Certes, le référentiel précise qu’un refus ne peut être justifié par la seule absence de traitement hormonal ou de modifications anatomiques, qu’il doit faire l’objet d’une notification motivée et qu’il est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux. L’affectation dérogatoire peut cependant être refusée en raison de l’« insuffisance ou [l’]absence d’éléments permettant de justifier d’une différence entre l’identité de genre de la personne et celle du public accueilli sur son secteur d’hébergement ».
Cette procédure laisse une très large marge d’appréciation au personnel pénitentiaire, dont la formation sur le sujet est encore parcellaire. La fiche pratique l’invite en outre à renseigner des informations comme le changement de prénom à l’état civil ou encore la communication « spontané[e] » par la personne concernée d’un éventuel « traitement hormonal […], d’une opération chirurgicale et/ou de réassignation sexuelle ». Des éléments qui traduisent une compréhension erronée de ce qu’est la transidentité, et qui occultent l’hostilité à la diversité des identités et expressions de genre en prison. Y figure également une question susceptible d’entraîner des biais genrés préjudiciables aux personnes qui ne se conformeraient pas aux attentes binaires de la société : « L’apparence de la personne détenue peut-elle être considérée comme proche de son nouveau genre (l’apparence physique à proprement parler, mais aussi vestimentaire ou autre) ? » Autant d’éléments qui ouvrent la voie à des appréciations sexistes et stéréotypées : estimera-t-on qu’une femme transgenre n’est pas une femme parce qu’elle a les cheveux courts, ou qu’un homme transgenre n’est pas un homme car il porte du rose ?
Des bonnes pratiques encouragées, mais soumises au bon vouloir des agents
Encellulement individuel, fouilles, accès aux douches, aux promenades, aux activités et aux produits cantinables[10], port de vêtements et d’accessoires, réception des courriers ou encore sorties : le référentiel traite presque tous les éléments de la vie quotidienne. Sans que cela ne soit reconnu comme un droit pour la personne détenue, il prévoit que d’éventuelles adaptations soient examinées au cas par cas en CPU, notifiées à la personne concernée puis regroupées dans une « note de service individualisée », transmise à l’ensemble des personnels pénitentiaires impliqués.
Dans les établissements pénitentiaires composés de « quartiers femmes » et de « quartiers hommes », le référentiel prévoit par exemple que les personnes détenues puissent avoir accès aux produits cantinables des deux quartiers. Il préconise même dans ce cas « de mutualiser les références proposées sur une liste unique ». Cette possibilité reste néanmoins inexistante dans la grande majorité des établissements pénitentiaires, réservés aux hommes. Une impasse qui ne pourrait être dépassée que par la mutualisation de l’ensemble des produits cantinables à l’échelle nationale – ce que le référentiel n’envisage que pour les protections périodiques –, et qui pose plus largement la question de la mixité en milieu carcéral pour les personnes détenues consentantes.
Parmi les dispositions du référentiel à saluer, les postures professionnelles conseillées au nom du devoir de neutralité des agents quant à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Ou encore le fait qu’« un courrier adressé au prénom d’usage d’une personne détenue transgenre (différent du prénom inscrit à son état civil), alors même que le nom de famille et le numéro d’écrou sont corrects, doit lui être délivré ». Une précision qui n’a rien d’anecdotique : encore en février 2023, l’OIP révélait qu’une femme transgenre incarcérée à Muret ne recevait plus de courrier, à moins que celui-ci ne lui soit adressé sous son ancienne identité[11]. Le référentiel prévient également les situations de mégenrage par le personnel de l’administration pénitentiaire : « Afin de respecter l’identité des publics transgenres placées sous main de justice, les personnels pénitentiaires dénomment toute personne conformément à son souhait », prescrit-il.
Un biais sécuritaire persistant
S’agissant des fouilles intégrales ou par palpation, les textes réglementaires prévoient qu’elles soient effectuées par un agent du même sexe que la personne fouillée[12]. Comme pour l’affectation, le référentiel acte, par principe, que le sexe à prendre en compte correspond à l’état civil, « et non à l’apparence corporelle ni aux organes génitaux ». À titre « exceptionnel » toutefois, après examen en CPU et si des membres du personnel pénitentiaire se portent volontaires, la fouille peut être réalisée par une personne en adéquation avec l’identité de genre de la personne détenue. « En dernier recours, […] il peut être exceptionnellement décidé par l’encadrement de faire effectuer la fouille avec le soutien d’un personnel gradé (du même sexe que l’agent) ou par un binôme de surveillants (de même sexe) ». Or une fouille, par nature particulièrement intrusive, l’est d’autant plus en binôme. Pire, à défaut de volontaire, y compris pour une fouille en binôme, retour à la case départ : la fouille est effectuée par un agent du même sexe à l’état civil que celui de la personne fouillée. Cette procédure, confuse et facultative, acte la primauté du confort du personnel pénitentiaire et traduit des réticences souvent basées sur des craintes d’agression sexuelle largement fantasmées, au prix de l’invisibilisation du genre de la personne fouillée. Les avancées restent ainsi circonscrites par des préoccupations sécuritaires, et le risque de tensions, voire de sanctions disciplinaires et pénales pour la personne détenue qui refuserait des fouilles ne respectant pas son identité de genre, demeure quasiment intact[13].
Ce biais sécuritaire contamine aussi des sujets qui en sont a priori exempts, comme le choix des vêtements portés en détention. Le référentiel reconnaît la liberté de porter la tenue de son choix en cellule individuelle, mais la conditionne à la « sécurité des personnes » et au « maintien du bon ordre de l’établissement » dans tous les autres espaces de la détention – y compris en cellule dès lors qu’elle est partagée. Les mêmes critères sont évoqués pour « sensibiliser la personne détenue concernée à l’utilisation de vêtements et accessoires considérés comme neutres ou unisexes et au port d’un maquillage discret ». Du moins le référentiel précise-t-il que toute décision d’interdiction doit faire l’objet d’une notification écrite à la personne détenue.
À cet égard, il aurait paru opportun que le texte mentionne la décision du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2023, qui reconnaît comme une liberté fondamentale le « droit à affirmer une définition sexuelle de la personne, entre autre[s] par la tenue vestimentaire ». Le juge en déduit que, dès lors qu’elle « porte atteinte à son identité sexuelle », l’interdiction de porter des vêtements ou accessoires doit être motivée, donner lieu à un débat contradictoire et être susceptible de recours devant la juridiction administrative[14].
Pensé comme un guide pratique à destination du personnel pénitentiaire, le référentiel laisse ainsi une large marge d’appréciation aux agents, et ce, au détriment en particulier du droit à l’autodétermination. On ne pouvait, logiquement, attendre d’un document dénué de force contraignante qu’il mette fin à l’ensemble des atteintes aux droits fondamentaux des personnes transgenres. Mais, justement parce qu’il est non-contraignant, on aurait pu espérer que le référentiel soit plus courageux à de nombreux égards.
Des angles morts
Enfin, le silence de l’administration pénitentiaire sur certains points interroge, en particulier s’agissant de l’existence de comportements LGBT+phobes au sein du personnel pénitentiaire, laissant entendre que seules les personnes détenues pourraient en être à l’origine. Une négligence particulièrement problématique dans l’attente des modules de formation annoncés par la Dap sur la prise en charge des publics LGBT+. Le référentiel invite certes à renforcer la sensibilisation du personnel pénitentiaire, à laquelle travaille SOS homophobie, mais il aurait été utile de prévoir également des lignes directrices pour les agents qui constateraient un comportement LGBT+phobe de la part de leurs collègues[15].
La prise en charge médicale des personnes transgenres, quant à elle, ne fait l’objet que de quelques lignes vides de toute consigne. Si la Dap explique être en attente des recommandations de la Haute autorité de santé[16], il devient néanmoins urgent d’apporter des réponses claires et uniformes à ce sujet. Le guide méthodologique de 2019 sur la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, seul document traitant à ce jour du sujet, est en effet non seulement obsolète – il parle notamment encore de « transsexualisme » – mais aussi tout à fait incomplet : il ne traite pas, par exemple, des modalités d’accès à un parcours de transition médicale.
Les recommandations du CGLPL restent donc largement d’actualité, tout comme les observations émises par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) en novembre dernier[17]. Elle pointait notamment l’accès non effectif au parcours de transition en prison du fait des difficultés majeures d’accès aux soins, l’invisibilisation des victimes comme réponse principale aux violences transphobes, ou encore la nécessité de textes facilitant le changement d’état civil en détention.
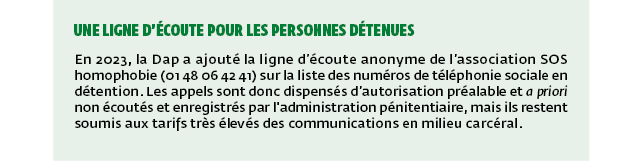
par Baptiste Garreau, Référent de la commission « soutien juridique » de SOS homophobie et Prune Missoffe, responsable analyses et plaidoyer de l’OIP
Cet article est paru dans la revue Dedans Dehors n°122 – mai 2024 : Isolement carcéral « je suis dans un tombeau »
[1] Courrier de la Dap au président de l’OIP, accompagnant l’envoi du référentiel.
[2] Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT.
[3] Flag ! lutte contre les discriminations à l’encontre des personnes LGBT+ aux ministères de l’Intérieur et de la Justice, mais aussi parmi leurs usagers. SOS homophobie est une association féministe de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie, la transphobie et l’intersexophobie. L’association Prévention Action Santé Travail pour les Transgenres (Pastt) intervient au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis.
[4] L’élaboration d’un référentiel était une des mesures prévues par le Plan interministériel d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2023-2026.
[5] Le référentiel définit une personne transgenre comme « une personne qui ne s’identifie pas au genre qui lui a été assigné à la naissance, sur la base des organes génitaux ».
[6] « Femmes trans en prison, ostracisées et discriminées », Dedans Dehors n° 112, octobre 2021.
[7] CGLPL, Avis relatif à la prise en charge des personnes transgenres dans les lieux de privation de liberté, 6 juillet 2021.
[8] CEDH, Van Kück c. Allemagne, 19 septembre 2003.
[9] Alinéa 3 du principe 9 des Principes de Jogjakarta de mars 2007.
[10] Produits accessibles à l’achat à travers une sorte de magasin interne à la prison.
[11] « Une personne transgenre discriminée par l’administration pénitentiaire à la prison de Muret », Dedans Dehors n° 118, avril 2023.
[12] Article R.225-3 du code pénitentiaire.
[13] « Maison d’arrêt de Pau : “Je suis considérée comme une femme et suis censée être fouillée par une femme”, s’est défendue Lindsay, anciennement Christopher », Sud-Ouest, 27 janvier 2023.
[14] « Affirmation d’un droit à exprimer son identité de genre par la tenue vestimentaire », Dedans Dehors n° 120, octobre 2023.
[15] Voir « Alessandra, femme trans en prison : “On s’est senties exhibées comme au zoo” », Dedans Dehors n° 94, décembre 2016.
[16] À la demande du ministère de la Santé, la HAS travaille actuellement à l’élaboration de premières recommandations visant à améliorer l’accompagnement et la prise en charge des personnes transgenres ou en questionnement sur leur identité de genre.
[17] CNCDH, Avis d’évaluation du plan national 2020-2023 de lutte contre la haine et les discriminations anti-LGBTI, novembre 2023.