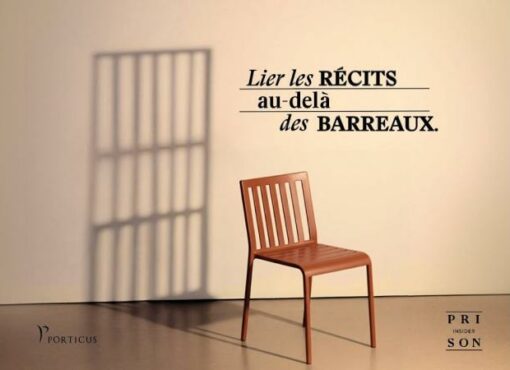Il n'existe en prison qu'un seul lieu, non surveillé, où sont autorisées les relations sexuelles : les unités de vie familiales. Avoir accès à ces unités est un droit, pour tout détenu. Pourtant, seulement 36 établissements pénitentiaires sur 188 en sont équipés. L'Etat condamne ainsi, sans le dire, les prisonniers et leurs conjoints à l'abandon de leur sexualité.
Interdire les relations sexuelles sans le dire. C’est le tour de force de l’institution carcérale. De fait, tout détenu surpris dans des rapports intimes au parloir est passible de sanction disciplinaire pour avoir « imposé à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur » . Un texte qui renvoie au délit d’exhibitionnisme. Pour qu’il y ait faute, il faudrait que « l’exhibition soit intentionnelle », soulève la professeur de droit Martine Herzog-Evans. Or, en réalité, les couples font tout pour se cacher. Mais dans un espace où aucun lieu ne doit échapper à la vigilance du personnel de surveillance, celui-ci se retrouve « contraint à observer l’intimité d’autrui, ce que, dans le monde libre personne ne songerait décemment à faire » comme le souligne Martine Herzog-Evans. Et les relations sexuelles ainsi découvertes peuvent être réprimées, sans être expressément interdites, ce qui serait probablement jugé contraire aux normes de droit supérieures, notamment constitutionnelles et européennes. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion d’affirmer que la Convention « protège le droit à l’épanouissement sexuel […] qui est l’un des aspects les plus intimes de la sphère privée ». Et le juge français a annulé le règlement intérieur d’un centre hospitalier qui interdisait « les relations de nature sexuelle » au motif que cette interdiction portait atteinte au droit à la vie privée des patients. La règlementation française s’est donc délibérément placée dans l’hypocrisie consistant à interdire de fait les relations sexuelles en prison, sans l’écrire dans aucun texte.

La loi de l’arbitraire
Et l’addition peut être salée. Elle commence parfois par une interruption tonitruante et immédiate de la visite. Le couple honteux se voit stigmatisé devant les autres personnes présentes au parloir. « La pire des humiliations en ce qui me concerne. Un sentiment de honte qui vous hante comme si toute la terre avait vu votre relation sexuelle », raconte Béatrice, compagne d’un détenu. Les conséquences s’enchainent en cascade. Aux sanctions de quartier disciplinaire pour le détenu ou de parloirs avec hygiaphone pour les prochaines visites, s’ajoutent des punitions indirectes telles qu’un retrait de réductions de peine pour « mauvais comportement ». Tandis que la compagne ou le compagnon « pris en faute » peut se voir suspendre quelques mois, voire annuler, son permis de visite.
Les pratiques des personnels pénitentiaires sont toutefois très variables. Une ancienne surveillante raconte que les agents en poste au parloir doivent « le vouloir pour vraiment voir. J’ai connu des collègues qui me disaient : « Celui-là, tu ne lui laisses rien faire » ou alors « Celui-là, il m’a saoulé en service de nuit, je vais le surveiller de près au parloir ». A l’inverse, explique Cathy, compagne d’un détenu, « il y a des surveillants plus compréhensifs, ils ne font pas de ronde pendant les parloirs ». Certains choisissent de ne rien dire : « Une fois, un surveillant nous a surpris. Mais de la façon dont j’étais habillée, il n’a rien pu voir. Il a juste compris. Il est ensuite parti, rien de plus. Certains surveillants ferment les yeux à partir du moment où c’est discret ». Réussir à voler quelques moments d’intimité dépend ainsi du bon vouloir de chaque surveillant, qui « définit de façon assez subjective la limite entre le toléré (« un quart d’heure » ; « quand il n’y a pas d’enfants ») et le sanctionné (des actes sexuels trop ostentatoires, le fait de se dénuder, la présence d’enfants) », indique la chercheuse Camille Lancelevée.
Effets pervers en tout genre
Les conséquences de la privation de sexualité sont nombreuses. Et graves. En 2000, un rapport d’enquête de l’Assemblée nationale soulignait déjà que « lorsqu’elles ont lieu, [les relations sexuelles] se déroulent dans des conditions indignes, avec des aménagements rudimentaires qui placent le couple, les familles présentes et leurs enfants, les surveillants, dans une situation extrêmement gênante ». « C’est vraiment à la sauvage, à la va-vite. On est sur nos gardes, plutôt concentrés à regarder si les surveillants ne passent pas », raconte Danielle. Et le sortant de prison, marqué par une sexualité « coupable », pourra rencontrer moultes difficultés. Face à la femme ou l’homme désiré, « il rencontrera avant tout un être dont il a été privé. Là où la sexualité devrait être contigüe à l’amour et au désir, chez lui elle sera associée à la frustration et à un désir de vengeance. Et son comportement sexuel pourra dans quelques cas être agressif, voire sadique », met en garde le thérapeute Jacques Lesage de la Haye.
Et les violences commencent dès la prison. La frustration sexuelle constitue un facteur d’aggravation des tensions et agressions au sein des établissements pénitentiaires. « Le plus grand problème de la privation de rapports sexuels, c’est une agressivité progressive qui contribue à la violence dans les rapports sociaux », relève Alain, détenu en centre pénitentiaire. Des études ont en effet montré que les détenus qui peuvent conserver des relations sexuelles avec leur compagne(on) sont moins violents en détention et causent moins d’incidents. Elles montrent aussi que « les Etats autorisant les visites conjugales ont un niveau inférieur de violence sexuelle en prison ». La privation de sexualité participe enfin de l’éclatement des couples, alors que le maintien des liens familiaux est identifié comme « l’un des facteurs décisifs de réussite d’un parcours de réinsertion. On comprend que la société aurait tout intérêt à garantir les droits à la sexualité des détenus ! », interpelle Martine Herzog-Evans
La réforme la plus lente de l’histoire pénitentiaire ?
Et pourtant, les autorités ne semblent pas pressées de faire avancer le dossier des Unités de vie familiale (UVF), petits appartements dans l’enceinte de la prison où des détenus peuvent recevoir la visite de leurs proches dans des conditions d’intimité. Camille Lancelevée narre ainsi « une gestation administrative de presque deux siècles (l’idée était déjà évoquée en 1814 sous terme de “cabanons”) ». Elle réapparait dans les années 1980 dans un contexte de réforme pénitentiaire et alors que plusieurs anciens détenus, à l’instar de Jacques Lesage de la Haye, livrent le récit glaçant de la misère sexuelle derrière les murs. En 1997, la section française de l’OIP lance sa première campagne : « Pour le droit à l’intimité ». Mais il faudra encore attendre le début des années 2000 pour qu’une expérimentation soit lancée dans trois prisons. En 2009, la loi pénitentiaire reconnait finalement à tout détenu le droit de « bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial ». Mais en 2015, seules 36 prisons sur 188 sont dotées de tels locaux, si bien que la loi reste inappliquée dans 85 % des établissements pénitentiaires. Un retard qui témoigne d’une conception encore purement afflictive de la peine dans laquelle la privation affective et sexuelle compte parmi les souffrances et les humiliations censées expier l’infraction commise.
Par Maxime Gouache et Sarah Dindo