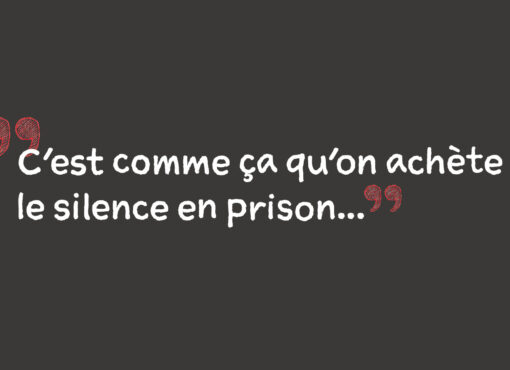Pour faire son deuil, il faut comprendre, mettre des mots, être soutenu… Un cheminement quasi-impossible pour les familles de personnes décédées en prison. Au sentiment d’impuissance engendré par le fait que leur proche leur était inaccessible s’ajoutent souvent le silence de l’administration, l’absence d’accompagnement sur les démarches à entreprendre, les obstacles à l’établissement de la vérité.
Le 12 juillet 2018, Mme V. reçoit un appel de la directrice de la maison d’arrêt de Perpignan. Son compagnon, père de ses deux filles, incarcéré dans l’établissement, est décédé la veille. La directrice lui indique qu’une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours pour établir la cause du décès et qu’elle sera contactée ensuite par un officier de police judiciaire pour récupérer le corps. « Mais l’appel n’est jamais venu », explique-t-elle. Après plusieurs semaines sans nouvelle, elle envoie un e-mail à la maison d’arrêt. La directrice lui répond qu’elle saisit les services du procureur pour avoir des informations sur l’enquête. Puis silence à nouveau. Fin août, elle écrit encore. Elle demande quelles sont les démarches à entreprendre, souhaite obtenir le rapport d’autopsie, récupérer le corps, les affaires de son compagnon… On lui répond que sa demande a été transmise au procureur, qu’on lui enverra « peut-être » un message. Elle finit par saisir directement le procureur : sans réponse. De guerre lasse, elle contacte les services médicaux-légaux de Montpellier, où le corps a été acheminé pour l’autopsie, afin d’y récupérer la dépouille. Impossible, lui explique-t-on, il faut au préalable obtenir un permis d’inhumer, délivré par le procureur. Celui-là même qui reste silencieux depuis plus de deux mois…
Cette situation kafkaïenne, si elle n’est pas des plus communes, est emblématique de l’abandon vécu par les familles lorsqu’une personne décède en détention, et de la désinvolture avec laquelle leur douleur peut être traitée. « Ce n’est pas normal que ce soit à nous de faire toutes ces démarches. Nous sommes une famille en deuil, traumatisée, et personne ne nous renseigne correctement », déplore Mme V. D’autant qu’à l’impuissance s’ajoute l’inquiétude de n’avoir aucun élément précis sur les causes et les circonstances du décès. « En l’absence d’information, on s’imagine le pire », reconnaît-elle. La famille de Bilal Elabdani, décédé le 10 août 2017 à la prison des Baumettes au lendemain de son incarcération, vit un calvaire similaire. Plus d’un an après son décès, elle n’a toujours pas de réponse à ses questions. Pourquoi a-t-on décidé de l’incarcérer alors qu’il était atteint de troubles psychiatriques graves ? Dans quelles circonstances est-il mort ? « Je n’arrive pas à faire mon deuil, explique sa mère. Je ne sais même pas comment il est décédé. Ils nous ont laissés dans l’incompréhension. »
Un devoir d’information
L’administration est pourtant tenue à un devoir d’information vis-à-vis des familles(1). En cas de suicide d’un détenu, la loi pénitentiaire de 2009 va plus loin et précise que « l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager »(2). Pour l’avocat Étienne Noël, qui défend des personnes dont les proches sont décédés en détention, « qu’il ait fallu un article de la loi pénitentiaire pour donner la marche à suivre en cas de suicide montre à quel point ce n’est pas naturel pour l’administration pénitentiaire ». Probablement consciente de cet écueil, celle-ci a récemment formalisé les procédures à suivre en cas de suicide, dont un volet est consacré aux actions vis-à-vis des familles et des proches(3). L’information doit être donnée dès que possible, y compris la nuit, peut-on y lire. Le chef d’établissement doit ensuite proposer une rencontre à la famille dans le but à la fois de répondre à ses questions et de faciliter le travail de deuil. À cette occasion, il est recommandé qu’il remette un écrit sur les démarches administratives et judiciaires à entreprendre, avec les coordonnées des différents interlocuteurs et d’éventuelles ressources pour bénéficier d’une aide médicale ou psychologique. Afin d’aider les personnes endeuillées, une visite de la cellule « doit impérativement être proposée » lors de cette rencontre, précise la note, « sauf impossibilité posée pour les besoins de l’enquête ». « Pour les familles, c’est très important de visualiser, de matérialiser les faits », explique Valérie Decroix, directrice des services pénitentiaires(4). Certains chefs d’établissement semblent effectivement soucieux de proposer cet accompagnement. Une femme, rencontrée par l’OIP à l’accueil-familles de la prison de Bois d’Arcy raconte ainsi, à propos d’une de ses connaissances dont le mari y est récemment décédé : « Elle a eu le droit d’aller visiter sa cellule et d’y passer autant de temps qu’elle voulait, ils n’avaient touché à aucune de ses affaires et ils ont apparemment été très chaleureux avec elle en la laissant voir d’autres endroits où son mari avait pu être durant son parcours. » Mais ce type d’attention fait figure d’exception. « Ce n’est jamais fait ! », s’exclame Me Noël. « Le protocole, chaque directeur l’interprète à sa façon, ils ont un pouvoir souverain », explique-t-il. Or « la plupart du temps, ils en disent le moins possible, pour garder le secret sur la manière dont ça dysfonctionne dans leur prison. Car un suicide, moi je considère que c’est systématiquement un dysfonctionnement ».
Comprendre « pourquoi et à qui la faute »
Pour briser le silence, l’avocat accompagne des familles dans des actions en justice qui permettent de récupérer tous les éléments du dossier. « Après un suicide ou une mort suspecte, une enquête préliminaire est toujours ouverte. Quasi systématiquement, ça fait l’objet d’un classement sans suite et une fois l’affaire classée, on a accès à la procédure. C’est difficile pour les proches de comprendre qu’avant ça, on ne peut rien récupérer. Mais une fois qu’on a la procédure, ça permet d’éclairer la famille sur les causes du décès », explique-t-il. L’accès à cette information est d’autant plus essentiel que, face au silence de l’institution, « ils imaginent n’importe quoi, ils se mettent à gamberger, ils se disent qu’il se passe des choses. Si la pénitentiaire était plus transparente, elle n’aurait plus ce problème-là », précise Me Noël. Une problématique qu’il retrouve avec encore plus d’acuité en cas de suicide, les familles étant souvent réticentes à accepter la thèse du suicide. « Elles n’y croient pas. Elles disent qu’il allait bien, allait sortir bientôt, avait des projets. Je leur explique que quand on est dans un état suicidaire, on est tellement mal qu’on s’en fout de savoir si on va sortir demain ou dans dix ans. On ne supporte plus rien, maintenant, tout de suite. »
L’accès au dossier permet aussi à l’avocat de discerner s’il y a eu une faute commise par l’administration pénitentiaire. Et, le cas échéant, d’engager une procédure pour faire reconnaître la responsabilité de l’État. « Les familles ont besoin de comprendre pourquoi et à qui la faute. J’ai des souvenirs de personnes qui ont vécu comme un véritable soulagement le fait d’obtenir qu’une responsabilité soit posée, en l’occurrence celle du garde des Sceaux. »
Quand les proches se mobilisent
La responsabilité de l’État, Salah Zaouiya a mis plus de dix ans à la faire reconnaître. Dix années de procédures judiciaires qui l’ont mené jusqu’au Conseil d’État. En 1996, son fils Jawad décède dans l’incendie de sa cellule. Très vite, cet habitant de Mantes-la-Jolie rencontre d’autres familles qui ont perdu un proche en détention. « Au départ, j’étais tout seul. Mais chacun dans son coin, on n’arrive à rien », explique-t-il. Ensemble, ils décident alors de créer l’Association des familles en lutte contre l’insécurité et les décès en détention (AFLIDD). Les objectifs de l’association : conseiller les familles, créer un réseau de solidarité, d’échange et de partage d’information, et sensibiliser le public. « On s’est organisé partout en France pour témoigner », se rappelle-t-il. « Car ils sont morts, d’accord, mais nous, on nous laisse seuls avec ça. On ne prend pas de nouvelles, on ne nous propose pas de suivi. C’est très dur à vivre. Surtout quand il y a une décision de classement sans suite. On a un des nôtres qui est entré en détention jeune, en bonne santé et qui en ressort mort. Comment peut-on accepter cela ? » L’un des chevaux de bataille de Salah Zaouiya, c’est aussi de « sortir de l’obsession des journalistes pour le suicide ». « On ne sait jamais vraiment ce qu’il s’est passé », explique-t-il. « Certains sont poussés au suicide. Nous, on demande qu’on arrête de parler de suicide et qu’on parle plutôt de mort suspecte. » Pour les chercheurs Gaëtan Cliquennois et Gilles Chantraine, la mobilisation des proches et des associations militantes n’a pas été sans influence sur la politique pénitentiaire (5). En témoigne, écrivent-ils, une note de l’administration pénitentiaire de mars 2000 qui précise que « l’accueil des familles des personnes qui se suicident doit être amélioré. Il a été constaté que, de plus en plus souvent, ces familles contestaient les circonstances du décès, relayées en cela par certaines associations et les médias ». Plusieurs notes suivront, qui insistent sur la nécessité de l’accueil des familles, « de manière à limiter les recours et les plaintes de celles-ci », précisent les chercheurs.

« Ne laissez plus les prisonniers mourir »
Mais les évolutions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Régulièrement, les proches de personnes décédées en détention continuent de se mobiliser pour demander plus de transparence sur les circonstances de leurs morts. En particulier lorsque celles-ci sont troubles ou que le décès fait suite à une altercation avec des personnels pénitentiaires. En avril dernier, le quartier du Mirail, à Toulouse, se soulève à la suite du décès de Jaouad au quartier disciplinaire de la prison de Seysses(6). La famille organise une marche blanche ; dans un communiqué, ses codétenus dénoncent des violences. Mais le ministère de la Justice choisit d’être silencieux sur les mesures prises – ou pas – pour établir les faits. Et préfère menacer de poursuites pour diffamation celles et ceux qui relaieraient de fausses informations. Idem en juillet, après le décès de Lucas Harel à Fleury-Mérogis. Alertés par des témoignages qui font état de violences qu’il aurait subies avant son décès, ses proches créent le collectif Justice pour Lucas, demandent des explications, organisent un rassemblement devant la prison, une marche silencieuse dans son quartier. Ils obtiennent comme seule réponse un rapport d’autopsie qui confirme la compatibilité de son décès avec une pendaison.
Face à une institution qui se refuse à rendre des comptes, des familles ont récemment lancé une pétition à l’attention de la ministre de la Justice(7). « Nous, familles et proches de détenus, prenons la parole pour dénoncer les conditions d’incarcération de nos proches et la loi du silence qui est appliquée à l’intérieur des prisons », commence la pétition. Et de poursuivre : « Nous parlons aujourd’hui en leur nom et en le nôtre pour vous demander : ne laissez plus les prisonniers mourir ! »
Par Cécile Marcel
(1) Article D427 du code de procédure pénale.
(2) Article 44 de la loi pénitentiaire.
(3) Mémento « Que faire après un suicide ? », ministère de la Justice, juin 2017.
(4) « Suicides en prison : l’hécatombe et le silence », Mediapart, 31 décembre 2017.
(5) Cliquennois G. et Chantraine G., « Empêcher le suicide en prison : origines et pratiques », Société contemporaines 2009/03, n° 75, p. 59-79.
(6) « À la prison de Seysses, des doutes subsistent autour d’une mort au mitard », Mediapart, 9 mai 2018.
(7) Pétition publiée le 12 août 2018 sur la plateforme en ligne Avaaz sous le titre « Parce que la prison tue ! Donnons-leur un accès aux services de secours ! »