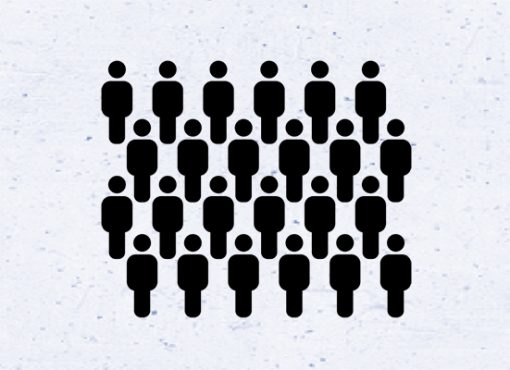Abdelhamid Hakkar a passé 28 ans derrière les barreaux. Révolté par sa condamnation à la perpétuité, il entre dans une lutte d’abord violente, puis procédurale, qu’il paiera de cinquante transferts et douze ans d’isolement. La rencontre avec un chef d’établissement qui voit en lui un homme doué de raison n’ayant plus rien à faire en prison le mènera à une libération conditionnelle en mars 2012.
Abdelhamid Hakkar, en liberté conditionnelle depuis mars 2012 après 28 ans de détention.
Jugeant le dossier falsifié, vous avez refusé de vous présenter devant les Assises, qui vous ont condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Où en êtes-vous par rapport à cette décision judiciaire ?
Je me suis battu juridiquement contre les conditions du déroulement de mon procès. J’assume avoir commis des infractions, mais je récuse l’accusation de meurtre ayant conduit à ce verdict. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour procès inéquitable et un second procès a eu lieu. Ce fut la même mascarade, avec des faux dans la procédure et la même condamnation à la clé. Seule la période de sûreté a été ramenée de 18 à 16 ans. J’étais très en colère de voir que des juges, qui nous prodiguent à longueur de journée des leçons de morale, nous rappellent les principes du droit, pouvaient être les premiers à s’en affranchir, en toute impunité. Aujourd’hui, je continue les procédures, je me battrai pour que justice soit rendue, aussi longtemps qu’il me restera un souffle de vie.
Votre combat visait-il aussi vos conditions de détention ?
Comme j’avais refusé d’être jugé en vertu d’une procédure falsifiée, je n’ai jamais pu accepter les conditions que m’imposait l’administration pénitentiaire, contre lesquelles je n’ai cessé de me battre. Pendant dix ans, ce fut par la violence, par tous les moyens possibles: des prises d’otages, quatre tentatives d’évasion, des révoltes, des grèves de la faim… Puis j’ai décidé d’employer les voies légales.
Qu’est-ce qui vous a fait renoncer à la violence ?
En 1999, j’ai à nouveau tenté de m’évader, armé. Ma mère en l’apprenant a fait un coma diabétique. Toute ma famille a été très affectée. Lorsqu’ils sont venus au parloir, j’ai eu un électrochoc. Si je continuais, j’allais anéantir ma mère et ma famille. Je me suis alors engagé dans un long travail de réflexion et d’introspection. J’ai réalisé que j’avais suffisamment de caractère et de capacités, même au fond des quartiers d’isolement d’une centrale, pour m’exprimer par le verbe et par la plume. Je me suis également rendu compte que la violence sert « le côté en face » : chaque incident conforte les sécuritaires, les demandes de renforcement des mesures de sécurité interne, toujours plus de barreaux, de murs, etc. A partir de là, je n’ai plus jamais eu de rapport d’incident.
Vos conditions de détention se sont-elles alors améliorées ?
Non, suite à ma dernière tentative d’évasion, j’ai passé cinq ans et demi à l’isolement, sans discontinuer, de 1999 à 2004. Grâce à une procédure à laquelle l’OIP s’est joint, j’ai obtenu que le tribunal administratif de Paris y mette fin, jugeant que les motifs de mon isolement n’étaient fondés ni en fait ni en droit, et que sur la durée cette mesure constituait un traitement inhumain et dégradant. J’ai néanmoins gardé le statut de « détenu particulièrement signalé » (DPS). Au total, j’ai subi plus de cinquante transferts et douze ans d’isolement.
Comment avez-vous vécu ces douze ans en quartier d’isolement ?
La journée s’écoule dans un silence mortifère, seulement brisé par le bruit des clés dans la serrure qui revient aux mêmes heures : le matin pour la promenade, midi pour la gamelle, puis le repas du soir. Tous les jours sont identiques. Aucune activité. Pour la promenade, un gradé assisté au minimum de deux surveillants vous accompagne comme on sort son chien, une heure le matin, une heure l’après-midi. Une petite cellule aménagée de deux ou trois planches de livres fait office de bibliothèque, on en a vite fait le tour. L’accès au téléphone a été extrêmement important, il a été autorisé en 1985 dans les établissements pour peine. Même si c’était très coûteux, je passais une heure ou deux par jour à parler avec ma famille et mes avocats.
Votre famille a été un soutien essentiel ?
Elle l’est toujours. Elle pèse dans mes réflexions, mes choix. A ma sortie, une rechute aurait été une trahison envers eux, c’était hors de question. Le Code de procédure pénale stipule que l’administration pénitentiaire a la mission de favoriser le maintien des liens familiaux. En réalité, tout est fait pour les détruire : les transferts à répétition, les humiliations lors de l’arrivée au parloir, l’attente dehors sous la pluie, les portiques, les palpations, les intimidations… Elles sont vraiment courageuses les familles qui continuent à venir au parloir, à faire perdurer l’amour pour l’un des leurs, auquel elles apportent un peu de leur vie de l’extérieur. Elles amènent cette lumière dont on a tant besoin quand on est enfermé, que l’on perd tous ses repères.
La réponse des directeurs était toujours mitard, isolement, mitard, transfert.
Vous avez perdu la notion du temps au fil de la détention ?
Une journée est si longue qu’elle vaut une semaine à l’extérieur. C’est infernal comme les journées ne passent pas et sont répétitives. On ne sait plus quel jour on est. Seul le dimanche fait exception, on sait que c’est dimanche, c’est plus mort que d’habitude. Mais du lundi au samedi, tous les jours sont identiques. C’est la lenteur mortifère de la prison.
Quelles stratégies avez-vous mis en place pour lutter contre la perte des repères temporels ?
Mes journées s’organisaient essentiellement autour de la préparation de procédures et recours. Je lisais des ouvrages de droit, j’écrivais sur mon ordinateur. L’administration connaissait l’importance pour moi de cet outil, qui me permettait de passer mes heures et mes nuits. D’un transfert à un autre, et même parfois sans transfert, mon ordinateur était sou- vent endommagé. Les personnels laissaient entendre que puisque je faisais du droit et de la procédure, je pouvais me plaindre et espérer obtenir un remboursement sur décision du tribunal administratif. Mais d’ici là, il allait s’écouler un an et demi… En attendant, soit tu t’en achètes un, soit tu restes sans ordinateur.
Vous avez signé « L’Appel des dix de Clairvaux », les « emmurés vivants » qui dénonçaient une mort « à petit feu » et en appelaient « au rétablissement effectif de la peine de mort ». Pourquoi cet appel ?
Ce manifeste est publié en janvier 2006, alors que se profile la campagne pour l’élection présidentielle de 2007. Il est une réaction à la politique pénale que nous avons vu se mettre en place: à l’instrumentalisation de la sécurité pour obtenir les suffrages des citoyens ; à son érection comme dogme qui supplante tous les autres principes; au développement des mesures de sûreté, de peines plus lourdes et plus sévères, qui rendent la sortie quasi impossible. On entend souvent que la perpétuité en France n’existe pas, que tous les détenus ont vocation à sortir un jour. Que le but de la prison est de les rendre à la société meilleurs qu’à leur entrée. Nous savons que c’est de la démagogie, que c’est tout le contraire. Mais au fil des ans, on se dit qu’on ne va jamais sortir.
Non seulement le législateur allonge les périodes de sûreté, mais nombre de longues peines se voient encore refuser tout aménagement longtemps après la fin de leur sûreté. La mienne était fixée à 16 ans, et au bout de 22 ans, j’étais toujours en prison. Alors que je n’avais plus de rapports d’incident, que je présentais des projets de réinsertion… Alors, oui, ce manifeste disait : « exécutez-nous au lieu de nous tuer à petit feu ». Suite à sa parution, le garde des Sceaux Pascal Clément est venu à Clairvaux avec des journalistes, dans l’idée de leur montrer que nous n’avions pas grande raison de nous plaindre. J’ai alors été désigné comme l’auteur du manifeste et transféré dans les heures qui ont suivi à Lannemezan, à 1 200 km de ma famille.
A quel moment de votre détention avez-vous entrevu une possibilité de sortie, quel a été le déclic ?
Fin 2006, je suis affecté à la centrale d’Ensisheim. Pendant deux ans et demi, je n’échange pas le moindre mot avec le personnel, jusqu’à ce qu’en 2008 un surveillant chef me conseille d’aller rencontrer le directeur. J’ai d’abord refusé, car je pensais que cela ne servirait à rien. Le surveillant chef a insisté, plusieurs fois, et j’ai fini par accéder à sa suggestion. Effectivement, les rapports avec ce directeur ont tout de suite été honnêtes et respectueux. Nous nous sommes vus deux ou trois fois, et il a pris l’initiative sans rien me dire de transmettre mon dossier pour une levée de mon statut DPS, qui bloque de facto toute possibilité d’aménagement. Grâce à son soutien et à celui du Procureur, qui a plaidé la nécessité de me laisser entrevoir une porte de sortie, mon dossier a été transmis au ministère. Le chef puis le directeur sont venus m’annoncer la levée de mon statut DPS : « M. Hakkar, le principal obstacle pour votre libération vient de sauter ». Le juge de l’application des peines (JAP) a été saisi, les conseillers d’insertion et de probation et le directeur m’ont soutenu. Pour eux, c’était le moment où jamais. A partir de ce moment-là, je me suis dit : oui, c’est possible et c’est peut-être une question de mois.
A partir du moment où l’on vous a considéré autrement que comme un détenu dangereux, le processus conduisant à votre libération a pu s’enclencher ?
Quand je suis arrivé à Ensisheim, mon dossier était marqué au fer rouge : révolté, fouteur de merde, attaquant sans arrêt la justice et la pénitentiaire… Auparavant, la réponse des directeurs était toujours mitard, isolement, mitard, transfert, isolement… Le directeur d’Ensisheim a fait la part des choses. Après trois ans d’observation, il a estimé que je n’étais pas celui décrit dans mon dossier pénitentiaire. Il a constaté que je ne causais pas le moindre incident. Il valorisait même le soutien juridique que j’apportais aux autres détenus et les résultats significatifs que j’obtenais en leur faveur. Il a vu que malgré mes années de captivité, je n’étais pas le fauve décrit mais un être doué de raison qui avait la tête sur les épaules, que je ne présentais aucune « dangerosité ». Bref, il a pensé que je n’avais plus rien à faire en détention.
Comment s’est construit votre projet de sortie, quels obstacles avez-vous rencontrés ?
J’ai gardé tout au long de mon incarcération des contacts avec des responsables de structures locales d’insertion que je connaissais avant, qui m’ont conservé leur soutien. Ils se sont d’ailleurs montrés précieux également après la sortie, aujourd’hui encore, ils m’accompagnent. Depuis l’année 2000, soit la fin de ma période de sûreté, le directeur d’une de ces structures m’a préparé et conservé un poste. Il sera appelé à renouveler l’attestation tous les trois mois, pendant
Ce directeur a vu que malgré mes années de captivité, je n’étais pas le fauve décrit dans mon dossier pénitentiaire. Il a pensé que je n’avais plus rien à faire en détention.
plus de 10 ans! Pour l’hébergement, c’est ma famille. Mon projet de réinsertion est resté le même jusqu’à ma sortie en mars2012. J’aurais pu sortir dès novembre2000 dans les mêmes conditions.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors de votre sortie ?
Tous les jours, je ressens les trente ans que j’ai foutus en l’air. Je dis bien « que j’ai foutus en l’air », pas « qu’on m’a volés ». C’est moi le premier responsable. Dans mon quotidien aujourd’hui, je vois un train qui m’est passé devant et que j’ai du mal à rattraper. Sur un certain mode d’organisation et de pensée, je n’ai pas changé. Je fais du sport, je me cadre et m’organise. Mais une journée passe si vite à l’extérieur, je manque de temps ! J’ai beau prendre des notes, faire des pense-bêtes, j’en oublie souvent. J’ai aussi moins envie d’aller vers les autres, alors que je suis plutôt extraverti et jovial. Sorti du bureau, je rentre chez moi. Je m’y sens bien, tranquille. Je sors peu.
Vous avez porté un bracelet électronique pendant un an, quel impact a eu cette mesure ?
Pendant les six premiers mois, le bracelet m’a stabilisé, même si c’était pénible. Il m’a permis de me cadrer, d’éviter de partir dans tous les sens, de faire tous les jours le bilan de ma journée, de me projeter sur le lendemain. Au-delà, il est devenu facteur de blocage, notamment en termes de vie sociale. Mais le JAP n’avait pas le pouvoir d’abréger la mesure, j’ai dû aller au bout. Quel plaisir quand les surveillants m’ont invité à le retirer, avec de grands ciseaux ! J’ai eu ce jour-là, plus que celui de ma sortie, un véritable sentiment de libération.
Vous êtes sous le régime de la libération conditionnelle, quelles obligations vous sont imposées ?
J’ai l’interdiction de fréquenter les bars, de porter une arme… Des interdictions qui tombent sous le sens pour quelqu’un qui souhaite se réinsérer ! De temps à autre, j’ai un échange téléphonique avec mon conseiller d’insertion et de probation. On se voit occasionnellement. Le plus contraignant pour moi est l’obligation de demander une autorisation pour quitter le territoire, alors que je souhaite rendre visite à ma famille en Algérie, et finaliser là-bas un projet professionnel, qui représente pour moi une façon de me prendre en charge. Le JAP me le refuse pour l’instant, pour des raisons administratives. Depuis trois mois c’est bloqué, je broie un peu du noir, mais je ne désespère pas d’un dénouement heureux.
Propos recueillis par Barbara Liaras