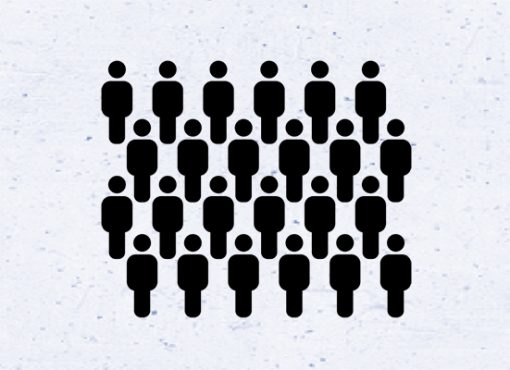Observatoire international des prisons : quel a été votre parcours avant de connaître la prison ?
Henri : Je suis né à Lyon, dans la rue où travaillaient les plus belles prostituées de la ville. Donc j’ai un peu baigné dans ce milieu-là. Mes parents ne s’occupaient pas de moi, je n’avais pratiquement personne. J’allais à l’école mais à l’âge de 10 ans, j’ai commencé à faire des conneries, je piquais des trucs dans les caves. On m’a alors envoyé pendant dix-huit mois en maison de redressement.
Comment expliquez-vous ces délits dès l’âge de 10 ans ?
Si j’avais été moins livré à moi-même, ce ne serait peut-être pas arrivé. Il n’y avait personne pour me dire ce qu’il fallait faire et ne pas faire. Nous vivions à six dans un appartement d’une pièce, sans jeux, sans activités. C’était invivable. Donc, les enfants, nous restions le plus possible à l’extérieur. Avec mon frère, on piquait des bouteilles de limonade ou de lait pour récupérer l’argent de la consigne et se payer une place de cinéma. Toute notre vie, il nous a fallu nous démerder.
Vous avez donc été envoyé en maison de correction ?
J’y suis entré à 10 ans avec mon frère. On ne nous avait pas prévenus, j’ai atterri là sans rien comprendre. Nous étions très mal nourris, nous mangions des pommes de terre crues. Au bout de dix-huit mois, j’ai été tellement malade, qu’on m’a renvoyé chez mes parents. Ils m’ont remis à l’école, mais comme ça n’allait pas du tout, j’ai été envoyé au pensionnat. Là aussi, les conditions étaient rudes : pas de chauffage dans nos chambres, même en plein hiver, alors qu’on se trouvait en Haute-Savoie ; manque de nourriture aussi. J’en ai gardé des cicatrices derrière la jambe, à cause de plaies qui ne guérissaient pas. Avec de tels manques, on ne peut pas suivre une scolarité normale. Après quelques années, mon frère et moi sommes sortis, nous avons été renvoyés sur Lyon.
C’est à cette époque que vous avez connu la prison ?
Oui, à 18 ans, j’ai été incarcéré quatre mois pour un vol de voiture. Ensuite, je suis parti à l’armée, dans l’aviation, je me suis marié et j’ai eu deux enfants. Mais nous étions des parents trop jeunes et sans travail. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de faire des coffres-forts, je ne voyais pas d’autre solution pour trouver de l’argent rapidement. Je me sentais coincé : des enfants à nourrir, des loyers et crédits à payer, pas d’aide sociale à l’époque, pas de parents en mesure de nous aider…
Jusqu’à ce que la justice intervienne ?
Au bout d’un certain temps, je me suis fait attraper et j’ai été condamné à dix ans de réclusion criminelle. C’était difficile d’accepter cette peine. Je ressentais un malaise constant en cellule. Je savais aussi que j’allais perdre ma femme, qu’elle n’allait pas m’attendre. J’ai tenté de m’évader et j’ai pris huit mois de plus.
Comment s’est déroulée cette détention ?
Les premières nuits, j’étais pris dans des cauchemars. C’était infernal de réaliser chaque matin que j’étais bien entre quatre murs et que l’extérieur, c’était fini. Je ne supportais pas l’enfermement permanent : même en promenade, on était enfermés. Il faut dire qu’à cette époque, jusqu’en 1961, les détenus n’étaient pas autorisés à s’allonger durant la journée, on devait rester debout en cellule. Si l’un de nous s’asseyait sur le bitume, les surveillants rentraient avec deux seaux d’eau et les balançaient dans la cellule. Et puis votre famille s’éloigne de vous et vous vous retrouvez vraiment seul : seul dans votre tête et dans votre combat face à la justice. Quand j’ai terminé ma première peine en 1974, ma femme s’était mise avec un autre. J’ai été marié et divorcé trois fois, toujours à cause de longues peines : la première à dix ans, la deuxième à douze ans, la troisième à quinze ans et la dernière à cinq ans. En tout, j’ai pris une cinquantaine d’années de prison et j’en ai fait 35 : la moitié de ma vie. J’ai aussi fait neuf mois de mitard. Mais progressivement, l’être humain s’adapte à tout.
De quelle manière ?
En trouvant des gars sympathiques avec qui on peut s’entendre, discuter de choses normales. Je prenais beaucoup sur moi, en gardant le sourire, même si en mon fort intérieur ce n’était pas ça. A chacune de mes affaires, j’ai aussi refusé de reconnaître les faits : c’était une façon de me mettre en lutte pour tenir, ne pas totalement subir la détention. J’envoyais des courriers sans arrêt, je me défendais. Dans une affaire, j’ai demandé 53 fois la liberté provisoire. J’étais toujours dans l’attente d’une réponse et après chaque refus, je faisais appel. Mais aujourd’hui, j’ai un pacemaker : le résultat d’années d’angoisse, de stress, de haine. On vit chaque chose différemment en prison : même le courrier, on en cherche le sens à travers les lignes. Je demandais tout le temps : « Pourquoi tu m’as écrit ça ? ».
Avez-vous trouvé des soutiens en détention ?
Un psychiatre de la prison de Saint-Paul m’a beaucoup aidé. Comme j’étais DPS [détenu particulièrement signalé, ndlr], j’étais à l’isolement et j’allais me plaindre un peu auprès de lui. Il m’a pris comme patient et m’a fait transférer au SMPR [service médico-psychologique régional, ndlr], où j’occupais un poste de balayeur, je servais également les repas. J’y suis resté trois ans et demi, cela se passait bien. Je m’occupais des détenus, j’ai fait entrer une télé couleur, un babyfoot, j’organisais des activités. Il y a eu aussi des moments difficiles : dans les années 1980, tout le monde se coupait les veines, j’ai vu beaucoup de suicides. Je devais ramasser à la pelle le sang par terre, le nettoyer. Un jour, un nouveau surveillant a ouvert la porte d’une cellule pour distribuer la fiole de médicaments. Il s’est retrouvé face à un détenu pendu au radiateur. Il a refermé la porte et il est tombé dans les pommes. Un autre surveillant m’a demandé de leur donner un coup de main, de couper la corde et de réceptionner le corps. A 22 heures, je me suis retrouvé dans le couloir de la prison, avec le directeur et deux surveillants, en train d’essayer de sauver le mec.
Voyez-vous la prison comme un temps utile ?
La prison détruit plus qu’elle ne guérit. Il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas y être : des malades, des gens très dépressifs… En prison, ils deviennent encore plus malades. Comme ils sont « faibles », ce qu’il ne faut pas montrer en détention, ils se font emmerder par les détenus. Cela devient vite insupportable pour eux et beaucoup se pendent, s’ouvrent les veines…
Qu’est-ce que l’on apprend en prison ?
L’évolution de la délinquance. Vous faites de nouvelles connaissances qui vous permettront de refaire des conneries à l’extérieur. C’est une préparation de la suite de la délinquance. Il ne suffit pas de punir, il faut guérir le mal à la base. Pourquoi des gamins en sont arrivés là ? Ce sont des fils de familles nombreuses, où il n’y a pas de boulot, c’est la misère. Dans mon quartier, je vois encore de nouvelles bandes de jeunes qui ne savent pas quoi faire. Leurs parents n’arrivent pas à payer le loyer, ils vendent du haschich pour nourrir leur famille. Et un jour, ils iront en prison.
Est-ce que l’argent dépensé pour un détenu [85 euros par jour en maison d’arrêt, 195 euros en maison centrale, ndlr] ne pourrait pas être utilisé pour prendre les jeunes en charge, assurer le relais des parents qui n’arrivent pas à s’en occuper, les mettre dans des centres d’apprentissage et les suivre ? Je ne crois pas qu’ils puissent y arriver tous seuls, par eux-mêmes.
Et vous, dans quelle situation sortiez-vous de prison ?
Fauché, je n’avais plus rien, plus de logement, plus de femme. Après ma première détention, j’ai quand même pu travailler comme chauffeur, j’ai rencontré une autre femme, nous avons eu un enfant. Je suis resté trois ans et demi dehors. Mais une fois que je n’ai plus eu de travail, je suis retourné en prison, pour un hold-up en 1977. Globalement, je ne trouvais pas de boulot et je n’ai jamais été aidé par l’administration pénitentiaire pour préparer ma sortie : ils nous font exécuter notre peine, mais dans quelles conditions nous sortons, ce n’est pas leur problème.
Comment reprenez-vous votre vie à la sortie de prison ?
C’est comme si une lampe éteinte se rallumait des années après. Il y a un trou dans le temps, la vie s’est arrêtée. On la reprend petit à petit, à partir des souvenirs très précis d’avant la prison. J’avais quitté des gosses en bas âge, et j’étais surpris de les retrouver sachant parler. Ma première femme avait une vingtaine d’années quand je suis tombé, et quand je sors dix ans plus tard, je ne me rends pas compte que j’ai vieilli, je continue à ne rencontrer que des femmes de 20 ans.
Et quand on sort de prison, on ne se dit pas « Cette fois-ci, j’arrête » ?
Tout le monde se le dit. Mais une fois que vous êtes dehors, il faut un logement, donc vous êtes obligé d’habiter chez quelqu’un car vous n’avez pas d’argent. Au bout d’un moment, ça devient impossible de rester là. Il faut mettre de l’argent de côté pour pouvoir se trouver un appartement, ce qui est difficile quand on gagne 1 000 euros par mois. Il faut arriver à se débrouiller le plus vite possible et on n’arrive pas toujours à trouver rapidement de l’argent autrement qu’en recommençant.
Avez-vous essayé d’aller voir des assistants sociaux à vos sorties de prison ?
Pas vraiment. Je suis allé les voir récemment par rapport à mon plus jeune fils, qui nous a été retiré et vit en foyer, où il souffre énormément. J’espère le récupérer bientôt. Mais globalement, les services sociaux, et aussi les juges, ils sont surchargés. Ils ne peuvent pas s’occuper des gens au cas par cas, ce n’est pas possible.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
Cela va faire un an que je suis sorti et que je suis calme. J’étais moins raide cette fois en sortant, j’avais un appartement meublé, un peu d’argent, la retraite, donc la possibilité de m’assumer. Le fait de ne plus avoir de contacts avec mes anciennes connaissances me libère aussi. Il m’arrive de voir des anciens qui ont fait des années de prison comme moi. Mais tout le monde s’est calmé, ça reste convivial. Je passe l’essentiel de mon temps chez moi, sur mon ordinateur, j’écris un bouquin. C’est aussi mon dernier enfant qui me tient aujourd’hui. Il est encore tout jeune et il part un peu en brioche, je dois m’occuper de lui, le remettre droit. J’ai eu quatre gosses et je n’ai pas beaucoup été auprès d’eux, donc j’essaie de me rattraper un peu. Je vais essayer de finir ma vie tranquillement. Je n’ai plus le choix.
Reste-t-il des traces de la prison dans votre quotidien ?
Je vis chez moi comme en cellule : je reste dans ma chambre, je ne vais jamais dans le salon. Je sors peu, aussi parce que je dois faire très attention à l’argent. Je calcule chaque dépense à partir de la petite somme que je touche tous les mois. Je reste aussi décalé dans le temps, je crois toujours que j’ai 50 ans alors que j’en ai 70. Les années de prison restent « non vécues », comme une coupure, un arrêt.
Recueilli par Jane Abad et Céline Reimeringer