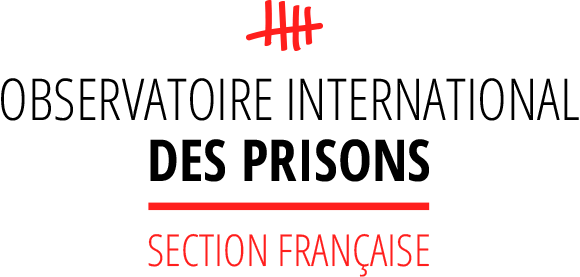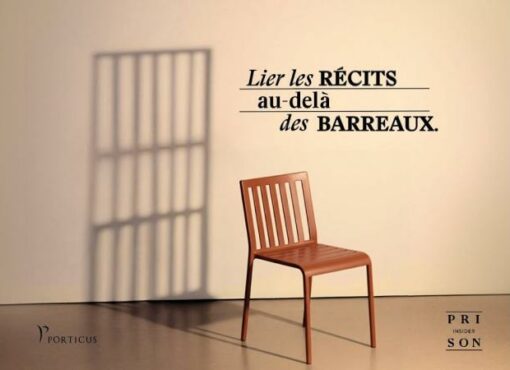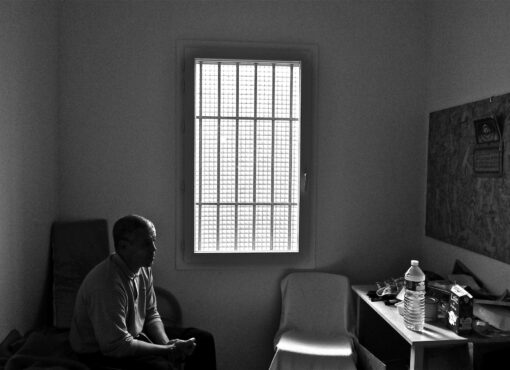Renouer avec ses enfants n’est pas le moindre des défis qui attendent les pères sortant de prison. L’enfant qu’on a laissé n’est plus le même, les retrouvailles imaginées mille fois se passent rarement comme prévu, et le lien qui se noue peut se révéler très différent de celui qui était entretenu derrière les barreaux.
Quand Gilles a retrouvé la liberté après sept ans de prison, son fils aîné avait neuf ans et il n’avait quasiment jamais vu le second, né peu après son incarcération. « Ça a été deux ans d’apprivoisement avant que je puisse vraiment jouer mon rôle de père. Comme on ne s’était quasiment pas vus pendant ma détention, on était sur un lien un peu imaginaire, ça a été compliqué d’en nouer des vrais. »
Il arrive que les retrouvailles soient simples et naturelles. Certains pères nouent même pendant leur détention des relations plus fortes avec leurs enfants qu’ils n’en avaient jamais eues auparavant. Mais souvent, la difficulté est d’autant plus grande que l’incarcération a été longue et les contacts, rares. « À la sortie, le père doit reconstruire sa place auprès de l’enfant. Et qu’il revienne dans sa famille ou qu’il y ait séparation, il a souvent beaucoup de mal à le faire, parce qu’il est un peu désadapté, doit se prendre en charge et redevenir acteur de sa vie », témoigne Martine Noally, présidente du Relais enfants parents (Rep) Isère et vice-présidente de la Fédération internationale des relais enfants parents (Frepi).
Gilles confirme avoir parcouru un long chemin semé d’embûches : « Nous sommes maintenant très soudés, mais ça m’a demandé beaucoup d’efforts et de patience, de passer par pas mal d’échecs aussi. Ils avaient une vision de moi liée à ce qu’ils avaient entendu, et ils avaient l’impression que je les avais abandonnés pour mon plaisir. Tellement de facteurs sont rentrés en ligne de compte : le caractère de mes enfants, leurs beaux-pères, leur entourage… » À sa libération, il n’est pas retourné vivre avec ses fils mais les hébergeait régulièrement – et s’estime particulièrement chanceux d’avoir eu les capacités matérielles de s’adapter à leur emploi du temps et à celui de son ex-conjointe. « C’est un parcours du combattant, il faut vraiment des appuis énormes pour réussir à renouer », souffle-t-il.
Un fossé à combler
Pendant l’incarcération, chacun a évolué de son côté, et les années ne sont pas passées à la même vitesse de part et d’autre des murs. « Pour beaucoup de pères incarcérés, le temps s’est arrêté : même s’ils passent dix ans derrière les barreaux, ils ont souvent tendance à vouloir repartir avec leur enfant là où ils s’étaient arrêtés. Et l’écart se creuse de plus en plus », note Charlotte Haguenauer, du service médico-psychologique (SMPR) de Fleury-Mérogis. Sans côtoyer l’enfant au quotidien, pas facile de prendre la mesure de son évolution et de s’y adapter. À l’inverse, celui-ci peut aussi construire une image décalée de son père incarcéré. Les projections de part et d’autre peuvent ainsi nourrir de profondes incompréhensions, des attentes déplacées ou des représentations fantasmées des relations après la peine.
« Il y a tellement de choses artificielles en détention, et la sortie est tellement idéalisée ! » souligne F., conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (Cpip) dans un établissement pénitentiaire pour peine du Sud-Est. « En permission de sortir ou en UVF [unité de vie familiale], le temps est figé, on sait que ça dure quelques heures, on en profite et il n’y a que des bons moments. Mais souvent, au moment de l’aménagement de peine, ça explose, car tout était basé sur des illusions. » Le passage de la relation à une dimension plus pratique et quotidienne peut constituer un choc d’autant plus rude que la sortie coïncide avec la découverte de la paternité : « Un détenu qui avait deux enfants en bas âge avec sa femme m’a dit qu’au bout de cinq jours de permission, il n’en pouvait plus, il avait envie de revenir en détention tellement ses enfants l’avaient épuisé », poursuit la Cpip. Si l’enfant est plus grand, les retrouvailles peuvent vite laisser la place à des questions difficiles, voire prendre des airs de confrontation. Sans compter que de mauvaises relations avec l’autre parent peuvent aussi barrer la route à toute reprise des liens.
La sortie de prison comporte déjà bien assez d’épreuves par ailleurs. « Le cerveau passe par tout un temps de réadaptation au monde extérieur », souligne Lucille Courtot, psychologue de l’association ARS95 intervenant au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. Au changement radical des repères quotidiens s’ajoute la nécessité de faire face rapidement aux impératifs de logement, d’emploi… « La personne a tellement à faire et à reconstruire à ce moment-là que les enfants sont rarement sa priorité », observe Martine Noally.
Un accompagnement précieux, mais précaire
Gilles n’a bénéficié d’aucun accompagnement pour se préparer aux retrouvailles avec ses enfants, comme peuvent en offrir les Relais enfants parents ou des associations comme ARS95 dans le Val-d’Oise. Il peut s’agir d’informer la personne sur les démarches à mettre en œuvre pour obtenir un droit de garde ou de visite, mais aussi de travailler sur ses attentes et représentations, celles du reste de la famille et leurs possibles réactions, afin d’anticiper le décalage et de prévenir les potentielles difficultés. « Pour nous, l’essentiel est qu’ils acceptent que les choses ne sont pas restées immobiles pendant leur incarcération », résume Lucille Courtot. Quand les parents sont concernés par des mesures d’éloignement ou des interdictions de contact, « il est essentiel de travailler à leur apaisement pendant la détention, de ne pas laisser se développer d’éventuelles colères ou angoisses, sources de potentielle récidive. Sinon, dès qu’ils sortent, ils se précipitent dans des endroits qui leur sont interdits, comme l’école des enfants, et ils retournent aussitôt en détention », souligne Martine Noally.
La vice-présidente de la Frep se dit aussi attentive à un risque contre-intuitif : celui d’une nouvelle rupture, à la sortie, de liens établis ou renoués pendant l’incarcération. Que les droits parentaux du père soient restreints ou qu’il soit absorbé par tous les autres défis inhérents à sa sortie de prison, « il est difficilement compréhensible, pour un enfant, de devoir attendre des mois un rendez-vous avec son parent après l’avoir vu tous les mois en détention. » Pour l’éviter, certaines associations tâchent d’organiser la transition entre dedans et dehors, ce qui présente de nombreux défis. « Nous essayons de travailler avec les espaces rencontre[1] et les SAS [structures d’accompagnement vers la sortie], là où il y en a. Mais ces derniers sont encore rares, et les premiers sont souvent saturés », soupire Martine Noally. Quand l’association en a les moyens, cette continuité peut aussi passer par l’accompagnement des personnes qui le souhaitent après leur sortie de prison. Kadir, libéré en 2022 et interdit de séjour sur le territoire où résidaient ses enfants, a ainsi pu les voir grâce au Rep Isère, qui les conduisait régulièrement jusqu’à lui.
Mais la continuité de l’accompagnement se heurte souvent au manque d’anticipation de la sortie – un problème encore accru par la récente réforme des remises de peine. « Nous sommes nous-mêmes très rarement au fait de la sortie ou du transfert à venir des messieurs que nous accompagnons, pointe Benjamin Ourghanlian, éducateur spécialisé d’ARS95. Les Cpip nous disent d’ailleurs parfois qu’ils ne sont pas au courant non plus. C’est très fragilisant pour notre accompagnement, et très préjudiciable aux liens parentaux. »
Outre ces difficultés d’anticipation, de nombreux professionnels regrettent que la préparation de la sortie, quand elle a lieu, fasse souvent l’impasse sur la reprise des liens familiaux, faute de temps et de moyens. Cpip au centre de détention de Neuvic et secrétaire local de la CGT Insertion Probation, Arnaud Deméret le reconnaît : « On a tellement de choses à prioriser… Souvent, la paternité n’est pas abordée spontanément dans la conversation. » Évoquant la mise en place de différents programmes destinés aux auteurs de violences intrafamiliales, Lucille Courtot décèle « une volonté de mise en mouvement [des Cpip] à ce niveau-là. Mais ils ont une telle charge de travail, un tel manque de temps, que pour l’instant, cela ne se traduit pas sur le terrain. »
Par Johann Bihr
Cet article est paru dans la revue Dedans Dehors n°121 – Décembre 2023 : « Ils grandissent loin de moi » : être père en prison
[1] Lieux d’accueil neutres et sécurisés mis à la disposition des familles, avec l’accompagnement de professionnels, quand la relation enfant-parents est interrompue, difficile ou conflictuelle.