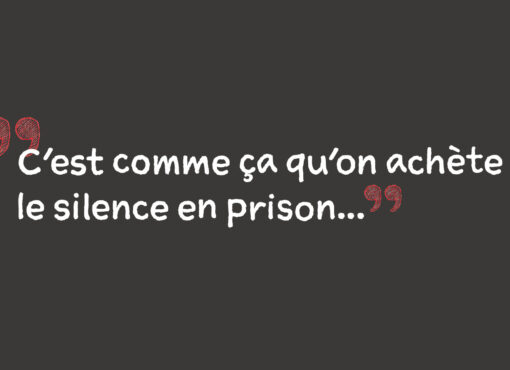Philippe Carrière a participé au premier groupe de travail mixte Santé/Justice sur la prévention du suicide en prison, en 1996. Vingt ans plus tard, rien n’a changé, ou presque, pour ce psychiatre. Et pour cause : trop occupée à vouloir empêcher le passage à l’acte, l’administration pénitentiaire en oublie de considérer le besoin d’aide des personnes en souffrance. Entretien.
Philippe Carrière est psychiatre en Bretagne. Il a exercé comme chef de service au service médico-psychologique régional (SMPR) du centre pénitentiaire de Châteauroux-Saint-Maur.
Vous avez participé à la rédaction d’un rapport sur la prévention du suicide en prison en 1996. Que pensez-vous de la situation aujourd’hui, plus de vingt ans après ?
Philippe Carrière En matière de prévention, les choses n’ont pas beaucoup avancé. Au lieu de considérer le besoin de soutien psychologique des personnes détenues, c’est toujours l’idée d’empêcher le passage à l’acte qui domine. J’ai connu l’époque où un détenu soupçonné de vouloir se suicider pouvait être mis à nu et envoyé au quartier disciplinaire avec seulement deux matelas, l’un devant faire office de couverture – ils appelaient ça « le sandwich ». Je me souviens d’un directeur de prison qui regrettait que l’on n’officialise pas ce genre de pratiques : « Dans certains pays, on les met dans une cellule avec des caméras, nus, sans rien qui leur permette de se suicider. Mais nous on n’ose pas faire ça. » C’était effectivement le cas dans certaines prisons au Canada, mais ça n’empêchait pas les gens de se jeter contre les murs ! Il faut comprendre que l’on n’arrivera jamais à écarter tout risque. Ou alors c’est l’escalade : la camisole de force, la cellule capitonnée, etc. Mais traiter les gens comme ça, c’est inhumain, alors que la tentative de suicide est justement un appel à être plus humain. Si on met les gens dans un pyjama en papier complètement inconfortable, qu’ils sentent qu’on veut juste les empêcher de se tuer mais qu’on ne les écoute pas, ça ne fonctionne pas. Il faut retourner cette logique et trouver le juste équilibre entre humanisation, écoute et prévention. Prenons par exemple l’intensification des rondes de nuit : on casse le sommeil des détenus. Sur le plan de la santé mentale, c’est très mauvais. Nous on disait qu’il fallait respecter leur sommeil. Si on se contente de regarder par l’œilleton, ça va, mais s’il s’agit d’allumer et de faire en sorte que toutes les deux heures, le détenu fasse un geste, c’est aberrant. Et puis de toute façon, dans le cas d’une pendaison, la ronde, même deux heures après au lieu de quatre, c’est trop tard. Mais les recommandations du rapport de 1996 n’ont pratiquement pas été suivies et ce rapport n’était en réalité même pas connu. Cela tient surtout à l’indifférence qui règne en prison à l’égard des problématiques psy : ça n’est pas leur souci. Leur affaire, c’est que les choses se passent bien, que ça circule comme il faut.
C’est un véritable changement d’approche que vous proposiez.
Oui, face à un comportement suicidaire, la réaction devrait être d’essayer de comprendre pourquoi pour ce détenu le suicide est devenu le seul moyen d’expression. On fait une tentative de suicide quand on a perdu ce fil qui nous relie à la vie et à la société et qu’il ne reste plus que l’auto-agression pour exprimer la violence de ce qui nous arrive et la colère que cela génère. Parfois, ça peut paraître étrange, et les rumeurs les plus folles peuvent se répandre, très vite, parce qu’on ne peut pas croire que ça arrive à cette personne-là, à ce moment-là. Mais s’il y a eu une surenchère disciplinaire, par exemple après une altercation avec des surveillants, il devient possible que la personne retourne toute sa frustration et sa violence contre elle-même, puisqu’elle ne peut pas s’exprimer autrement. Elle est prise dans une espèce de vertige, de gouffre. Mais si elle a la possibilité de voir sa famille, de garder un lien avec les gens en qui elle a confiance et auprès de qui elle peut se raconter, se plaindre, ce n’est pas du tout pareil que si elle est réduite au silence total. Il ne faut pas perdre de vue que c’est le contact humain qui permet d’éviter le suicide. Et c’est donc l’abandon du contact humain qui pousse au suicide.
Pensez-vous que l’on puisse parler d’une responsabilité du personnel pénitentiaire ?
C’est l’un des grands problèmes en prison : les syndicats de surveillants ont un poids énorme. Et certains sont réellement dans une espèce d’escalade sécuritaire, avec un leitmotiv selon lequel le personnel ne serait pas bien traité parce que tout serait fait pour les détenus. Ils ont constamment l’impression qu’une amélioration des conditions de détention va les mettre en danger, ils s’y opposent donc de manière systématique. J’ai connu un directeur qui nous expliquait que la première chose qu’il avait faite en arrivant dans sa prison avait été d’améliorer le quartier disciplinaire [QD] et de mettre l’eau chaude aux lavabos. Le personnel lui en a terriblement voulu. « J’aurais dû faire d’autres améliorations avant d’amener celle-là. Mais le QD étant dans un tel état… », se désolait-il. Je me souviens aussi d’un détenu qui délirait complètement et qui s’était retrouvé au QD parce qu’il avait complètement barricadé et calfeutré sa cellule. Quand je l’ai vu, je l’ai fait transférer à l’unité pour malades difficiles, où il est resté quelques mois, le temps de se remettre. Mais à son retour en détention, le directeur l’a renvoyé au QD pour qu’il finisse d’exécuter sa sanction. Ça n’avait aucun sens, si ce n’est garder le dernier mot et envoyer un signal rassurant au personnel. Car si c’est bien le directeur qui décide des entrées et sorties au QD, il doit faire très attention à l’équilibre politique dans son établissement, et ça peut se révéler très compliqué de sortir quelqu’un, même s’il met sa vie en danger…
« Si on met les gens dans un pyjama en papier complètement inconfortable, qu’ils sentent qu’on veut juste les empêcher de se tuer mais qu’on ne les écoute pas, ça ne fonctionne pas. »
Comment agir pour améliorer la prévention ?
Aujourd’hui, on constate que la sur-suicidité en prison demeure, malgré les plans de prévention successifs. Or, quand les gens sont dans des endroits surpeuplés et insalubres, où il n’y a pas de travail, pas d’activités, ça n’est pas sans conséquences sur leur état psychologique. Alors dans l’immédiat, que faire ? Que les locaux soient corrects d’abord : saleté, promiscuité et insalubrité rendent les conditions de détention indignes et très inhumaines. Il faut aussi venir à bout de cette question de la surpopulation, qui empêche tout contact individualisé entre les détenus et les surveillants et limite ceux avec les soignants, les psychologues, etc. Il faudrait également favoriser les liens des détenus avec l’extérieur et notamment avec leurs proches : faciliter les parloirs, éviter les transferts réguliers d’une prison à une autre, généraliser les UVF [unités de vie familiale] bien sûr, etc. Enfin, il faut lutter contre l’oisiveté et proposer des activités qui ont du sens. La plupart des détenus sont dans l’inactivité totale. Et s’ils ne font rien, ils rentrent dans des combines, ils ruminent… C’est toute la qualité du séjour en prison qu’il faut revoir.
Recueilli par Laure Anelli