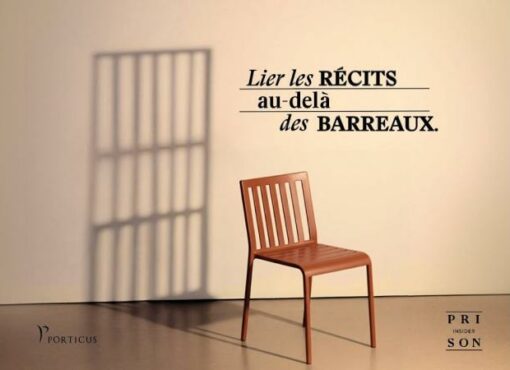Marie Douris, juriste, et Pascal Roman, psychologue, ont mêlé leurs approches pour étudier la parentalité en détention. Ils font le constat d’une relation parent-enfant fragilisée par la prison et décrivent une parentalité « empêchée », tant par des obstacles matériels que par la violence symbolique de l’enfermement. Entretien.
Marie Douris est chercheuse au Centre européen de recherches en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé de l’université de Bordeaux. Pascal Roman est professeur de psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse à l’université de Lausanne.
Quel est l’impact de l’incarcération sur l’autorité parentale ?
Marie Douris : D’un point de vue juridique, l’incarcération n’entraîne pas de conséquence automatique sur l’autorité parentale, sauf si une décision de retrait a été prononcée par la juridiction lors de la condamnation(1). Les droits afférents à cette fonction sont donc maintenus : par exemple le droit de visite et d’hébergement, le droit de saisir la justice pour organiser la vie de son enfant, le droit d’être informé d’actes importants et de participer à la prise de décision le concernant… Mais ce qu’on constate dans notre recherche(2), c’est que ces droits sont, en pratique, régulièrement mis à mal par l’emprisonnement, ou en tous cas diminués de fait.
Vous parlez en effet de « parentalité empêchée ». Quelles entraves constatez-vous ?
M.D. : Nous avons constaté une entrave juridique dans l’accès ou la mise en œuvre des droits des parents : l’impossibilité pour certains pères détenus d’établir leur filiation, c’est-à-dire de reconnaître un enfant né pendant la détention. Quand les parents sont mariés, ce n’est pas compliqué : le simple fait d’être marié à la mère qui accouche établit la filiation du mari, même s’il est détenu. En revanche, quand les parents ne sont pas mariés, la reconnaissance doit se faire par acte volontaire devant un officier d’état civil ou devant un notaire. Or, la situation des parents détenus les empêche quelquefois de sortir de la prison pour établir une filiation [parce qu’ils ne sont pas éligibles à une permission de sortir, ou parce qu’elle leur a été refusée, ndlr]. Il faut alors que le chef d’établissement organise la venue de l’officier d’état civil en détention, ce qui, au moment de notre enquête, était loin d’être systématique. Donc ces hommes savent qu’ils sont pères, mais ils ne sont pas parents juridiquement. Ils ne peuvent pas revendiquer cette qualité auprès de leur enfant ni auprès des institutions.
Quels obstacles rencontrent les parents détenus pour exercer leur parentalité au quotidien ?
M.D. : D’abord, il y a la difficulté à pouvoir être joint, qui les empêche de participer aux prises de décisions qui se posent au quotidien. La cabine téléphonique n’est souvent accessible que sur des créneaux restreints, qui ne correspondent pas forcément aux moments où la famille peut réceptionner l’appel. Tout cela empêche le parent détenu de prêter une attention constante à son enfant et de maintenir un lien avec lui. Certains y parviennent mieux que d’autres. Ils ne le disent pas toujours explicitement, mais on comprend que beaucoup sont appelés ou appellent par téléphone portable régulièrement, et que cela leur permet de maintenir un lien étroit avec leur enfant, avec sa réalité quotidienne.
Outre le téléphone, vous montrez que l’interdiction d’accéder à Internet aussi peut faire obstacle à la parentalité…
M.D. : La question de l’accès aux moyens de communication, et en particulier à Internet, est en effet fondamentale. Un exemple est revenu plusieurs fois : celui du suivi scolaire des enfants. L’Éducation nationale donne des codes d’accès aux parents pour qu’ils puissent aller voir en ligne les bulletins et suivre, plus largement, le parcours de leur enfant. Mais eux n’ont pas accès à Internet. Ils ont bien les codes, mais ils ne peuvent rien en faire. Ça devient ubuesque. Devoir contacter l’établissement scolaire pour leur demander de leur envoyer une impression d’écran au centre de détention, ce n’est pas forcément simple pour ces parents, qui peuvent le vivre comme une humiliation. D’autant plus qu’à chaque rentrée scolaire, il faut rappeler la situation pour ne pas être oublié de l’établissement.
Parmi les obligations des parents à l’égard de leur enfant, il y a un devoir d’entretien financier. Difficile de l’assumer, lorsque l’on est détenu…
M.D. : Les salaires en prison sont en effet très bas, et les produits cantinables parfois chers, ce qui laisse peu de marge. Et encore, pour ceux qui ont un travail : il y a des personnes qui souhaitent travailler pour pouvoir participer dans la mesure de leurs possibilités aux dépenses familiales, mais qui ne le peuvent pas. Au point même qu’une mère un jour a dit : « Comme il n’y a pas de travail ici, je vais demander à être transférée dans ce centre de détention dédié aux femmes à 700 km, parce que je sais qu’il y en aura là-bas. Je verrai peut-être moins mon enfant parce que c’est beaucoup plus loin, mais au moins, je pourrai contribuer financièrement. » Tout est dit.
D’après votre étude, 27 % des parents voient leur(s) enfant(s) au moins une fois par mois, seulement 11 % au moins une fois par semaine. Comment expliquer ce si faible recours au droit de visite ?
M.D. : Souvent, c’est l’autre parent qui va déterminer la place du parent détenu. C’est lui qui rend possible – ou non – la rencontre au parloir. Le maintien du lien entre le parent détenu et son enfant est donc très dépendant de la volonté du deuxième parent d’y concourir, ou on contraire d’y faire obstruction. Après, cela dépend aussi de l’âge de l’enfant. Plus il grandit, moins il est dépendant de son second parent pour aller au parloir, et plus sa volonté propre entre en jeu, dans un sens comme dans l’autre. On voit d’ailleurs que la fréquence des visites diminue avec l’âge. Le droit de visite du parent ne dépend pourtant pas, en principe, de la volonté des enfants et la suppression d’un droit de visite doit être en principe motivé par des motifs graves.
Pascal Roman : Les conditions concrètes de la venue en prison, et en particulier la manière dont se déroulent les contrôles, sont à cet égard déterminantes. Les parents détenus nous ont beaucoup dit leur effet dissuasif sur les visites d’un proche, et même sur eux : un certain nombre de parents préfèrent renoncer à voir leurs enfants plutôt que de leur faire leur subir, à eux et à leur conjoint, toutes ces difficultés et ce qu’ils présentent comme des humiliations.
De quelles difficultés et humiliations parlent-ils ?
P.R. : Du fait que, alors qu’ils ont parfois dû faire trois ou quatre heures de route, quelques minutes de retard puissent suffire à annuler la visite ; des contrôles à l’entrée, des interdictions, de l’arbitraire dans lequel certains objets peuvent être ou non transmis au parent détenu : les bonbons, les dessins d’enfants(3)… La procédure n’est jamais la même. Elle est pourtant réglementée, mais elle est interprétée à chaque fois différemment par le surveillant. Tout cela crée une insécurité difficilement supportable pour les personnes qui viennent rendre visite à un proche détenu.
M.D. : On a remarqué que les visites étaient plus faciles quand les enfants étaient accompagnés par le Relais enfants-parents(4). Parce que la question des fouilles ne se pose pas du tout de la même façon. Les enfants passent de manière simplifiée dans la salle dédiée, qui est aussi plus agréable que le parloir, plus adaptée à l’enfance, avec des jeux. C’est beaucoup plus humain que lorsque l’enfant vient au parloir.
P.R. : Et moins teinté de suspicion : c’est ce que nous ont beaucoup dit les parents détenus. Leur conjoint, leur parent, la personne qui accompagne l’enfant est vue par l’administration pénitentiaire comme un suspect potentiel, avec tout ce que ça implique de sévérité et de rigidité des contrôles. En arrière-plan, il y a pour les personnes cette idée qu’elles sont traitées, ou maltraitées, comme des détenus.
Vous évoquez également le caractère humiliant de ces visites au parloir pour les parents détenus eux-mêmes, qui peut avoir un effet disqualifiant. Dans quel sens ?
P.R. : C’est tout un contexte. Mais c’est avant tout, de façon unanime, le fait de devoir subir une fouille corporelle, avant la visite au parloir et au retour. L’un des détenus rencontrés a dit : « Ce n’est pas un viol, c’est une insulte. » Au fond, pour pouvoir mettre en œuvre sa parentalité, il faut en passer par ces humiliations. Il y a aussi toute la question du sentiment de suspicion à leur égard. Dans l’un des établissements, il y avait une salle réservée à l’accueil des enfants au parloir, mais la visite s’effectuait systématiquement en présence d’un tiers, bénévole, mais pas quelqu’un du Relais enfants-parents. Cette personne était là dans une espèce de position de garant, de contrôle, sans que cette présence ne fasse partie d’un projet d’accompagnement parent-enfant. C’était très mal vécu par les parents détenus.
M.D. : En fait, ça ressemblait à une visite en présence d’un tiers, sauf que ce n’était pas justifié par une décision juridique, d’où le sentiment d’injustice dont ils faisaient part.
Les parents détenus sont placés dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de l’institution carcérale, avec ses effets d’infantilisation. Il devient très difficile pour eux de rester les parents de leurs enfants.
Certains choisissent aussi de ne pas dire à leurs enfants qu’ils sont incarcérés…
P.R. : Dire à son enfant que l’on est en prison peut avoir un aspect extrêmement dégradant pour le parent. On connaît aussi la discrimination dont peuvent faire l’objet les enfants dont la détention de leur.s parent.s est connue, de la part des institutions (scolaire en particulier) ou de leur.e.s pair.e.s. Certains parents, pour protéger leurs enfants autant que leur estime de soi parental, préfèrent leur cacher leur incarcération, avec les stratégies classiques « papa est parti en voyage », quitte à ce que cela implique de ne plus les voir le temps de l’incarcération. Il y a aussi des parents qui nous racontent qu’ils disent qu’« ils sont au travail », qu’« ils sont à l’hôpital », y compris quand les enfants viennent les voir en prison. C’est tout à fait extraordinaire : une espèce de bulle de déni se développe, dans laquelle l’enfant est pris. On imagine bien que ça ne va pas pouvoir durer des années, mais cette stratégie permet à certains parents de trouver un compromis entre la honte liée au fait d’être incarcéré et la possibilité néanmoins de continuer à voir leur enfant.
Vous évoquez aussi une sorte de difficulté pour les personnes à assumer leur rôle de parent, du fait même de l’incarcération…
P.R. : Les parents détenus n’ont que très peu d’autonomie pour investir leur pratique de la parentalité, pour apporter directement les soins à leurs enfants. Du fait de l’incarcération, ils se trouvent d’une certaine façon disqualifiés dans la possibilité de manifester leur autorité au sens symbolique du terme. Ils sont placés dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de l’institution carcérale, avec ses effets d’infantilisation, si bien qu’il devient très difficile pour eux de rester les parents de leurs enfants. Parfois même, les parents détenus peuvent aussi devenir dépendants de leurs enfants, et ce de façon très explicite : ce sont leurs enfants qui leur envoient des mandats, qui s’inquiètent pour leur santé, ou des relations qu’ils pourraient avoir avec les autres détenus, etc. On assiste alors à un renversement des générations, lié à l’incarcération.
M.D. : Un bon exemple en est le droit de visite. Ce droit qu’ont les parents, même séparés, est complètement inversé en prison : c’est l’enfant qui vient voir son parent. Donc c’est l’enfant – ou le parent qui est dehors – qui va accepter ou refuser que le droit de visite puisse avoir lieu. C’est un renversement total des positions, dans lequel le parent détenu est condamné à la passivité.
Recueilli par Laure Anelli
(1) L’autorité parentale peut être retirée totalement aux parents qui mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de leur enfant. Le retrait de l’autorité parentale peut également être prononcé par une juridiction pénale si le parent est condamné pour un crime ou délit commis sur l’enfant ou l’autre parent, ou s’il est reconnu coauteur ou complice d’un crime ou délit commis par son enfant.
(2) Menée dans trois prisons françaises en 2014, cette recherche a donné lieu à deux articles dans la revue Dialogues (n° 211, 2016/1) et à un ouvrage est à paraître en 2019 : Douris, M. & Roman, P. (éd.), Être parent en prison ? Un défi aux institutions, Erès.
(3) L’association Uframa note à ce propos une nette amélioration entre 2012 et 2017 : 92,3 % des personnes interrogées déclarent aujourd’hui pouvoir apporter des objets (doudous ou jouets notamment) ou des créations personnelles (comme des dessins ou des bricolages) au parloir, contre 27% en 2012.
(4) Le Relais enfants-parents se présente comme « un service d’aide au maintien des relations entre l’enfant et son parent incarcéré », essentiellement par le biais de « visites médiatisées au sein d’espaces protégés dans les détentions ». « Vu la recrudescence des demandes, cette association fait parfois le choix par défaut de ne s’adresser qu’aux parents séparés. Pourtant, les distances, l’activité professionnelle notamment du parent détenu pourraient souvent justifier que l’association prenne le relais », relève Marie Douris.