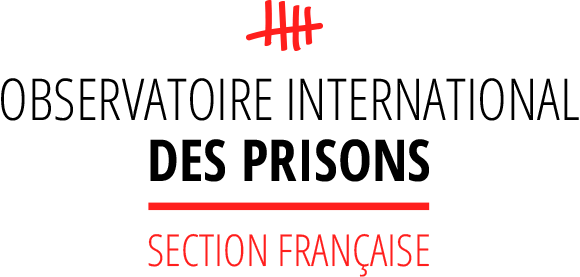Caroline Mourgues et Jocelyne Boulet représentent deux collectifs citoyens qui s’opposent à la construction de nouvelles prisons sur leur territoire, respectivement à Muret (Haute-Garonne) et Noiseau (Val-de-Marne)*. Elles retracent les étapes de ces mobilisations et échangent sur leurs stratégies, leurs défis et les dynamiques que ces luttes produisent.
Comment a démarré la mobilisation contre la construction d’une nouvelle prison à Muret ?
Caroline Mourgues : Le projet remonte à 2016, mais pour nous tout a commencé en 2019, quand le groupe « Prison » de la Ligue des droits de l’homme (LDH) toulousaine, où je milite depuis longtemps, a appris qu’il était remis à l’ordre du jour. Dans le Muretain, on a déjà une maison d’arrêt et un centre de détention de 600 places chacun, et aucune fermeture n’est prévue. Il s’agirait donc d’une troisième prison.
Nous avons commencé par aller à la pêche aux informations : consulter le cadastre, solliciter l’administration pénitentiaire, etc. Notre première préoccupation portait sur le tout-carcéral, la construction d’une nouvelle prison en soi. Mais nous nous sommes vite rendu compte que la population n’était pas au courant du projet et qu’il y avait un vrai problème démocratique. L’enquête publique s’est tenue pendant le Covid. Aux premières réunions, il n’y avait personne : nous étions cinq de la LDH et deux ou trois propriétaires de terrains concernés. Nous avons suivi de près toutes les procédures de participation citoyenne, déposé des contributions… Mais en fin de compte, le préfet a pris l’arrêté de déclaration d’utilité publique (Dup) en 2021 malgré les contributions opposées au projet, et même l’avis négatif du commissaire enquêteur, ce qui est extrêmement rare. Le projet était imposé d’en haut et la population était exclue des discussions. Même les élu·es nous ont dit ne pas avoir été consulté·es.
L’effectivité de la citoyenneté, le pouvoir d’agir des citoyen·nes sur leurs droits et libertés, c’est au cœur des missions de la LDH. Donc notre premier objectif a été de faire connaître le projet, avec de premiers tractages en 2019, mais surtout à partir de 2021, après le Covid. Nous avons organisé un ciné-débat à Muret, qui nous a permis de rencontrer des habitant·es qui avaient déjà commencé à s’organiser de leur côté. Peu après, nous avons organisé une réunion publique sur le projet, le lien entre prison et précarité, et les alternatives possibles, à l’exemple de la ferme Emmaüs de Lespinassière, dans l’Aude. Cet événement a permis de réunir pas mal de monde d’horizons différents : les « suspects habituels », comme des représentants du Saf [syndicat des avocat·es de France], mais aussi des habitant·es, agriculteur·rices, riverain·es, et de jeunes abolitionnistes. Tout le monde a pu s’exprimer librement, et à la fin, nous étions une cinquantaine à convenir de nous regrouper pour lutter contre ce projet. Nous avons tout de suite convenu que nous allions travailler ensemble à partir de notre plus petit dénominateur commun, l’objectif que ce projet ne se fasse pas. C’est comme cela qu’est né le collectif.
Nous avons organisé plusieurs rassemblements devant la sous-préfecture pour demander un moratoire sur le projet. Outre l’enjeu démocratique et celui des politiques pénales, nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait aussi un enjeu environnemental, avec des menaces sur les terres agricoles, une friche protégée, des sources et des nappes phréatiques. Cela a poussé des associations environnementales à nous rejoindre.
Et à Noiseau ?
Jocelyne Boulet : C’est vraiment la population de Noiseau et des villes environnantes qui a cimenté la mobilisation citoyenne. Nous avons appris dans le journal, en 2018, que Noiseau avait été sélectionné pour accueillir une maison d’arrêt de 800 places. Cela s’inscrivait dans le projet de construire un nouvel établissement dans chaque département francilien, sauf à Paris. La mairie était opposée au projet et elle a organisé une première marche citoyenne, avec des élu·es locaux·les, qui a bien fonctionné. Ensuite, plus aucune information jusqu’à l’annonce officielle du plan « 15 000 places » par Jean Castex en avril 2021 : c’est là que nous avons eu la confirmation que Noiseau était retenu. La mairie a organisé une deuxième marche, avec beaucoup d’élu·es, mais la mobilisation a été moindre. Notre députée (Modem) a alors décidé d’organiser une consultation citoyenne. Mais c’était en plein été, et même si la consultation a donné 96 % de « non » au projet, seules 449 personnes y ont participé, soit à peine plus de 10 % des 4 000 habitants de Noiseau.
Avec un groupe d’une dizaine de citoyen·nes, nous nous sommes dit que ce n’était pas possible d’en rester là, et nous avons décidé de lancer une pétition papier. Nous avons fait du porte-à-porte, le soir et le week-end, pendant trois semaines. Les gens travaillaient, c’était assez épuisant, mais nous avons atteint notre objectif : récolter 2000 signatures, soit environ 60 % de l’électorat de Noiseau. Cela a relancé la machine, en permettant à la fois d’informer les gens et de les amener à se positionner. Au départ, beaucoup pensaient que c’était fichu d’avance.
Mais ce qui a vraiment signé la naissance du collectif, c’est quand nous nous sommes demandé ce que nous allions faire de cette pétition. Nous l’avons finalement envoyée à des élu·es de tous les niveaux, jusqu’au ministre de la Justice et au Président de la République. Nous avons eu la chance de rencontrer un employé du Sénat, qui a facilité les contacts avec les cabinets de responsables politiques. La retraite arrivant, j’ai arrêté de travailler, ce qui m’a permis d’avoir du temps et de rencontrer du monde. Et pour pouvoir aller en justice, nous avons repris une association préexistante, avant de créer la nôtre, l’Aruche, en 2023. Tout cela s’est construit petit à petit, assez instinctivement. Ce n’était pas aussi structuré qu’à Muret.
Avec les tracts, le porte-à-porte et les permanences, l’une de nos grandes fiertés est d’avoir réussi à mobiliser les citoyen·nes lors de la réunion de concertation de l’Apij [Agence publique pour l’immobilier de la justice], en 2023 : plus de 600 personnes, soit davantage que la capacité de la salle, contre un maximum de 200 attendues !
L’avantage, à Noiseau, c’est que l’ensemble des élu·es – le maire, mais aussi au niveau de la région, du département, des villes environnantes, les parlementaires, etc. – sont avec nous. En septembre dernier, le département a voté un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PPEAN), et la région Île-de-France a voté son nouveau Schéma directeur (Sdrif-E), dont nous attendons la validation par le Conseil d’État : tous deux protègent les terres agricoles de Noiseau. Nous avons besoin de garder leur soutien, de n’avoir aucune opposition de leur côté. Le collectif citoyen a donc créé une relation suivie avec l’ensemble des élue·es, qui nous accueillent toujours très bien. La position de beaucoup, c’est : « Des prisons, pourquoi pas, mais pas sur des terres agricoles ». Alors nous laissons un peu de côté les questions de politiques pénales, nous misons tout sur l’enjeu démocratique et l’enjeu environnemental.
CM : À Muret, nous avons la chance d’avoir un environnement politique local sensible à l’ensemble de nos arguments, sur tous les thèmes. La commune, la communauté d’agglomération, le conseil départemental et la chambre d’agriculture ont tous rendu des avis négatifs dans l’enquête publique. Notre député (Nupes) soutient le collectif et a porté une question à ce sujet au Parlement. Au niveau de la région Occitanie, le groupe écologiste nous a demandé de lui présenter la situation et de développer nos arguments sur la surpopulation, avant d’adopter une motion s’opposant au projet.
Restons un instant sur les différents arguments que vous mobilisez et leur articulation. Si je comprends bien, la question des politiques pénales et pénitentiaires créant des tensions à Noiseau, elle est mise en sourdine dans l’idée de se concentrer sur le plus petit dénominateur commun ?
JB : Oui, car il y a des divergences à ce sujet, chez les politiques comme au sein de la population. On nous demande parfois : « En quoi cela vous gêne qu’il y ait une prison ? » Nous en discutons, nous argumentons, mais du coup nous privilégions la question de l’artificialisation des terres agricoles. C’est ce qui mobilise le plus, localement : l’enjeu démocratique et l’enjeu environnemental. D’autant que les agriculteur·rices sur ces terres sont aussi des familles noiséennes, le plus jeune a 20 ans, ce qui ajoute une dimension sociale à ce combat.
CM : Quand je tractais le samedi matin sur le marché de Muret, si je disais « environnement », « terres agricoles en danger » ou « climat », les gens prenaient le tract, mais si je disais « prison », les gens ne s’arrêtaient pas. Il ne faut pas se le cacher. Cela a fait l’objet d’échanges et de compromis au sein du collectif : une partie des camarades disaient que nous courions le risque de mettre en danger notre combat si nous le centrions sur la question carcérale. Entre les habitant·es, les agriculteur·rices et les abolitionnistes, nous pouvions avoir des discours assez opposés à l’origine, mais avec l’objectif de travailler ensemble malgré tout. Il faut savoir être à l’écoute, s’imposer des compromis, un « pacte de non-agression », à commencer par ne pas dire « Pas ici mais ailleurs »… Il y a eu des tensions, mais tout le monde a évolué en découvrant d’autres univers. Des riverain·es disaient ne pas avoir conscience de ce qui se passait dans les prisons, leur regard a évolué. Mais on ne va pas se mentir, ce n’est pas l’argument pour lequel les gens viennent sur le sujet.
JB : Cela dit, à Noiseau, quand nous expliquons à quel point les prisons sont en mauvais état, les gens comprennent qu’il vaudrait mieux les rénover qu’en construire de nouvelles. Ils se montrent aussi sensibles à l’allongement permanent des peines, au fait que même si l’on construit de nouvelles prisons, cela ne suffira jamais : que c’est plus un problème sociétal que pénal. J’ai beaucoup de discussions avec les politiques sur les conditions de détention. En visitant les prisons, ils et elles se rendent bien compte que c’est l’enfer. Quelles que soient leurs convictions politiques, tou·tes reconnaissent que les conditions de détention sont lamentables. Si bien que beaucoup finissent par dire : « S’il y a de l’argent pour construire une nouvelle prison, utilisez-le plutôt pour rénover Fresnes, dans le même département. »
CM : À Muret aussi, nous avons proposé de plutôt rénover la maison d’arrêt de Seysses, de la restructurer pour en faire tout autre chose. Nous parlons du rapport de la CGLPL [Contrôleure générale des lieux de privation de liberté], qui la qualifie de « prison de la honte » pour sa vétusté…. Nous parlons aussi de la régulation carcérale, de l’expérience du Covid qui a montré que l’on pouvait vider les prisons. Et surtout, nous mettons en avant l’idée que d’autres solutions existent. Comme le dit Jocelyne, la question du coût, de l’argent public, est un argument qui porte. Les gens sont à l’écoute, cela leur parle, ils voient bien que la prison ne fonctionne pas. Alors que les structures alternatives, le placement à l’extérieur par exemple, cela fonctionne. Dans la durée, j’ai l’impression que cela prend dans l’opinion publique.
JB : Tout à fait. Quand on leur montre les chiffres du budget de l’administration pénitentiaire, les gens peuvent basculer en un clin d’œil.
Vous diriez que la contestation de ces nouvelles prisons a pu infuser localement et nourrir une remise en cause des choix de politique pénale ?
CM : En ce qui nous concerne, c’était notre objectif dès le départ. Nous voulons avant tout que le projet ne se fasse pas, mais si nous arrivons au passage à sensibiliser l’opinion publique sur l’impasse des politiques pénales actuelles et l’intérêt des alternatives, nous aurons déjà gagné quelque chose. Mais nous savons que c’est un combat de long terme.
JB : Pour ma part, c’est plus personnel que collectif. Je n’avais pas de cause particulière à défendre, je me suis engagée à titre purement citoyen. Initialement, comme beaucoup, je suis partie de l’évidence que sacrifier les terres agricoles de Noiseau était une absurdité. Je ne connaissais pas vraiment la politique pénale, même si ayant travaillé dans une association de prévention spécialisée, j’avais pu la toucher du doigt. J’ai beaucoup appris à travers cette mobilisation.
La lutte locale est donc aussi un canal d’échanges d’information, de montée en compétence ?
JB : Tout à fait. J’ai lu beaucoup de rapports sur les politiques pénales. Et cela m’a donné des arguments pour convaincre, par exemple sur l’augmentation continue de la population carcérale : les gens réalisaient qu’on ne s’en sortirait pas et signaient notre pétition.
CM : Je parlerais même de formation. À un moment, nous venions avec des PowerPoint sur les décisions de la CEDH [Cour européenne des droits de l’homme], les recommandations de la CNCDH [Commission nationale consultative des droits de l’homme] etc., pour donner de la matière au collectif sur les questions pénales et pénitentiaires. C’est crucial sur un sujet aussi méconnu, avec tant de choses à déconstruire. Et à l’inverse, j’ai moi-même été formée par les associations environnementales sur les espèces protégées, les nappes phréatiques, l’artificialisation des terres agricoles… Au sein du collectif, nous nous aidons mutuellement à répondre aux questions qui nous sont posées, à trouver les arguments pour les réunions publiques, les tractages, etc.
Vous avez aussi porté le combat sur le plan juridique. Quelles actions avez-vous mises en place ? Quelle est votre stratégie ?
JB : Les agriculteur·rices de Noiseau ont porté un recours contre l’occupation temporaire des sols et le financent, même si nous le soutenons. Au niveau du collectif, nous avons déposé un recours contre le projet d’intérêt général (Pig) qui est sorti au printemps 2024. Le département, le territoire, la région Île-de-France, la ville de Noiseau et les communes voisines le contestent aussi. Le Pig permet de bloquer un périmètre, validé par arrêté préfectoral, à l’intérieur duquel l’État peut mener son projet. Nous contestons sa validité, car il vise essentiellement à contrer le vote du Sdrif-E : même si ce dernier n’autorise pas la construction d’une prison sur les terres agricoles de Noiseau, le Pig permet de passer outre. Au-delà, nous voudrions faire entendre la parole des citoyen·nes, toutes les pétitions et contributions, et souligner que si la préfète décide le contraire, c’est un problème démocratique. Mais les délais ont été très courts et pour l’instant, notre avocat s’en est tenu à la partie urbanisme. Au total, sept recours ont été déposés contre le Pig, et personne n’a encore reçu de mémoire en défense.
Pour le moment, on ne voit pas de nouvelle offensive de l’Apij sur le terrain à Noiseau. Nous prenons plaisir à voir le blé, l’orge et le colza pousser dans nos champs, tout juste bousculés par des biches venues de la forêt… Mais nous suivons de près l’actualité. Nous guettons par exemple l’appel d’offre annoncé par le ministre de la Justice pour la construction de prisons modulaires : la structure technique peut changer, mais les lieux d’implantation n’ont pas été remis en cause.
CM : En ce qui nous concerne, la LDH n’étant pas basée à Muret, la question de l’intérêt à agir est une contrainte forte pour les recours en justice. La commune de Muret et des riverain·es ont déposé des recours contre la Dup. Ils n’ont toujours pas été audiencés à ce jour. Ces recours ne sont pas suspensifs, ce qui permet à l’administration pénitentiaire d’avancer. Pour pouvoir faire les travaux, un arrêté d’autorisation de destruction des espèces protégées sur le site a été pris en février 2023. La protection de l’environnement fait partie de l’objet social de la LDH, donc c’est un acte que nous pouvons attaquer : nous avons intenté un recours contre cet arrêté en août 2023, avec les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et l’association Cesaam [Citoyens et citoyennes pour l’écologie et la solidarité à et autour de Muret], qui fait partie du collectif. Mais nous n’avons toujours pas été audiencés. En décembre 2023, nous avons constaté que des travaux d’archéologie préventive avaient commencé, et qu’ils entraînaient une destruction des espèces protégées. Nous avons rapidement déposé un référé-liberté, qui a été rejeté, puis un référé-suspension, que nous avons perdu.
Le droit de l’environnement n’est pas effectif à l’heure actuelle. C’est une législation complexe et assez nouvelle que beaucoup, au sein de la magistrature administrative, ne maîtrisent pas encore. Nous avons donc enclenché la vitesse supérieure : une plainte au pénal pour infraction au droit de l’environnement, du fait des travaux d’archéologie préventive. Nous en sommes sans nouvelles à ce jour. Nous suivons de près les aspects juridiques de la lutte contre l’A69, parce que ce sont les mêmes problématiques. Dans leur cas, c’est la plainte au pénal qui a permis de saisir l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Et c’est l’OFB qui a donné raison aux associations sur certains aspects du dossier.
Pour pouvoir détruire des espèces protégées, il faut démontrer qu’il y a un intérêt public majeur, pas un simple intérêt public. Et ici, l’intérêt majeur est fondé sur la surpopulation carcérale : la nouvelle prison permettrait soi-disant d’y répondre. Du coup, nous attaquons cet argument, et je crois que c’est inédit : notre premier argument est de dire que la construction de prisons ne répond pas au problème de la surpopulation carcérale. Ensuite, on ne peut détruire des espèces protégées dans un « intérêt public majeur » que si on démontre qu’on a recherché des solutions alternatives. Or, ici, aucun autre terrain, aucune autre solution n’a été recherchée. C’est d’ailleurs ce qu’avait soulevé le commissaire enquêteur dans son rapport de l’enquête publique. Notre troisième argument concerne les mesures d’« évaluation, réduction et compensation » qui sont censées être mises en place : il s’agit d’évaluer, réduire et compenser l’impact de ce projet sur les espèces protégées et sur l’eau. Or nous considérons que les mesures prises sont ridicules. Le terrain de compensation trouvé est situé derrière la maison d’arrêt de Seysses, sur une ancienne gravière : on va prendre les chauve-souris, la faune, les végétaux et les déplacer sur ce terrain… Nous attendons l’audience.
Il faut souligner que l’accès à la justice pose un problème démocratique. Quand le sous-préfet nous dit d’attaquer ses actes, la question des moyens se pose forcément. Le droit de l’urbanisme et de l’environnement, ce sont des dossiers excessivement lourds, des mémoires de plus de 60 pages, qui demandent énormément de temps de travail et de technicité. Et il y a toujours le risque de perdre, voire de se faire condamner.
Dans l’immédiat, qu’est-ce que cette mobilisation a produit, pour vous personnellement, et collectivement sur le terrain ? Peut-on parler de politisation, par exemple ?
JB : Il y a de cela. Je me retrouve à avoir beaucoup de contacts avec des politiques, ce qui me gêne un peu car je n’en ai pas la formation, mais on apprend vite. Au sein du collectif, nous avons aussi appris à gérer les médias et les réseaux sociaux. C’est donc un nouveau métier à temps plein ! L’Aruche est d’ailleurs devenue la première association de Noiseau en nombre de membres. Mais avec les procédures en justice contre le Pig et la Dup à venir, il faut tenir sur la durée. L’impulsion initiale était forte, mais comme cela ne bouge pas vite, il faut toujours porter le sujet à bout de bras… C’est assez épuisant. On nous incite parfois à entrer en politique, mais ce n’est pas notre sujet. Nous sommes là pour nous battre contre la prison et conserver ce poumon vert, c’est tout. À cet égard, nous avons parfaitement conscience que l’unanimité des élus locaux de tous bords est un atout, et cela nous conforte sur l’absurdité du projet. C’est presque au-delà de la politique.
Les échanges entre collectifs sont très intéressants, parce qu’on voit bien que tout le monde va faire face tôt ou tard aux mêmes questions. Je regrette un peu que nous ne soyons pas plus en lien avec tous les mouvements locaux qui luttent contre la construction de prisons. J’ai fait connaissance avec Caroline lors d’une rencontre à Vaux-le-Vicomte, mais seuls cinq collectifs étaient présents. L’idée que l’on pouvait avoir de rassembler l’ensemble des collectifs liés au « plan 15 000 » s’est finalement révélée difficile à mettre en œuvre : les enjeux sont très différents. Mais cela n’empêche pas d’échanger entre nous, et de nous soutenir mutuellement.
CM : Autour de Muret, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un réseau associatif très important, et les thématiques peuvent se croiser. Nous nous retrouvons au sein d’un collectif toulousain qui lutte contre les projets inutiles avec les mouvement contre l’A69, la Zac du Rivel, etc. Nous avons mené de nombreuses actions conjointes dans ce cadre, et nous sommes toujours là avec un stand et une banderole « Non à la troisième prison à Muret ». Les collectifs se soutiennent les uns les autres. Et avec l’association environnementale de Muret, les habitant·es qui nous ont rejoint et qui n’étaient pas des militant·es à la base, nous sommes arrivé·es à militer ensemble. Nous avons créé plus qu’un partenariat, un vrai collectif, avec des bases et des règles de fonctionnement. C’est une très belle histoire : nous ne nous connaissions pas, nous avions des points de vue très différents, et jusqu’à ce jour nous avons su construire une relation de confiance. C’est un résultat qui me touche.
Propos reccueillis par Prune Missoffe et Johann Bihr
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°126 – Surpopulation carcérale : les personnes détenues prennent la parole