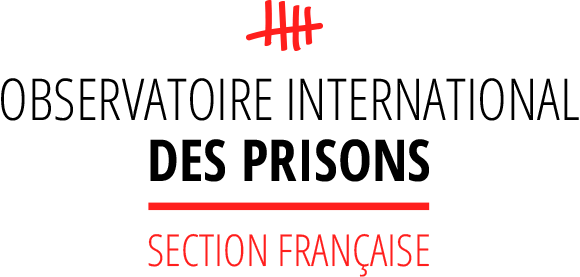Observer, comprendre, dénoncer. Retour sur une année d’engagement citoyen dans les prétoires, au plus près des personnes confrontées à la comparution immédiate.
« Si vous ne commettiez pas de délit, Monsieur, ça n’arriverait pas ». Cette phrase cinglante a été entendue par une bénévole de l’Observatoire international des prisons – section française (OIP) lors d’une audience de comparution immédiate au tribunal judiciaire de Paris. Un prévenu dénonçait les violences subies lors de son interpellation. Cette formule incarne ce que représentent aujourd’hui les comparutions immédiates : une justice à part, expéditive, dans laquelle l’espace laissé aux personnes prévenues pour s’exprimer est extrêmement restreint.
Depuis l’été 2024, une équipe de bénévoles de l’OIP a entrepris de se rendre régulièrement dans les audiences de comparution immédiate. Cette initiative poursuit plusieurs objectifs : favoriser un engagement citoyen, permettre à chacun et chacune de mieux comprendre le fonctionnement réel de la justice, et rappeler aux magistrat·es, par la présence d’observateur·ices dans les tribunaux, que la justice ne se rend pas à huis clos — qu’elle doit respecter les règles fondamentales du droit. Le cas échéant, il s’agit aussi d’alerter lorsque de graves dysfonctionnements sont constatés.
Une procédure expéditive, au détriment des plus précaires
La comparution immédiate (CI) est une procédure, choisie par le procureur de la République, qui consiste à traduire sur-le-champ, immédiatement après la fin de la garde-à-vue, des personnes majeures accusées d’un ou plusieurs délits, s’il estime que les charges sont suffisantes, que l’affaire est en état d’être jugée et que le cas le justifie. À l’audience, le tribunal est composé de trois magistrats. L’affaire peut être jugée immédiatement, si la personne, assistée d’un avocat, y consent. Dans les faits, peu de prévenus demandent à ce que le jugement soit différé car le risque d’attendre en détention provisoire son jugement est alors grand. Juridiquement, l’incarcération des personnes est facilitée en comparution immédiate. En effet, la détention provisoire peut être prononcée quelle que soit la peine encourue. Quand la personne est jugée, elle peut être immédiatement incarcérée (via un mandat de dépôt) quelle que soit la durée de la peine prononcée et même si elle n’est pas en récidive, contrairement aux audiences où les personnes comparaissent libres.
Il s’agit donc d’une procédure accélérée, où les droits de la défense sont mis à mal. Les chiffres sont connus de longue date : la durée moyenne d’une audience en comparution immédiate est de 29 minutes[1], et elle aboutit 8,4 fois plus souvent à une incarcération qu’une audience correctionnelle classique[2]. Si cette procédure ne représente qu’une fraction du contentieux pénal, son usage ne cesse de croître. Entre 2001 et 2024, le nombre de comparutions immédiates a presque doublé, passant de 31 213 à 60 348 affaires annuelles[3].
Or, les personnes renvoyées devant ce type d’audience ne sont pas Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ce sont, majoritairement, des personnes en grande précarité. Le choix du parquet de recourir à cette procédure repose en effet sur l’absence de garanties de représentation : pas de logement stable, absence d’emploi régulier, situation administrative précaire et souvent les trois à la fois. Ces critères de vulnérabilité deviennent alors des justificatifs de rapidité – et trop souvent, de brutalité.
Ce sont donc les personnes les moins insérées dans la société qui se retrouvent confrontées à des tribunaux surchargés, où la volonté d’aller vite prime sur le respect des droits. Et le profil des prévenu·es semble, aux yeux de certains magistrat·es, justifier cette précipitation. Après tout, s’ils n’avaient pas commis d’infraction, ils n’en seraient pas là.
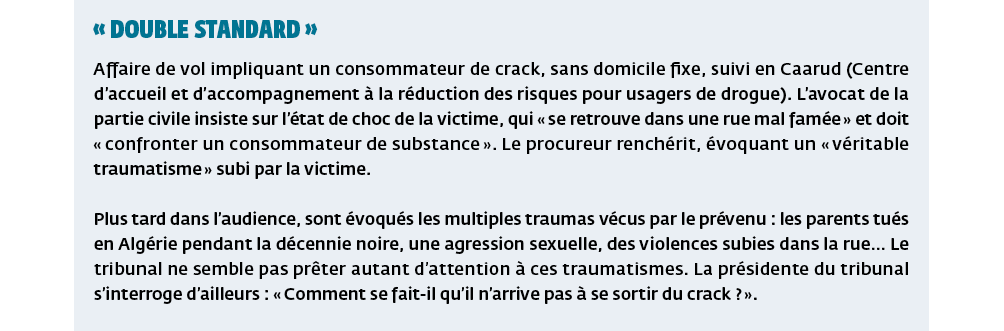
Une dynamique citoyenne en construction
Après avoir été présent·es quotidiennement aux audiences des tribunaux de Paris et de Bobigny durant les JO de l’été 2024, les bénévoles de l’OIP ont marqué une pause pour réorganiser leur action : refonte de la grille d’observation, amélioration de la formation initiale, et mise en place d’un suivi renforcé des nouveaux·elles observateur·ices.
Depuis novembre 2024, les activités ont repris et une formation mensuelle est proposée. Mais l’équipe s’est vite rendu compte qu’1h30 de formation initiale ne suffisait pas pour appréhender la complexité de la procédure. Des rencontres régulières ont donc depuis été organisées en ligne. Le collectif La Sellette, qui observe les audiences à Toulouse depuis 2021, ainsi qu’Ana Pich, illustratrice et chroniqueuse judiciaire (voir son interview p.33), ont été invité·es à partager leurs expériences. D’autres intervenant·es issu·es du monde judiciaire (magistrat·es, avocat·es, sociologues) ont ensuite contribué à renforcer l’expertise collective.
Observer une audience est en effet un exercice exigeant. Il faut être attentif à chaque détail, parfois essentiel : une phrase du procureur, une décision de mandat de dépôt ou de peine avec sursis, un oubli de procédure… Il n’est pas évident, pour des observateur·ices novices, de maîtriser le jargon judiciaire ni d’adopter la posture adéquate. Mais l’objectif reste clair : documenter, objectivement et sans voyeurisme, le fonctionnement réel de la justice pénale.
À ce jour, les bénévoles ont été présent·es dans neuf tribunaux différents. Parmi les observations relevées, beaucoup évoquent des dysfonctionnements organisationnels liés à une justice débordée ou expéditive. Des dossiers incomplets ou non transmis aux avocat·es à temps, des renvois fréquents en raison de l’absence d’éléments essentiels de la procédure, des problèmes techniques comme une mauvaise sonorisation nuisant à la compréhension de la procédure par le public. C’est aussi la rapidité de la procédure et le comportement des magistrat·es qui surprennent les observateur·ices : des verdicts lus à toute vitesse sans regarder les personnes prévenues, des jugements sarcastiques sur les personnes détenues et leur parcours, etc.
Un premier anniversaire placé sous le signe de l’engagement
Cette initiative bénévole a été initiée à l’été 2024 avec le sentiment d’urgence ressenti par certain·es de devoir faire « quelque-chose » dans le contexte d’une montée de la logique répressive. Ce premier travail a participé à la réflexion entreprise par l’OIP en lien avec les Jeux Olympiques et le volet sécuritaire qui accompagnait l’évènement. Tout au long de l’été, ce sont plusieurs « perles de compa » (disponibles en ligne sur le site de l’OIP) qui ont pu être portées à la connaissance du public et alimenter la réflexion politique autour de l’usage devenu trop systématique des comparutions immédiates.
Depuis, un travail a été fourni pour continuer à gagner en crédibilité. Certaines formulations dans la première grille d’observation manquaient de clarté, l’analyse des données n’a pas suffisamment été pensée en amont, le suivi des observateur·ices fraîchement arrivées n’a pas toujours été possible… L’équipe de bénévoles qui s’est constituée pour poursuivre l’organisation de cette initiative a progressivement veillé à améliorer la procédure : la grille d’observation en est à sa troisième édition, deux statisticiens sont sur le coup pour nous aider à traiter les données récoltées et un soin particulier a été porté à préserver l’anonymat de ces informations sensibles. Ainsi, l’observatoire des comparutions immédiates a pu fêter dignement sa première année d’existence et espère pouvoir poursuivre ce travail dans les prochaines années.
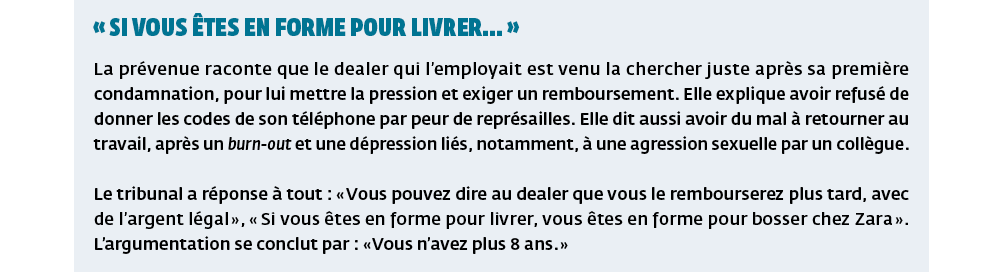
par Yves Januel
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°127 – Une société qui s’enferme : la répression comme seul horizon
[1] Raoult S. et Azoulay W., « Les comparutions immédiates au Tribunal de Grande Instance de Marseille, rapport pour l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux », 2016.
[2] Gautron V. et Retière J-N, « La justice pénale est-elle discriminatoire ? Une étude empirique des pratiques décisionnelles dans cinq tribunaux correctionnels », 2013.
[3] Chiffres clés de la Justice, Service statistique ministériel justice, 2024.