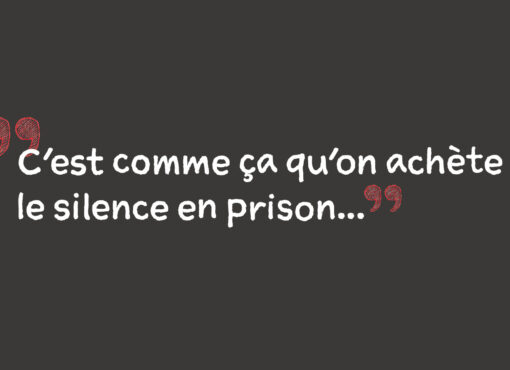Tous les deux jours, une personne décède en détention. Des drames qui soulèvent de nombreuses questions. Celle de l’opacité qui entoure souvent ces morts ; du silence opposé aux questions des proches, familles et codétenus, d’autant plus violent qu’il semble teinté d’indifférence. Celle du manque de considération donnée à l’humain, par l’institution, empêtrée dans ses logiques gestionnaires et sécuritaires. Et qui au final, se protège plus qu’elle ne protège.
Jamais autant de nos interlocuteurs ne nous auront répondu « qu’ils ne pouvaient pas s’exprimer sur cette question ». Qu’ils soient personnels pénitentiaires, soignants ou même intervenants extérieurs, ceux qui parlent n’ont accepté de le faire qu’anonymement. Il faut reconnaître que le sujet est sensible. Et le phénomène, massif. Au 24 septembre, 86 personnes s’étaient donné la mort en prison depuis le début de l’année, d’après les chiffres transmis par la direction de l’administration pénitentiaire ; 48 étaient décédées de cause naturelle ; 17 étaient mortes de façon encore inexpliquée à cette date, les conclusions de l’autopsie, systématique en cas de suicide ou de mort suspecte, n’ayant pas été rendues.
Sujet tabou, la mort des personnes dont elle a la garde est pourtant prise très au sérieux par l’administration pénitentiaire. La jurisprudence des tribunaux et cours administratives n’y est sans doute pas étrangère : l’État est en effet régulièrement condamné pour faute, notamment dans des cas de suicides. Et les menaces de poursuites contribuent à entretenir un climat délétère, comme à Fleury-Mérogis, qui enregistre son plus macabre record : quinze décès, dont treize suicides, en neuf mois (lire page 17). À l’heure où les responsabilités doivent être établies, la pression sur les personnels est aussi lourde que la chape de plomb qui recouvre ces morts. Et les tensions en détention, plus vives que jamais.
Écouter ce que ces morts nous disent
L’administration ne ménage pourtant pas sa peine pour contrer le phénomène suicidaire. Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, pas moins de trois rapports ont été commandés sur le sujet. Elle s’est dotée de nombreux outils : grille de repérage du risque suicidaire, mesures de surveillance renforcées, mais aussi cellules de protection d’urgence (CProU) – ces cellules lisses sans aucun point d’arrimage pour éviter les pendaisons – ou encore dispositifs de protection d’urgence (DPU), composés de pyjamas en papier déchirables et de couvertures ignifugées. Mais « tout cet attirail » ne sert qu’à « supprimer la corde que l’on se passe au cou », déplore Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté entre 2008 et 2014.
Trop occupée à vouloir empêcher la mort, l’administration oublie de considérer la vie.
« Au lieu de considérer le besoin de soutien psychologique des personnes détenues, c’est toujours l’idée d’empêcher le passage à l’acte qui domine », regrette encore le psychiatre Philippe Carrière, qui avait participé, en 1996, à la rédaction du premier rapport sur le sujet. La circulaire du 29 mai 1998 qui en avait découlé avait pourtant posé en principe qu’une politique de prévention du suicide n’est « légitime et efficace » que dans la mesure où « elle cherche, non à contraindre le détenu à ne pas mourir, mais à le restaurer dans sa dimension de sujet et d’acteur de sa vie ». Mais, trop occupée à vouloir empêcher la mort, l’administration oublie de considérer la vie – les vies. Et d’écouter ce que ces morts nous disent. Car à chaque décès en détention, c’est bien tout le système qu’il conviendrait de réinterroger.
Des prisons démesurées et déshumanisées
Si la surpopulation est régulièrement citée pour expliquer la sur-suicidité en détention, il est un facteur qui n’est que trop rarement considéré : la taille, démesurée, de certains établissements, et la gestion déshumanisée qui en découle. « On construit des super paquebots pour faire des économies d’échelle, mais quand on essaie de proposer des actions, on s’aperçoit qu’on touche une minorité des détenus. En réalité, on ne connaît que 10 % de la population. Les autres, on les oublie. Ils ont une vie réglée, mais l’administration ne les connaît pas et ne sait pas répondre à leurs besoins. Alors dans une maison d’arrêt, de surcroît surpeuplée, avec un surveillant pour cent détenus, comment voulez-vous qu’on y arrive ? », se désespère Damien Pellen, représentant du Syndicat national des directeurs pénitentiaires. « On est dans des situations où plus personne ne connaît personne, appuie Jean-Marie Delarue. Par conséquent, il ne faut pas attendre des surveillants la moindre parole de réconfort. Le repérage se fait aussi beaucoup moins bien. » Quant à la prise en charge de la souffrance et des pathologies, elle est loin d’être optimale, dans ces établissements où l’offre de soin est bien souvent insuffisante.
La sécurité avant tout, y compris la vie
Ces prisons-usines portent aussi la marque d’une surenchère technologique et sécuritaire, qui ajoute à la déshumanisation des rapports. « Le sécuritarisme, ça on sait faire. On sait garder, mais à quel prix ? », s’interrogeait un travailleur social en maison d’arrêt, à l’occasion d’un rapport sur la violence en détention(1). Dans un souci de gestion rationalisée, et guidé par une conception de la sécurité étriquée, on a multiplié « les substitutions de l’homme par la machine (la commande électrique à la clé pour l’ouverture des portes et des grilles), en rendant les personnes moins visibles (efforts de réduction des mouvements, glaces sans tain…) »(2). Les interactions directes se raréfient entre des détenus et surveillants maintenus à distance les uns des autres, nourrissant l’anonymat et la défiance des seconds vis-à-vis des premiers. C’est peut-être aussi en partie pour cela que les appels à l’aide de personnes détenues ne sont pas toujours pris au sérieux par les personnels. Une tendance que l’on qualifiera facilement « d’erreur d’appréciation », une fois la mort survenue, à l’heure où il faudra bien expliquer – si ce n’est aux codétenus et aux proches du défunt, au moins aux autorités – comment on a pu laisser le pire arriver. La multiplication des filtres (interphone), des grilles, des sas et autres consignes de sécurité sont, en outre, autant d’obstacles à franchir qui ralentissent l’intervention des équipes en cas d’urgence ; or, la mort se joue parfois à quelques minutes. Une question taraude en pensant à toutes ces personnes suicidées : si certaines tentatives de suicide sont en fait des appels à l’aide, combien de détenus sont morts en espérant inconsciemment l’intervention d’une équipe de nuit qui n’est jamais venue – ou en tous cas trop tard ?
Si certaines tentatives de suicides sont en fait des appels à l’aide, combien de détenus sont morts en espérant inconsciemment l’intervention d’une équipe de nuit qui n’est jamais venue – ou en tous cas trop tard ?
Autre exemple emblématique de la primauté à la « sécurité » : le placement au quartier disciplinaire de personnes repérées comme suicidaires, alors même que ce lieu est identifié de longue date comme suicidogène. Comble de l’absurdité : certains y sont même envoyés en pyjama en papier, ceux-là même qui sont utilisés dans la prévention du suicide. Comme si l’obsession de la punition devait l’emporter sur toute autre considération, y compris celle pour la vie. Sur les quatorze personnes qui se sont donné la mort au QD en 2017, au moins deux avaient été repérées comme suicidaires lors de leur entretien d’accueil dans ce quartier, et au moins trois avaient des antécédents de tentative de suicide ou d’automutilations(3).
Des silences violents
« Mourir en prison, c’est d’abord un silence. Un grand silence qui recouvre le bruit », écrivait Anne Lécu, religieuse et médecin en milieu pénitentiaire, dans un billet de 2017. Lorsqu’un décès survient en détention, la plupart du temps, celui-ci est tu. Si bien que c’est souvent par le bouche-à-oreille que les personnes détenues l’apprennent. L’absence d’annonce officielle par la direction peut avoir un effet dévastateur sur les prisonniers. « Ils ont le sentiment que la vie humaine ne vaut rien ici », rapporte une intervenante. Elle raconte aussi l’angoisse, qui peut vite envahir la détention en l’absence d’information. Et la suspicion, devant la mort de personnes que l’on pensait bien portantes. Des sentiments qui touchent aussi les proches de ces disparus, qui n’obtiennent que trop rarement de réponses à leurs questions et doivent se débattre seuls, face à un impossible deuil.
L’enfermement est, par essence, mortifère. C’est la perte d’une autonomie, d’un statut social et des relations amicales et familiales, de l’estime de soi. C’est aussi « l’odorat qui s’abîme. La vue qui décline, faute d’horizon. La peau qui se carapace et ne ressent plus les plaisirs. La distorsion du temps. L’effacement du réel. Le sommeil troublé. L’anxiété provoquée par l’omniprésence du regard. L’effondrement dépressif pour certains, ou la survenance de pathologies mentales »(4). Contre tout cela, l’administration à elle seule ne peut pas tout, puisque c’est l’ensemble du système qui est en cause. Ce qu’elle se doit de faire en revanche, c’est d’accompagner ces hommes et ces femmes avec autant d’humanité que possible. Ils sont nombreux – personnels pénitentiaires, directeurs, soignants mais aussi intervenants – à tenter, au quotidien, d’en insuffler. Mais lorsque l’administration se contente d’empêcher le passage à l’acte suicidaire, au lieu de considérer la souffrance ; qu’elle est prête à faire peser sur les plus faibles « les fragilités d’autres encore plus faibles qu’eux » ; qu’elle ne répond pas aux appels à l’aide des personnes dont elle a la garde ; lorsqu’elle laisse personnels, intervenants et détenus seuls face à la mort d’une personne qu’elles ont côtoyée ; qu’elle laisse sans réponse et abandonnés à leur sort les proches endeuillés, n’est-ce pas, au fond, que l’institution a oublié toute humanité ?
Par Laure Anelli
Le suicide, première cause de décès en prison
On se suicide six fois plus en prison qu’à l’extérieur ; en 2017, près de deux décès sur trois survenus en détention étaient des suicides. Selon l’OMS, cette « sur-suicidité » s’explique par une combinaison de facteurs, qui empruntent tant aux caractéristiques des personnes, à leur situation vis-à-vis de la justice qu’aux conditions auxquelles elles sont soumises dans le système carcéral.
Premier facteur explicatif : l’existence de vulnérabilités individuelles, comme des antécédents de tentative de suicide, de troubles bipolaires ou encore de dépression, particulièrement répandus dans la population carcérale. Ces facteurs individuels n’expliquent cependant pas tout : en effet, ce sont paradoxalement les détenus les plus insérés socialement, familialement et économiquement qui sont les plus exposés au suicide en milieu carcéral. Autrement dit, ce sont « ceux qui ont le plus à perdre »* qui se suicident le plus en prison.
Le deuxième type de facteurs est lié aux conséquences de la vie en détention. Celle-ci entraîne notamment, pour les personnes incarcérées, une altération de l’image de soi, une perte d’autonomie et de liberté décisionnelle, un stress quotidien ou encore une perte de soutien familial et social, créant un climat propice au passage à l’acte.
Certains lieux de la détention sont en outre particulièrement suicidogènes : c’est le cas du quartier disciplinaire (QD), où le risque suicidaire est quinze fois supérieur à celui en cellule ordinaire. Le quartier arrivant (QA) est également un lieu sensible (risque suicidaire deux fois plus élevé qu’en détention normale), en raison du choc carcéral auquel les nouveaux arrivants sont confrontés et de leur incertitude face à leur sort judiciaire, la plupart étant dans l’attente de leur jugement. Le taux de suicide varie aussi en fonction des faits reprochés. – Anne-Charlotte Begeot
(1) A. Chauvenet, M. Monceau, F. Orlic, C. Rostaing, La Violence carcérale en question, Recherche subventionnée par le GIP « Mission de recherche droit et justice », janvier 2005.
(2) CGLPL, Rapport d’activité 2011.
(3) Direction de l’administration pénitentiaire, Décès par suicide des personnes sous écrou – Bilan 2017.
(4) M.Crétenot, Morts sous probation, les oubliés, mémoire soutenu le 29 septembre 2018, Université de Reims Champagne- Ardenne.
(5) Nicolas Bourgoin, Le Suicide en prison, L’Harmattan, 1994