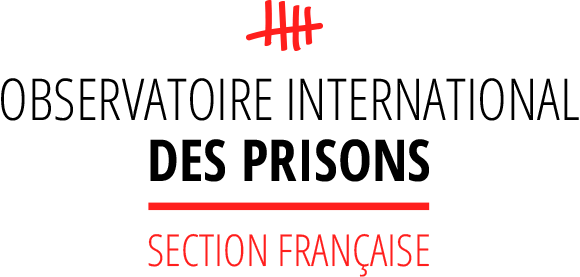Les témoignages de proches rendant visite à des personnes détenues au parloir de la prison de Fresnes se suivent et se ressemblent : injonctions vestimentaires contradictoires, comportements déplacés, fouilles intrusives…
Le tout, ciblant particulièrement les femmes.
À la prison de Fresnes, le parcours jusqu’au parloir est semé d’embûches. C’est après avoir attendu dans la rue pendant parfois plus d’une heure, avec seulement deux bancs pour s’asseoir et aucun abri pour la pluie, que les proches venant rendre visite à des personnes détenues peuvent enfin rentrer. À peine le temps de poser leurs affaires dans un casier, de s’asseoir un peu ou d’aller aux toilettes, qu’il faut déjà repartir. Ensuite vient le contrôle du linge destiné aux personnes détenues, qui réserve souvent des surprises : en fonction des surveillant·es, un même vêtement peut être accepté une semaine, puis refusé la semaine suivante.
La dernière étape, décisive, est celle des portiques de sécurité. Hommes, femmes et enfants doivent souvent remonter leur pantalon jusqu’à l’entrejambe pour montrer qu’ils ne cachent rien. « J’ai vu la scène se répéter, encore la semaine dernière, avec une gamine de même pas douze ans », explique une visiteuse, Madame S. Les femmes, en particulier, témoignent des multiples contraintes vestimentaires auxquelles elles doivent se plier pour pouvoir franchir le portique. Les baleines des soutiens-gorges sont proscrites car elles bipent, aussi les visiteuses doivent-elles adapter leur tenue en prévision du parloir, ou bien trouver un moyen de retirer leur soutien-gorge sur place. Selon des témoignages récents, elles se voient désormais proposer de couper les baleines avec une paire de ciseaux.
Les femmes sont également priées de porter des vêtements moulants, pour que le personnel de surveillance puisse être sûr qu’elles ne cachent rien en dessous. Seulement, d’après un récent témoignage, des agent·es refuseraient l’accès au parloir aux femmes dont on verrait les tétons. Ces exigences contradictoires plongent les visiteuses dans une situation inextricable : elles devraient venir sans soutien-gorge, porter des vêtements moulants et faire en sorte que leurs tétons ne soient pas visibles… Pour être sûres de rentrer, certaines expliquent ainsi prévoir des « tenues spéciales parloirs ».
Après le passage du portique, les proches font fréquemment l’objet de palpations, même en l’absence de sonnerie. Ces fouilles sont réalisées par des agent·es du même sexe, mais devant le reste du public, et donneraient parfois lieu à des palpations des parties intimes jugées « particulièrement insistantes ». Une femme explique ainsi s’être vue refuser un parloir car une surveillante l’a soupçonnée de cacher quelque chose dans sa serviette hygiénique. Certaines visiteuses témoignent de regards déplacés, notamment lorsqu’elles enlèvent leur soutien-gorge, ou quand des agents leur demandent de s’auto-palper la poitrine devant eux. « Je n’aime pas ça, je n’ai pas envie que des hommes surtout me voient me toucher, je préférerais être fouillée par une femme », témoigne Madame B.
Les femmes voilées, enfin, feraient l’objet d’une suspicion particulière et seraient obligées de retirer leur voile devant tout le monde, parfois alors même que les portiques n’ont pas sonné. « Les femmes sont très fouillées, on nous pose des questions sur tout ce qu’on porte, on se sent sur-contrôlées, jugées », résume Madame L. Un sentiment de suspicion généralisée à l’égard du corps et des habits des femmes, aux relents sexistes et discriminatoires, qui rappelle le contrôle vestimentaire particulièrement strict réservé aux femmes incarcérées. Le parallèle revient d’ailleurs souvent dans la bouche des visiteuses : « On a l’impression d’être condamnée, de subir une peine », souffle Madame O.
Au bout du compte, bon nombre de proches se voient interdire l’accès au parloir sans comprendre pourquoi, alors que certain·es ont fait des centaines de kilomètres pour venir. D’autres expliquent développer beaucoup d’angoisse autour des parloirs, et finissent même parfois par y renoncer. Un écueil de plus pour ce droit fondamental que de nombreuses personnes détenues peinent déjà à exercer.
Contactée à ce sujet, la direction du centre pénitentiaire n’a pas souhaité répondre.
Par Adèle S.
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°126 – Surpopulation carcérale : les personnes détenues prennent la parole