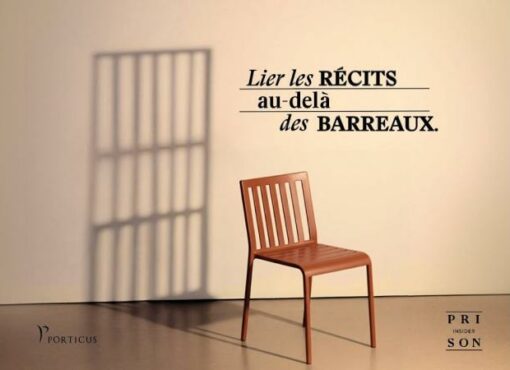Le ministère de la Justice se pourvoit en cassation contre une décision du tribunal administratif imposant à la maison d’arrêt de Fresnes de détruire les murets au sein des parloirs. Ces dispositifs de séparation sont pourtant interdits depuis 1983 et une note de la direction de l’Administration pénitentiaire avait rappelé en mai dernier d’assurer sans délai leur destruction dans les prisons en étant encore dotées.
Ubuesque place Vendôme… Saisi par l’OIP, le juge des référés de Melun avait enjoint le ministère le 19 janvier 2015 de « mettre fin à l’existence des murets séparant les parloirs » de Fresnes dans un délai de 5 mois… Et ce en application d’une note de la direction de l’Administration pénitentiaire du 21 mai 2014, rappelant une circulaire de mars 1983 ! Le 5 février 2015, le ministère a formé un pourvoi en cassation contre cette décision du tribunal administratif (TA) de Melun.
Le ministère invoque qu’il a déjà retiré l’essentiel des installations de séparation, à savoir le dispositif « hygiaphone » (matérialisé à Fresnes par un « grillage fin ») supprimé en 1983 comme dans toutes les prisons. « Seuls les murets qui en constituaient le socle sont restés en place » à Fresnes. Des murets d’une hauteur de 80 cm surplombés d’une tablette de 25 cm de large séparant le détenu de son visiteur.

Le ministère argue aussi que la présence du muret « diminue la possibilité de contact physique entre la personne détenue et son visiteur », mais ne le « rend toutefois pas impossible » ! Faut-il lui rappeler que la décision il y a 30 ans de supprimer ces dispositifs de séparation visait à rendre toujours possibles de tels contacts ? La garde des Sceaux précise encore « qu’aucune poursuite disciplinaire n’est engagée en cas de franchissement desdits murets par les personnes détenues ou par les visiteurs ». Et c’est heureux. Mais en pratique, ce franchissement est tout de même interdit par des surveillants, menaçant d’interrompre le parloir, voire de supprimer le permis de visite. Le pourvoi du ministère ajoute que le directeur de Fresnes « doit établir une note de service à l’attention des personnels » pour leur rappeler l’autorisation de franchissement des murets, ce qui était imposé par la note de la DAP du 21 mai 2014 et… qu’il n’a donc toujours pas fait. En tout état de cause, cette directive n’était prévue qu’à titre provisoire par la note, dans l’attente de travaux de suppression. A Fresnes, le franchissement du muret par le détenu ou son/ses visiteur(s) aboutit à ce que deux ou trois personnes se retrouvent debout dans la surface d’environ 0,6 m2 disponible de part et d’autre.
« La cabine est déjà très petite, alors le fait qu’il y ait un gros muret au milieu, ça la rend encore plus petite. En sachant qu’à Fresnes, il est possible de rentrer jusqu’à 3 visiteurs en même temps, donc 4 personnes en comptant le détenu, pour moi c’est quasiment impossible. Dans le parloir côté détenu, l’espace est plus petit que côté famille, de ce fait, mon conjoint passe souvent de l’autre côté du muret pour être plus proche de moi et de sa fille. Il est toujours repris par les surveillants, au mieux ils demandent de repasser de l’autre côté, au pire ils ouvrent la cabine en menaçant de retirer le permis de visite »
Courrier d’une compagne de détenu à l’OIP, novembre 2014.
Autre argument de la Chancellerie : les contraintes budgétaires. Le ministère évalue « le coût de destruction des murets » à un minimum de 250 000 euros, sans toutefois produire de devis. L’argument ne tiendrait pas devant la CEDH, la Cour imposant aux Etats membres d’organiser leur « système pénitentiaire de telle sorte de la dignité des détenus soit respectée », et ce quels que soient les obstacles matériels ou financiers.
Pour contester le caractère d’urgence de la décision du TA, le ministère ajoute que « le principe de l’absence de séparation dans les parloirs est établi depuis 1983. Il y a donc plus de 30 ans » que le dispositif de Fresnes aurait pu être « contesté » en justice. Alors que la maison d’arrêt n’applique pas la loi depuis 30 ans, il est vrai que son actuel directeur n’a pas dû juger indispensable de traduire en actes son « indéfectible attachement » à « la dignité des personnes fréquentant les parloirs », qu’il invoque dans la procédure.