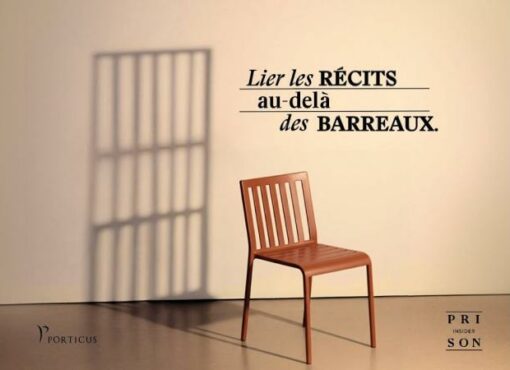Un jour d’automne 2012, Martine est réveillée à 6 heures du matin par la sonnerie de son téléphone. C’est la gendarmerie : sa fille, Élise, est en garde à vue. Inculpée d’un meurtre, cette dernière passera dix-huit mois en détention provisoire avant d’être acquittée. Mais après plus de quatre années de liberté, Élise a été condamnée en appel à treize ans de prison en octobre 2018. Martine raconte comment sa vie a basculé une nouvelle fois, avec la seconde incarcération de sa fille.
Le verdict est tombé le vendredi soir. Le lendemain, je suis allée dans l’appartement d’Élise avec deux de ses amis. Je savais qu’elle nous avait laissé un petit mot au cas où elle serait incarcérée. Comme ce n’était pas la première fois, elle savait comment ça allait se passer, et elle avait tout anticipé. On avait préparé ensemble une très grosse valise avec tous les vêtements d’été et d’hiver autorisés en prison que l’on pourrait lui apporter au parloir. Elle avait aussi laissé ses codes de téléphone, d’ordinateur portable, ses comptes en ligne, les coordonnées de personnes à prévenir, la liste des courriers à envoyer, etc. Je ne pensais pas qu’il y aurait tant de choses à faire. Ses amis se sont chargés de vendre son téléphone qui aurait été obsolète à sa sortie de prison, de résilier son abonnement à Internet, de supprimer les comptes qu’elle avait pour écouter de la musique, regarder des films… toutes ces choses que je ne maîtrisais pas forcément.
La journée suivante, je ne pouvais plus rien faire. Pendant des jours, j’ai eu beaucoup de mal à parler, malgré les appels de soutien que j’ai reçus. Le lundi, j’étais censée retourner au travail mais un médecin m’a arrêtée pour quatre semaines. Cela m’a permis d’effectuer toutes les démarches qu’Élise ne pouvait pas faire de l’intérieur. Au début, j’agissais comme un robot, j’étais vraiment ailleurs. Mais j’essayais de tenir le coup, parce qu’il le fallait. Il faut se battre pour l’aider, et ce n’est pas en étant anéantie que j’y arriverai. La veille du verdict, on sentait que tout allait vers une condamnation et j’avais l’impression que j’allais m’écrouler. Je pleurais beaucoup, mais Élise me disait : “ Il faut que tu tiennes, tu es forte, et je vais avoir besoin de toi ! ”
J’ai dû passer de nombreux coups de téléphone. À sa banquière pour gérer ses comptes à distance. À la CAF pour une histoire d’aides qu’elle touchait en complément du salaire qu’elle gagnait avant d’entrer en prison. Ça n’a pas été une mince affaire. La personne que j’ai eue au bout du fil me disait : “Vous n’êtes pas Madame X., je ne peux pas vous répondre.” J’avais beau lui expliquer la situation, elle ne voulait rien entendre… J’ai également appelé sa faculté pour les informer qu’Élise n’irait plus en cours et pour récupérer le diplôme qu’elle avait obtenu l’année passée. Je me suis occupée de son changement de situation à Pôle emploi, du paiement de sa taxe d’habitation, de son changement d’adresse pour son courrier, de déposer une annonce pour la vente de sa voiture, de payer l’électricité de son appartement… Avant de reprendre le travail, j’avais à peu près tout bouclé, ne restait plus que son déménagement.
Jour de parloir, « journée marathon »
Dès qu’elle a été incarcérée, j’ai rassemblé les documents et rempli ma demande de permis de visite que je suis allée déposer moi-même au tribunal. La confirmation est arrivée rapidement, mais ce qui a pris le plus de temps, c’est l’enregistrement du permis de visite par la prison. J’appelais le service des parloirs tous les jours, on me demandait de retenter ma chance le lendemain. Au bout de dix jours, à raison de dix à vingt appels par jour, j’ai fini par obtenir un rendez-vous. Au total, il s’est écoulé trois semaines entre le prononcé du verdict et notre premier parloir.
« Au parloir, tout est compté : au bout de quarante minutes, c’est fini, je ne la verrai plus avant la semaine prochaine. J’ai toujours l’impression de l’abandonner. »
Le fait qu’elle soit incarcérée pour la deuxième fois et que je connaisse déjà le fonctionnement des parloirs m’a beaucoup aidée à appréhender les premières visites. Mais il y a toujours cette angoisse de se demander si on n’a rien oublié dans ses poches. Pour une pièce de cinq centimes, on peut vous refuser l’entrée. Ils sont beaucoup plus sévères qu’avant : à l’époque, les surveillants laissaient les familles retirer de leurs poches ce qu’elles y avaient oublié pour le jeter ou bien le récupérer à la sortie. C’est pareil pour les sacs de linge : avant, s’il y avait un vêtement ou un objet non conforme, on le retrouvait sur un banc, à la sortie, et le sac était remis à son destinataire. Mais les règles ont été durcies et maintenant c’est le sac entier qui est refusé. La fin du parloir est toujours un moment très dur à vivre. Déjà, on ne sait pas vraiment quand on va sortir parce qu’on n’a pas le droit de porter de montre. Et la sortie est très éprouvante, parce que les quarante minutes passent très vite, on aurait voulu dire plus de choses, pouvoir avoir plus de temps… Mais tout est compté : au bout de quarante minutes, c’est fini, je ne la verrai plus avant la semaine prochaine. J’ai toujours l’impression de l’abandonner. Ces journées sont épuisantes, moralement surtout, c’est comme une journée marathon.
Un combat quotidien
J’étais très angoissée à l’idée de reprendre le travail, mais ça s’est très bien passé. Les gens ne posaient pas de questions, et j’ai eu beaucoup de mots de soutien de la part de mes collègues. L’une d’elles m’a donné trois jours sur ses congés : c’est une possibilité qui est normalement offerte quand on a un enfant qui tombe gravement malade par exemple, et mon employeur a accepté de faire une exception. Parce que si Élise a encore le droit à trois parloirs par semaine (comme elle a formé un pourvoi en cassation, elle est toujours considérée comme prévenue) je ne peux, sauf exception, m’y rendre que les samedis, à moins de poser des jours de congé. Ces parloirs bloquent mes week-ends, je ne peux rien projeter sur deux jours, mais tant qu’Élise n’aura pas d’autres visites (ses amis sont toujours dans l’attente de l’obtention de leur permis), je continuerai à m’y rendre tous les samedis.
Mes semaines sont donc aujourd’hui rythmées par le travail et mes week-ends par les visites à Élise. Généralement, je pars à 13 h de chez moi pour le parloir de 15 h 20. Il me faut une bonne heure de route pour effectuer les cent kilomètres qui me séparent de la prison et je dois être présente trente minute à l’avance. Le temps de ressortir et de faire la route en sens inverse, je suis de retour chez moi vers 17 h 30. Quand elle sera transférée en centre de détention, ce sera plus compliqué parce que j’aurais plus de quatre cents kilomètres aller-retour à effectuer.
Financièrement, ce n’est pas évident non plus. En plus des frais d’essence et de péage pour me rendre au parloir, des mandats que j’envoie régulièrement à Élise, des nouveaux vêtements que j’ai dû lui acheter pour qu’ils soient adaptés aux règles de la prison, je dois payer une partie des indemnités à verser aux parties civiles parce qu’Élise était mineure au moment des faits et que j’étais sa responsable légale. J’ai déjà fait un prêt pour payer les frais d’avocats et, pour m’éviter d’en faire un deuxième, ma mère a proposé de m’aider. Le plus dur à vivre aujourd’hui, ce sont les moments que je voudrais passer avec elle, alors que c’est impossible. Il y a son anniversaire qui vient de passer, et surtout la période de Noël qui approche. Cette année j’ai décidé de travailler pendant les fêtes, pour ne pas y penser, et aussi parce que c’est très dur de faire des choses qui me feraient plaisir quand je sais qu’elle est enfermée entre quatre murs. Alors j’ai décidé de ne rien faire le 25 décembre, je vais juste prendre deux jours pour préparer son colis de Noël, cuisiner les plats qu’elle aime.
La veille du verdict, Élise m’a dit : “Tu sais maman, je n’ai pas une maladie grave, je ne vais pas mourir, je vais survivre.” C’est ce que j’essaye de me répéter pour tenir, me rappeler qu’il y a bien pire à vivre. Et je me bats, comme elle, pour ne pas m’effondrer. »
Recueilli par Amid Khallouf