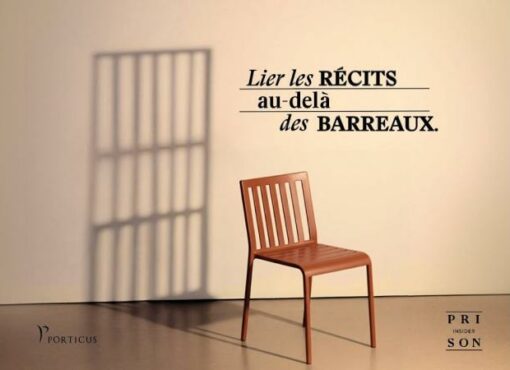Jeune surveillante de prison, Audrey tombe amoureuse d’une détenue. Contrainte de démissionner, elle sera ensuite elle-même incarcérée pour complicité dans l’évasion de sa compagne. Aujourd’hui libre, elle ne voit son amie qu’au parloir, et attend sa sortie. À vingt-neuf ans, elle raconte son expérience de ces trois facettes de l’univers carcéral.
J’ai grandi dans le respect de la loi. Mon père adoptif était gendarme, je voulais l’être également mais je n’ai pas pu, pour des raisons de santé. Je cherchais un métier d’ordre et quand j’ai vu la publicité pour être surveillant pénitentiaire, j’ai vu ça comme un moyen d’être utile à des gens en difficulté. Je suis entrée à l’École nationale de l’administration pénitentiaire (ENAP) le 21 avril 2009, à 20 ans.
Après une courte période de formation, j’ai fait un stage de mise en situation au centre de détention d’Argentan. La prison, c’est impressionnant. Quand on passe les murs, on coupe totalement avec le monde extérieur. On arrive avec une vision de la prison influencée par les séries télé américaines, et on se rend rapidement compte que croire que les détenus ont des têtes de méchant, ça ne marche pas. Un des premiers jours, j’ai serré la main d’une personne, et le surveillant m’a dit : « Tu sais que tu viens de serrer la main d’un détenu ? » Une autre fois, j’ai évité de serrer la main d’un intervenant. Du coup, je n’ai plus serré la main à personne.
Mon second stage s’est déroulé à la maison d’arrêt de Versailles, un établissement plutôt tranquille. Pendant la première semaine, on est en binôme avec un surveillant, puis ensuite on a les clés, on est tout seul pour faire le boulot. Je me souviens de la peur de mal faire. La difficulté et la beauté de ce travail, c’est qu’on est face à des êtres humains. À la fin de l’école, en fonction des notes, on peut choisir son affectation : le premier a beaucoup de choix et le dernier prend ce qui reste. La dernière s’est retrouvée aux Baumettes. J’ai choisi Rouen, ni trop près ni trop loin de ma famille, et j’ai commencé en 2010. La formation n’avait pas duré un an.
« En maison d’arrêt, la réinsertion, on n’a pas le temps »
Je m’occupais d’un étage de 80 détenus. Des petits délinquants à peu près de mon âge, au caractère bien affirmé. J’étais un peu timide, mais je n’avais plus le choix. Au début, les collègues ont pensé que je ne tiendrais pas. Je voulais tout faire, je courrais partout, je transpirais, j’étais épuisée. Puis j’ai compris qu’il fallait faire des priorités.
Dans cette maison d’arrêt, il y a plusieurs quartiers. Très calme, le quartier des détenus pour mœurs m’a beaucoup moins plu que le reste de la détention. Je m’y sentais moins à l’aise, confrontée à des personnes qui avaient commis des actes dont je n’avais pas jusqu’ici imaginé l’existence. J’ai appris à me comporter avec eux comme avec n’importe qui, sans les juger. Plusieurs fois, je me suis trouvée en désaccord avec certains collègues. Pour eux, les détenus étaient tous des délinquants donc ils ne cherchaient pas à comprendre, ils étaient durs avec tout le monde. Certains trouvaient que je faisais trop « dans le social » et ça ne leur plaisait pas. Impossible pour moi d’être dure par principe. Je n’avais pas à leur faire payer une deuxième fois ce qu’ils avaient commis. Je m’adaptais au comportement des détenus, s’ils passaient les limites je recadrais. Trop de répressif ne donne rien de bon. Lorsque je prenais le service après un collègue très dur, je trouvais des détenus sous pression, et il fallait du temps pour rétablir à peu près le calme. Si on rajoute des tensions, ça risque d’exploser. Il faut adapter sa manière de parler à chacun, dire non tout de suite ou prendre le temps de dialoguer. À l’école, on nous dit que ce métier c’est une mission de surveillance et de réinsertion, mais en maison d’arrêt on n’a pas de temps pour la réinsertion. On n’arrive quasiment jamais à passer cinq minutes avec un détenu. On risque en permanence de retarder les mouvements qui suivent, la vague de détenus à envoyer en promenade ou en activité, les autres qui en reviennent et qu’il faut renfermer, tout cela avec des chefs qui mettent la pression.
En détention hommes, en tant que femme, on n’a pas le droit de fouiller les détenus, il ne faut pas de contact physique avec eux. Certains collègues me reprochaient d’être payée comme eux, mais de ne pas faire tout ce qu’ils avaient à faire. J’ai demandé à passer au quartier des femmes, pour pouvoir faire mon boulot de A à Z sans avoir à appeler un homme pour m’aider. Puis j’ai obtenu mon affectation au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. J’avais toujours cru qu’il y avait des crimes spécifiquement masculins, comme les affaires de mœurs, mais je me suis vite rendu compte qu’il y en avait aussi chez les femmes. Ainsi que des stups, des vols, des faits de violences, même si les femmes ont des peines un peu moins lourdes que les hommes.
« Je ne respectais plus les règles »
Un jour, j’amenais des détenues en promenade ; en tournant la tête j’ai flashé sur l’une d’elles. Je savais que j’aimais les filles, mais j’avais toujours respecté les règles et la barrière professionnelle. Pas question de séduction.
À Rennes, on changeait de poste tous les trois mois. J’ai changé d’étage, et la première détenue que j’ai vue c’était elle. Je l’ai régulièrement croisée pendant ces trois mois à l’étage, et une relation s’est installée. Pas amicale, mais pas amoureuse non plus. J’ai vite réalisé que je dépassais les bornes. Ça a été psychologiquement compliqué à admettre. On discutait, de surveillante à détenue, toujours avec de la distance - elle était très respectueuse de cela. Petit à petit, on a commencé à s’écrire des petits mots sur des bouts de papier. Elle maintenait la distance, ne voulant pas risquer de me créer de problème. C’est moi qui ai insisté et, à la fin de mes trois mois à l’étage, on s’est embrassées. Puis tout s’est enchaîné très vite. J’avais bien conscience que je ne respectais plus les règles, mais je continuais à bien faire mon travail. Elle n’a pas eu de privilèges.
Mes vacances approchant, j’angoissais à l’idée que je n’allais pas pouvoir la voir, ni avoir de ses nouvelles, alors j’ai pris la décision de faire entrer un téléphone portable. Avant un service de nuit, je l’ai mis dans ma poche en me disant que si on me prenait, je dirais que j’avais oublié que je l’avais. Il est passé, j’ai pu le mettre dans mon casier. Lila m’a bien engueulée. Elle a dit qu’elle n’en voulait pas, que c’était dangereux pour elle comme pour moi. Mais je suis têtue. Je l’ai déposé dans sa cellule et je suis partie en vacances. Une semaine plus tard, comme elle ne m’appelait pas, j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose. Lors d’une fouille, le téléphone avait été trouvé et à mon retour, j’ai appris qu’elle était au quartier disciplinaire. J’ai prétexté un problème personnel pour m’isoler de mes collègues et je suis allée la voir. J’avais pris la décision de me dénoncer, elle était d’accord.
« Sortie de la prison encadrée par la police »
Avec ce qui se passait, je savais que je ne pourrai pas rester surveillante. Le téléphone portable découvert dans la cellule de Lila étant à mon nom, j’ai demandé un rendez-vous avec ma direction pour le lendemain et, sachant qu’il y avait 99 % de chances que je finisse en garde à vue, j’ai préparé un paquetage. J’ai eu du mal à m’endormir.
Le lendemain, étant chargée des extractions médicales, j’ai tenu à accompagner des détenues à l’hôpital, pour ne pas perturber le planning des collègues. Au retour, j’ai demandé à parler à ma cheffe, que j’appréciais beaucoup, et à la directrice. Afin qu’il n’y ait pas de malentendu avec Lila, je leur ai dit que je savais à qui était le portable, mais que je ne le dirai qu’en face de la détenue concernée. C’était également une façon de la voir : je savais qu’on ne se reverrait pas de sitôt. Mais ma directrice est allée directement au QD [quartier disciplinaire], et a dit à Lila que j’avais tout raconté.
Ma cheffe a appelé la police. Ils ont été gentils, ils m’ont laissée me changer et me mettre en civil pour éviter que j’arrive en garde à vue en uniforme. Ils ne m’ont pas menottée, ils voyaient bien que j’étais consentante. Je suis sortie de la prison encadrée par la police, obnubilée par le fait que je ne verrai plus ma compagne. Après la garde à vue, la procureure m’a laissée sortir en attendant le jugement, qui devait se tenir un mois après. Je devais également passer en commission disciplinaire : selon mon syndicat, je pourrais obtenir une mutation si je mettais fin à la relation. Je ne voulais pas, et même si je l’avais fait, je ne voyais pas comment rester crédible auprès des surveillantes et de la population pénale. J’ai remis ma démission, et j’ai échappé à la commission disciplinaire. Mais tant que je n’étais pas jugée, je ne pouvais pas voir ma compagne, ni lui écrire. C’était en mai 2012.
J’ai été jugée pour le téléphone, mais je n’ai pas été poursuivie pour ma relation avec une détenue. Ils m’ont condamnée à un an avec sursis et l’interdiction d’exercer comme surveillante pendant cinq ans. J’ai eu la chance qu’ils prennent en compte mes explications, celles de ma compagne et celles de la directrice adjointe, qui ne m’a pas enfoncée. Ils ont considéré que c’était une histoire sentimentale, et qu’il n’y avait pas d’intention de nuire : je n’ai pas été accusée de trafic pour le téléphone.
« Je ne l’ai revue qu’un an après »
Sans transition, je suis passée au statut de « famille de détenue ». Après le QD, ma compagne a été transférée à Bapaume. Impossible pour eux de la laisser dans l’établissement où nous avions eu cette relation. Ils craignaient sûrement que je lui aie donné des informations. Pourtant je ne lui avais même pas parlé des collègues avec qui je m’entendais bien, avec qui je sortais.
J’ai fait la demande de permis de visite, le directeur a refusé. J’ai essayé de l’avoir au téléphone mais il ne voulait pas me parler. La secrétaire m’a dit que tant qu’il serait directeur, il n’accepterait jamais que je voie ma compagne : elle pouvait me téléphoner, on s’écrivait, mais on était privées de parloir. J’avais vu Lila pour la dernière fois au QD de Rennes le 17 mai 2012, je ne l’ai revue qu’un an après. En avril 2013, on s’est pacsées, puis le directeur est parti. Ma compagne a rencontré la nouvelle directrice qui a dit qu’elle était « favorable à laisser une chance aux liens familiaux », qu’elle nous accordait le permis de visite, mais que s’il arrivait quelque chose, ce serait définitivement non.
Ce jour-là, j’ai paniqué : elle ne m’avait jamais vue en civil, c’était la première fois que je remettais un pied en prison, je me présentais pour le parloir devant des surveillantes qui connaissaient forcément notre histoire, et je me retrouvais au milieu de familles de détenues. Un autre monde.
Il y a eu beaucoup d’émotion et de disputes à ce premier parloir. Les surveillants étaient au courant de ma situation, mais à aucun moment ils ne me l’ont fait ressentir. Ils n’ont jamais montré d’animosité. Ils m’ont expliqué les choses comme ils le faisaient à n’importe quelle famille. Au parloir, la porte s’est refermée sur moi sans que j’aie les clés. Je n’étais plus surveillante, j’étais surveillée.
« C’était comme si je la réincarcérais »
Pour sa première permission de sortir, Lila a eu l’autorisation de venir chez moi à Rennes. Compte tenu de la distance, ils lui ont exceptionnellement accordé cinq jours. En prison, elle a beaucoup de migraines, elle perd du poids, et là en permission elle dormait bien, elle riait. Elle a pu rencontrer mon père biologique, mes amis, tout s’est bien passé. Mais à la fin des cinq jours, quand il a fallu reprendre la route pour la prison, je me suis sentie très mal. Quand j’étais surveillante, c’était moi qui fermais sa porte à clé ; là, je la ramenais en prison, comme si je la réincarcérais. J’en étais incapable. Sur la route, on a pris la décision qu’elle ne rentrerait pas. C’est l’erreur que je vais le plus regretter dans ma vie.
J’ai appelé l’AP [administration pénitentiaire] et leur ai dit qu’elle n’était pas rentrée chez moi, que je ne savais pas où elle était. Elle était donc en évasion. Au bout de douze jours, on a décidé qu’elle se rende. Un ami nous a hébergées pour une dernière nuit ensemble. Le matin, ils nous ont arrêtés chez lui. Après une nuit de garde à vue, nous avons tous les trois été déférés devant le procureur. Ma femme pour évasion, mon ami et moi pour complicité d’évasion. La procureure a traité ma compagne de manipulatrice. Puis elle m’a reproché d’être une ancienne surveillante. Je ne me faisais pas d’illusion, je savais que mon sursis allait tomber, que j’avais dépassé les limites. En attente du jugement prévu le lendemain matin, nous avons été placés en détention, mon ami à Arras, ma compagne à Bapaume, et moi à Lille. J’étais morte d’inquiétude pour mon ami et pour ma femme. Je mesurais la galère dans laquelle je les avais embarqués.
Au greffe, le gendarme qui m’escortait a dit aux surveillants : « Au moins, elle ne sera pas dépaysée, c’est une ancienne de chez vous. » J’ai eu une bouffée d’angoisse, comme au parloir : ce n’était plus à moi d’ouvrir les portes. Plus j’avançais vers le quartier femmes, plus j’avais l’impression que le couloir rétrécissait. Une sensation d’étouffement. À droite et à gauche, les barreaux et, derrière les barreaux, les détenues qui me regardaient. J’étais une détenue, j’allais partager leur quotidien. Les surveillantes ont été plutôt cool avec moi, elles m’ont passé une cigarette et, quand la porte de la cellule s’est refermée, bizarrement, je ne me suis pas sentie dépaysée.
Le lendemain au tribunal d’Arras, ma compagne a été condamnée à un an supplémentaire, mon ami à six mois. J’ai pris trois mois ferme avec une révocation de sursis de huit mois, soit onze mois au total. Onze mois, ce n’était pas assez pour espérer aller en centre de détention retrouver ma compagne. Je suis retournée derrière les barreaux, sachant cette fois que j’allais y rester.
« Les filles ont bien réagi »
Après la semaine au quartier arrivantes, j’ai été placée à part, mesure de protection. Au début, je ne voulais pas sortir de cellule, j’avais peur. Puis j’ai commencé à aller en promenade, à discuter avec quelques filles, ça se passait bien. Personne ne semblait au courant de ma situation, et je faisais très attention à ce que je disais. Quand j’ai commencé à me sentir plus à l’aise avec l’auxi[1], je lui ai dit. Elle était déjà au courant, ainsi qu’une autre auxi : les surveillantes leur avaient parlé. Les chefs insistant pour que je me sociabilise un peu, je me suis inscrite à une formation « propreté et hygiène ». Je m’intégrais.
Un jour, alors que deux détenues se battaient, je me suis interposée. Comme la formatrice tiquait en voyant ma façon d’intervenir, une des filles lui a dit : « C’est normal, c’est une ancienne surveillante. » Puis peu de temps après, une fille m’a reconnue. Je l’avais surveillée à Rouen. En fait, elle a pensé qu’on avait été détenues ensemble. Plusieurs fois, il y a eu des transferts de détenues de Bapaume, qui se souvenaient de moi. Elles étaient au courant de mon histoire, et elles avaient vu ma femme revenir après l’évasion…
Alors finalement, préférant que l’information vienne de moi plutôt que des surveillantes ou des chefs, j’ai décidé de parler, au moins aux filles de la formation. Un matin, la formatrice a annoncé : « Audrey a quelque chose à vous dire. Et ce qui se dira doit rester entre nous. » Ça m’a mise à l’aise, et je leur ai expliqué mon histoire. Les filles ont bien réagi : « On s’attendait à ce que tu nous annonces quelque chose d’horrible ! On s’en fiche, et s’il y en a une qui t’emmerde, on sera là. » De temps en temps, elles me demandaient des conseils sur leurs droits, ou comment écrire au juge… J’avais appréhendé les détenues, mais ce ne sont pas elles qui m’ont posé problème.
« Avec la pénitentiaire, les relations se sont durcies »
À partir du moment où j’ai cessé de rester enfermée, le changement d’attitude des chefs a été radical. J’ai eu plusieurs fouilles de cellule. Puis il y a eu un incident. La communication avec Lila était restreinte, du fait de notre incarcération, ce qui créait par moments des tensions. J’ai reçu un courrier d’elle qui m’a fait pleurer, j’ai commencé à m’énerver toute seule dans la cellule, j’ai frappé sur la table et mon plateau est tombé, avec la vaisselle. Une surveillante est venue voir ce qui se passait. Assise par terre, en larmes, je ne voulais pas parler. J’avais besoin de me calmer. Ils sont revenus à ma porte toutes les cinq minutes, ça m’a énervé. J’ai dressé mon matelas contre la porte pour boucher l’œilleton, je ne voulais pas être regardée. J’ai poussé la table pour caler le matelas. Au moment où ils ont ouvert la porte, j’ai balancé la chaise. Ils sont repartis s’équiper.
J’ai nettoyé les bouts de verre au sol et préparé mes affaires tranquillement, sachant que ça risquait de finir au QD. Ils ont allumé l’interphone pour m’écouter, et j’ai entendu le surveillant informer les collègues : « Elle se prépare à vous affronter. » Je me suis moquée de lui, je rigolais, il a dû penser que j’avais pété un plomb. Je me suis allongée sur le sol dès qu’ils ont ouvert la porte. Ils m’ont menottée et emmenée dans la cellule voisine. J’ai expliqué que j’avais reçu une mauvaise nouvelle, qu’ils auraient dû me laisser me calmer, que je n’étais pas agressive. Le chef m’a demandé ce que je voulais, j’ai répondu : « Rien, juste être tranquille. » Comme il insistait, j’ai demandé à être transférée à Bapaume, il a dit qu’il allait voir avec la direction. Je savais que c’était impossible. Et je me suis retrouvée au QD avec la tenue anti-suicide, le pyjama bleu taille XXL, largement trop grand, qui s’est déchiré dès que je me suis assise. Privée de mes sous-vêtements, je suis restée à poil en prévention pendant trois jours car il n’y avait pas de commission de discipline le week-end. J’avais juste le drap anti-suicide pour me couvrir, et la fenêtre ne fermait pas.
Je suis passée en commission de discipline pour trouble à l’ordre de la prison et refus d’obtempérer. J’ai reconnu mes torts. La directrice m’a reproché d’avoir traumatisé la détention. Elle a ajouté que, bien que ce ne soit pas noté dans le rapport d’incident, elle avait entendu dire que j’avais lancé un verre en direction du lieutenant. La surveillante présente à la commission a confirmé qu’elle avait entendu parler du verre lancé sur le lieutenant. Ils m’ont mis dix jours.
Le QD, c’est très oppressant. Dès la fin de la sanction, je suis allée en promenade. J’avais vraiment besoin de prendre l’air. Il y avait des détenues que je ne connaissais pas. Le fait d’avoir fait du QD me donnait un statut particulier. J’ai expliqué aux filles que je n’avais aucun mérite, que je n’étais pas une « warrior », que je l’avais très mal vécu.
« En prison, non seulement on perd notre dignité, mais on nous infantilise »
Les relations se sont encore durcies avec la pénitentiaire. J’ai été convoquée car ils me soupçonnaient de donner aux filles des informations ayant trait à la sécurité, aux personnels, de les conseiller sur la manière de cacher des objets. Ils m’ont menacée de poursuites si jamais il arrivait quelque chose à une surveillante.
Pour la sécurité, il y a le sondage des barreaux et, tous les soirs, des spots sont allumés à l’extérieur au-dessus de chaque fenêtre de cellule pour éclairer le mur. La lumière se répand dans la cellule comme en plein jour. Si on masque la fenêtre, on est menacé de sanction car ils veulent pouvoir voir les barreaux à tout moment. Beaucoup de détenues prennent des médicaments pour dormir. Je m’y suis toujours refusée, même si certains jours je pleurais de ne pas trouver le sommeil. Alors j’ai fini par trouver un système. Les surveillantes passent vers onze heures pour la première ronde, puis vers quatre heures du matin. J’attendais le passage de onze heures, je masquais la fenêtre avec mon blouson, et je mettais le réveil à quatre heures pour l’enlever. C’était court, mais ça permettait quelques heures de sommeil.
J’ai terminé la formation. Puis est venu le temps des remises de peine. Outre le retrait de quelques jours à cause du QD, la juge m’a déduit un mois pour agression sur le personnel. Je n’ai pas compris : je n’avais pas agressé de surveillante, mon dossier disciplinaire n’en mentionnait pas. J’ai fait appel, mais je n’ai jamais eu de nouvelle. En prison, la justice est partiale. Très vite j’ai senti qu’ils me rejugeaient pour ce que j’avais fait. Quand j’étais surveillante, j’entendais les détenues se plaindre du fait qu’une surveillante ou un chef ont tous les droits, qu’ils peuvent vous pourrir la vie. De fait on est privé de tout. J’ai galéré pour avoir du papier toilette, pour des cantines non livrées. Pour la moindre chose il fallait écrire. Je suis sujette à des maux de tête, pour du doliprane il fallait écrire à l’infirmerie. En prison, non seulement on perd sa dignité, mais on vous infantilise. On dépend d’eux pour tout. Comment se réinsérer en sortant quand en détention on n’a rien pu faire par soi-même ?
« Il a fallu du temps pour que je relève la tête »
Je suis sortie de prison le 4 août, et je suis redevenue femme de détenue. Les grands oubliés dans l’histoire, ce sont les familles et les proches. Personne, pas même les détenus, n’imagine à quel point c’est compliqué. Être surveillante n’a pas toujours été facile, détenue non plus, mais famille de détenu, c’est la position la plus compliquée pour moi. On n’a pas le droit de se plaindre parce qu’on n’est pas à l’intérieur. On est dehors, mais on vit avec eux. Je comprends que certains ne tiennent pas le coup. Lila et moi sommes ensemble depuis près de six ans, mais pour ma famille comme pour mes amis – excepté mon père biologique qui l’a rencontrée lors de sa permission – c’est comme si j’étais encore célibataire. Ils ne l’ont jamais vue, et ne la connaîtront pas avant sa fin de peine en 2021.
Ma vie s’organise autour de notre relation. Pendant les heures où elle risque de téléphoner, pas question que je sois dans un endroit où mon portable ne capte pas. Quand c’est possible, j’attends à la maison pour qu’elle puisse m’appeler sur le fixe parce que c’est moins cher. Hors de question de louper le coup de fil de la journée. Lila me dit souvent qu’elle n’a pas envie de parler, parce qu’il y a des détenues et des surveillantes autour d’elle et que tout le monde entend. Ils devraient rendre légal le téléphone portable. Ils pourraient contrôler, mais ça donnerait quand même un peu d’intimité. Avec des tarifs moins élevés, des forfaits comme on en a dehors.
Les premiers mois, je faisais des doubles démarches, pour préparer sa sortie à elle et pour moi. J’écris pour elle à Pôle emploi, à l’agence d’intérim. Je m’occupe de ses CV. Si on donnait à tous les détenus un accès à Pôle emploi, comme ça se fait dans quelques prisons, ils pourraient postuler en ligne. Les démarches seraient facilitées, sans que ce soit un danger pour la sécurité.
Avec l’évasion, on a mis beaucoup de choses en péril. Pour Lila, la situation s’est durcie en détention. Et moi j’ai perdu mon appartement quand j’ai été incarcérée. Ma famille a vendu mes meubles. Il a fallu que je trouve un endroit où me poser à la sortie. Durant sept mois, j’ai été hébergée à droite ou à gauche, chez des amis. Heureusement, j’avais encore des indemnités de Pôle emploi. Puis en mars, le centre communal d’action sociale m’a trouvé une place en foyer, et j’ai un emploi depuis le mois de mai. Et maintenant, avec l’aide du foyer, de la CPIP [conseillère d’insertion et de probation] de ma compagne et du centre de détention de Bapaume, nous essayons de préparer la réinsertion de Lila, de mettre en place des permissions de sortir pour pouvoir envisager un aménagement de peine au foyer où je suis. Nous attendons l’avis du juge. Lila a repris le travail en détention, elle est auxi remplaçante.
Après ma sortie, j’ai ressenti beaucoup de culpabilité, j’ai réalisé tout ce que ma décision avait impliqué. Je n’étais pas bien, je voulais retourner en prison. C’est ma compagne qui m’a aidée à me ressaisir. Il a fallu du temps pour que je relève la tête : depuis que j’ai été détenue, mes nerfs sont à vif, il y a une colère en moi qui n’existait pas avant. Une colère contre le système judiciaire et pénitentiaire. Quand on est surveillante, on peut s’en rendre compte, mais on ne le vit pas. Quand on le vit, on se dit que ça devrait changer.
Recueilli par François Bès
[1] Personne détenue employée par l’administration pour les services généraux de la prison.