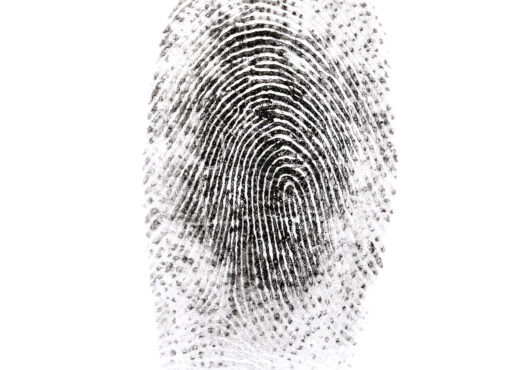La sociologue et géographe Lucie Bony a étudié les logiques de recrutement de la population détenue en maison d’arrêt, une recherche centrée sur l’Ile-de-France qui mériterait d’être étendue à d’autres régions. Son constat : les jeunes hommes des quartiers populaires de banlieue alimentent plus que les autres les prisons, à tel point que ces dernières font figure d’annexes du quartier. Entretien.
D’où viennent les détenus incarcérés dans les maisons d’arrêt franciliennes et quel est leur profil ?
Lucie Bony* : La première aire de recrutement de la population détenue est constituée de villes de banlieue, plus précisément de quartiers ciblés par la politique de la ville, ou qui en ont le profil. Ces territoires peuvent compter jusqu’à 150 détenus pour 100 000 habitants – presque le double de la moyenne régionale. Il s’agit de quartiers populaires marqués par la précarité, avec de grands ensembles. La population y est jeune, avec une part importante d’immigrés, de familles nombreuses et monoparentales et de personnes non diplômées. A l’image de celle des quartiers, la population des maisons d’arrêt franciliennes est jeune : la moitié des détenus y a moins de 30 ans. La majorité purge une peine de moins d’un an, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des faits de violence, de troubles à l’ordre public et ont des faits d’outrage à agent ou de dégradation de biens publics inscrits à Le grand entretien leur casier judiciaire. Il s’agit donc très majoritairement d’une petite délinquance urbaine.
Comment expliquer ce lien entre prison et quartiers ?
Lucie Bony : On peut formuler plusieurs hypothèses. D’abord un effet de composition : l’incarcération étant davantage prononcée à l’encontre de personnes de milieu social défavorisé, les territoires dans lesquels ces populations sont concentrées sont logiquement davantage touchés par l’incarcération. Mais on peut aussi supposer que d’autres effets jouent. La focalisation de l’appareil répressif sur ces quartiers, le fait que l’institution judiciaire ait tendance à condamner plus sévèrement les personnes déjà repérées… Des facteurs qui, combinés, concourent à ce que les circulations prisons quartiers s’auto-entretiennent. Ces logiques de recrutement ne sont sans doute pas le mais aussi produites par l’institution judiciaire, policière, à travers des mécanismes qui mériteraient d’être creusés. Aux Etats-Unis, des travaux montrent qu’il existe une forme de « discrimination territoriale » : les personnes, selon les endroits d’où elles viennent, n’ont pas les mêmes risques d’être condamnées à de la prison ferme. Il faudrait mener ce genre de recherche en France, pour déterminer si, aux différents stades de la procédure judiciaire, de l’arrestation à la condamnation, il y aurait une discrimination liée à l’adresse, indépendamment de la position sociale ou de l’origine ethnique.
Aux Etats-Unis, des travaux montrent qu’il existe une forme de « discrimination territoriale » : les personnes, selon les endroits d’où elles viennent, n’ont pas les mêmes risques d’être condamnées à de la prison ferme. Il faudrait mener ce genre de recherche en France.
D’après vos observations à la maison d’arrêt de Nanterre, les quartiers ont tendance à se reconstituer à l’intérieur des murs…
Lucie Bony : « D’où tu viens ? », « Tu as grandi où ? » sont parmi les premières questions que les détenus se posent mutuellement. La question de l’origine territoriale est déterminante, et constitue un critère d’identification et de classement très important entre eux. Ceux qui viennent du département sont chez eux, c’est « leur » prison. Venir d’un quartier chaud ou médiatique, même s’il n’est pas dans le département, permet aussi de jouir d’un certain prestige en détention, davantage que lorsque l’on vient d’un quartier dont personne n’a jamais entendu parler. Certains quartiers sont étiquetés en fonction de leur « spécialité ». « Dis-moi d’où tu viens et je te dirai qui tu es » : telle cité est connue pour le trafic de stupéfiants, telle autre pour les braquages, etc. Des affiliations se créent ensuite selon les territoires d’origine. On peut ne s’être jamais parlé à l’extérieur, mais le fait de se trouver des connaissances communes, de fréquenter le même gymnase ou d’avoir été scolarisé dans la même école, même à des époques différentes, suffit à créer des solidarités.
D’où tu viens ? », « Tu as grandi où ? » sont parmi les premières questions que les détenus se posent mutuellement. La question de l’origine territoriale est déterminante, et constitue un critère d’identification et de classement très important entre eux.
De quels types de solidarités s’agit-il ?
Lucie Bony : Les premiers jours, quand les détenus sortent de garde à vue et sont envoyés directement en prison, ils se retrouvent sans vêtements, sans cigarettes. Des solidarités basées sur cette origine commune peuvent s’enclencher dès l’arrivée. L’autochtonie facilite aussi beaucoup l’insertion en détention. Les plus expérimentés prennent les nouveaux venus sous leur aile. Certains demandent même à ce qu’ils soient placés dans leur cellule, afin de pouvoir prendre en charge leur vie quotidienne et de leur offrir un soutien moral. Une forme de conseil juridique s’organise en interne. Ceux qui ont un certain bagage accompagnent les plus inexpérimentés : « Là, c’est le moment de demander un aménagement de peine », « Là il faut que tu t’inscrives à des activités pour avoir une remise de peine »… Ils leur expliquent aussi comment se comporter en détention. Il y a beaucoup d’autorégulation entre les détenus dans les maisons d’arrêt. Le pendant négatif de l’importation de ces rapports sociaux, c’est la reproduction de rapports de domination, d’une forme de caïdat, même s’ils en refusent le terme : « Je te prends dans ma cellule, je te protège, mais en échange tu fais le ménage et tu n’as pas ton mot à dire pour choisir le programme télé. » Le soutien se paie aussi parfois.

Comment se positionne l’administration pénitentiaire (AP) face à la reproduction de ces réseaux de sociabilité en détention ?
Lucie Bony : Dans les entretiens d’entrée, on pose systématiquement la question aux nouveaux arrivants : « D’où viens-tu ? Est-ce que tu connais quelqu’un en détention ? » Cela permet aux personnels de détecter d’éventuelles tensions. L’information est consignée, et au moment de l’affectation en cellule par le chef de bâtiment, les détenus peuvent faire part de leur désir d’être avec Untel ou Untel. Je ne pense pas qu’une consigne soit donnée au niveau national. Certains conflits opposant les villes du nord et du sud du département, à Nanterre, la politique était plutôt d’accompagner ce désir de regroupement par origine résidentielle, en les répartissant dans les différentes ailes. Les personnels de surveillance disent qu’ils ont tout intérêt à créer des groupes de détenus qui s’entendent bien : cela évite des tensions, des explosions, qui occasionneraient de nouveaux déménagements, des commissions disciplinaires, des placements au mitard, etc. Le revers de la médaille, c’est que les surveillants peuvent menacer un détenu qui poserait problème de le séparer de ses connaissances : comme tout privilège accordé en prison, il n’y a qu’à le retirer pour qu’il se transforme en punition. Regrouper les détenus par affinités est donc un instrument de maintien de l’ordre, une façon d’assurer la paix sociale en détention. D’autant que dans ces établissements surpeuplés, les personnels doivent pouvoir compter sur la façon dont les détenus s’autorégulent pour tenir la détention. L’encadrement étant en nombre assez limité, une forme de délégation de pouvoir s’organise de façon implicite : des détenus plus âgés du quartier sont là pour tempérer les plus jeunes.
Regrouper les détenus par affinités est donc un instrument de maintien de l’ordre, une façon d’assurer la paix sociale en détention. D’autant que dans ces établissements surpeuplés, les personnels doivent pouvoir compter sur la façon dont les détenus s’autorégulent pour tenir la détention.
Les détenus qui ont un certain « bagage carcéral » parlent souvent de choc des cultures avec les plus jeunes. Avez-vous pu l’observer ?
Lucie Bony : Il y a un vrai clivage entre les « jeunes » et ceux que j’appelle les « anciens », qui ont plus de 30 ans et ne viennent pas forcément du même type de territoire. Les plus jeunes, qui n’avaient encore jamais connu la prison, mobilisent la « culture de rue » pour décrypter les logiques de structuration des rapports sociaux entre les murs des maisons d’arrêt. Des têtes de toutes les cités sont réunies dans un même lieu, alors forcément, on « refait » le quartier : ils importent leur définition du respect, de l’honneur, l’importance de la flambe. « Si t’as rien, t’es rien » : le fait d’avoir des ressources économiques et de le montrer prend encore plus d’importance à l’intérieur. Pour les plus anciens, qui purgent parfois d’assez longues peines, le passage en maison d’arrêt est souvent vécu comme un moment particulièrement « pénible », au-delà des conditions difficiles de détention : c’est « plein de gamins », « bruyant », ça les « fatigue ». Eux s’identifient moins à leur quartier d’origine qu’à leur parcours en détention. Ils se réfèrent à la culture carcérale plutôt qu’à celle de la rue, à un code de l’honneur propre à la prison – « on est solidaires contre les surveillants », « on ne balance pas même son ennemi ». Ils rejettent souvent la culture de rue, dont ils pensent qu’elle déstabilise l’ordre classique, traditionnel en détention.
La prison est vécue comme un exil total par bien des détenus, totalement coupés de leurs proches et de leurs repères. C’est moins le cas pour ces jeunes ?
Lucie Bony : Je parle de continuum entre les prisons et les quartiers car il existe une vraie porosité entre ces deux mondes, en banlieue parisienne tout du moins ; parce qu’ils partagent la détention avec des connaissances du quartier, que la proximité de la prison de leur lieu de résidence habituel facilite la venue des proches au parloir… Même quand ils n’ont pas personnellement de parloir, leurs copains en ont et peuvent jouer les intermédiaires. Des informations entrent et sortent par parloirs interposés, mais aussi des vêtements : on donne le linge du codétenu à sa mère, pour qu’elle le remette à celle qui n’aura pas pu venir… La présence en détention de personnes des mêmes quartiers génère finalement une démultiplication des contacts avec l’extérieur. Sans compter les allers-retours en détention de personnes condamnées à de courtes peines. La porosité est aussi matérielle, au-delà du simple échange de linge, par projection d’objets par-dessus les murs d’enceinte par exemple. Elle est d’autant plus importante que le réseau relationnel des détenus est géographiquement proche de l’établissement.
A écouter les éducateurs de rue, l’expérience carcérale est souvent banalisée dans les discours des plus jeunes…
Lucie Bony : Ils ne vivent pas vraiment la prison comme une rupture dans leur parcours. Ils baignent dans un univers où elle est omniprésente, connaissent tous quelqu’un qui y est passé, que ce soit dans l’entourage ou dans la famille. Sur ces territoires, on fait l’expérience collective de l’incarcération. Dans certaines fratries, il y a même une sorte de passage de relais : le grand frère fait un séjour, puis c’est au tour du frère du milieu, etc. si bien que dans ces familles, il y a en permanence au moins un membre incarcéré. On retrouve cet effet de succession dans les groupes de pairs : il y a toujours au moins un ou deux membres de la « bande » en prison, avec parfois aussi des effets de génération. Dans les quartiers, il y a le sentiment d’une trajectoire commune, d’un destin collectif, écrit d’avance, un cercle vicieux dont on n’arrive pas forcément à sortir.
Dans les quartiers, il y a le sentiment d’une trajectoire commune, d’un destin collectif, écrit d’avance, un cercle vicieux dont on n’arrive pas forcément à sortir.
Le quartier et la prison sont les deux faces d’une même réalité ?
Lucie Bony : Certains le disent très bien : « la prison, c’est une cité avec des barreaux », « c’est un grand quartier ». Prison et quartier sont très liés dans les discours. Quand ils décrivent leurs journées, c’est « business, galère, on descend en bas, on joue au foot, y’a pas le [restaurant] grec comme au quartier mais bon… On remonte dans la chambre, on parle » : ils voient de telles similitudes entre leurs quotidiens dedans et dehors qu’ils assimilent la cellule à leur chambre, la liberté et le confort en moins. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu’on est dans le registre des discours, de la présentation de soi : dire que « dedans, c’est comme dehors » est aussi une façon de nier la réalité de l’incarcération et ses difficultés, de garder la face et passer pour un « dur ». Cela ne veut pas dire qu’ils ne pleurent pas en cellule et qu’ils ne sont pas déprimés quand ils pensent à leur avenir. Toujours est-il que ces discours montrent à quel point la circulation entre ces deux univers est intériorisée, banalisée. Finalement, lorsqu’ils sont détenus, les jeunes gens rencontrés décrivent davantage le quartier comme une forme de prison qu’ils ne décrivent la prison comme une prison. Ils parlent beaucoup de l’enfermement dans le quartier, qu’ils ne pourront pas en sortir. Les frontières, les barreaux, ne sont pas placés entre le quartier et la prison, mais à l’extérieur du complexe quartier-prison.
Lorsqu’ils sont détenus, les jeunes décrivent davantage le quartier comme une forme de prison qu’ils ne décrivent la prison comme une prison.
Vous parliez d’avenir. Comment se l’imaginent-ils ?
Lucie Bony : Il y a un conformisme assez surprenant. Quand on leur demande ce qu’ils aimeraient pour leur futur, la réponse est pour beaucoup : « un pavillon, une femme, des enfants, un travail », parfois même un chien. La prison reste une épreuve et un moment de prise de conscience, de réflexion sur soi, sur son avenir. Une idée revient beaucoup : « Si je veux arrêter de retourner en prison, il faut que je parte du quartier. » Quand ils relisent leur trajectoire, le quartier est presque considéré comme un acteur à part entière, à l’origine de toutes leurs difficultés. Le « quartier », c’est très large : ça englobe « l’école, qui ne nous a pas donné notre chance », « les grands qui donnent le mauvais exemple », « la police qui nous suspecte », « l’environnement pourri », « le ghetto »… Le quartier englobe toutes ces difficultés. C’est finalement une représentation assez classique du « quartier criminogène ». Le rêve du pavillon s’inscrit dans ce désir de quitter le quartier, puisqu’il amène à la campagne ou dans le péri-urbain. C’est une envie d’ailleurs, pour devenir autre et recommencer sa vie. Ces discours, quasiment tous les tiennent. Une fois dehors, ils trouvent rapidement leur limite. Car les démarches de recherche d’emploi et de logement prennent du temps, d’autant plus avec un casier. Si l’on n’est pas soutenu par ses proches, le temps de trouver du travail, on est « en galère », sans argent, donc on reprend ses habitudes, on se remet à fréquenter les mêmes personnes, etc.
Quitter le quartier n’est donc pas forcément la solution ?
Lucie Bony : L’idée n’est pas idiote : la détention, on l’a vu, ne les dépayse pas, ne les coupe pas de la vie qui les a conduits derrière les barreaux. Mais disperser, écarter, éloigner ne suffit pas. Cela peut même être contre-productif. Pour pérenniser cette prise de conscience, cet élan, il faut avoir de la ressource, sous toutes ses formes : économiques et relationnelles, mais aussi psychologiques, pour être en mesure de se projeter autrement. Pour cela, il faut un accompagnement, des soutiens. Le quartier peut représenter une ressource. Les groupes de pairs ne font pas nécessairement que proposer de faire du trafic. Ils peuvent aussi aider à trouver du travail, prodiguer de bons conseils. Il se passe aussi plein de choses positives
dans les quartiers.
* Lucie Bony est chercheuse au CNRS. Elle est l’auteure d’une thèse intitulée « De la prison, peut-on voir la ville ? Continuum carcéral et socialisation résidentielle ».