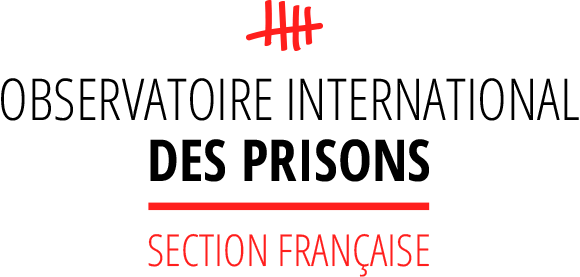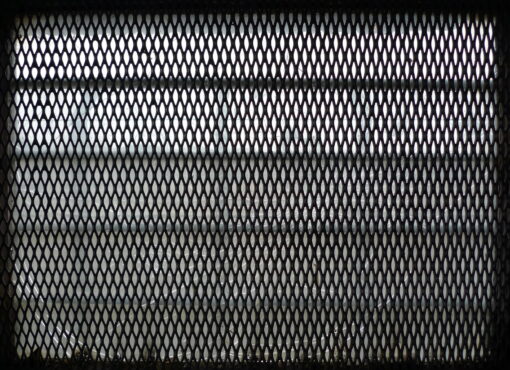Journaliste indépendante, dessinatrice de bande dessinée et juriste de formation, Ana Pich s’intéresse à la dimension politique des décisions de justice. Elle documente les discriminations et les violences sociales qu’elles reproduisent. Son album Chroniques de l’injustice ordinaire (éditions Massot) est un regard sans concession sur la procédure de comparution immédiate.
Vous avez commencé à observer les comparutions immédiates (CI) en 2019. Qu’est-ce qui vous a amenée là ?
Ana Pich : J’ai commencé à étudier le droit après une confrontation un peu brutale à l’institution judiciaire, en tant que victime. Le traitement policier et judiciaire a été très violent. J’ai commencé à réaliser à quel point l’institution judiciaire portait une dimension politique.
Je constatais, d’une part, l’impunité de certaines personnes, « insérées socialement » et, de l’autre, la répression aveugle envers les plus précaires, isolées et marginalisées. Pour être honnête, j’avais beaucoup de colère et d’incompréhension face à un tel système à deux vitesses, et cela m’a amenée à m’inscrire à la faculté de droit, avec ce besoin, presque viscéral, de comprendre les mécanismes par lesquels l’institution judiciaire reproduisait autant de violence sociale et d’inégalités.
Arrivée en master de criminologie, j’ai choisi d’étudier les biais et discriminations influençant ce traitement judiciaire dans le cadre de mon mémoire. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à documenter les audiences quotidiennement. Mes grilles d’observation se sont peu à peu transformées d’elles-mêmes en bande dessinée. Ce que j’observais, jour après jour, n’a fait que m’indigner plus encore !
Vous avez observé des audiences de CI dans différents tribunaux ?
J’ai documenté pendant plus de trois ans, plusieurs fois par semaine, les audiences de CI à Nantes principalement. J’ai aussi réalisé beaucoup d’observations à Paris, Bobigny et Strasbourg. Quand je suis de passage dans d’autres villes, j’en profite également pour aller au moins quelques heures en chambre des CI afin d’y observer les différences en termes de conduite d’audience, d’organisation, d’agencement de la salle, d’état des locaux, de difficultés d’accès parfois, ou de remarques des policiers qui font de l’excès de zèle en vous refusant l’accès aux audiences ! J’ai donc pu, à l’occasion de déplacements, observer les audiences de CI à Angoulême, Marseille, Grenoble, Niort, Rennes, Saint Nazaire…
Pouvez-vous nous raconter une audience qui vous a particulièrement marquée ?
Je pourrais difficilement en choisir une. Dans ces audiences, j’ai entendu tant d’histoires, de vies cassées par la prison, par la violence de la police, par les institutions judiciaires, psychiatriques, l’aide sociale à l’enfance… Aucune n’a moins d’importance qu’une autre.
Mais si une chose revient sans cesse en audience de CI, ce sont les défaillances de l’État et des services publics qui sautent aux yeux. On y juge, dans un continuum de mépris et de violences sociales, ceux et parfois celles à qui l’État refuse d’assurer une vie digne : l’accès à des soins médicaux, à des prises en charge psychiatriques, au logement évidemment, au travail, aux droits sociaux…
C’est finalement le sens de votre démarche, de donner à voir des défaillances évidentes mais largement à l’abri des regards ?
Oui, les audiences sont en grande majorité publiques, même si on l’ignore souvent. Sauf pour les enfants, le principe est celui de la publicité des débats, même si les juges ont toujours la possibilité, sur décision motivée, d’exiger un huis clos. Je pense par exemple aux audiences du juge des libertés et de la détention (JLD) pour les personnes étrangères enfermées en centre de rétention ou pour les personnes enfermées en hôpital psychiatrique, mais aussi aux audiences du tribunal administratif, du conseil des prud’hommes ou encore de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Et ce qui se joue à l’intérieur de ces salles d’audience a une importance considérable, cela reflète le fonctionnement de nos institutions, la mise en œuvre des politiques de l’État, le traitement des personnes et le respect ou non de leur dignité… Les audiences qui m’intéressent le plus sont les moins médiatisées, celles que la presse oublie souvent. Retranscrire les discours de celles et ceux que l’on n’entend jamais, dont les voix sont toujours étouffées, est aussi un moyen d’inscrire leur parole, de leur redonner le droit à l’expression. Retranscrire l’ensemble de l’audience en bande dessinée permet ainsi de documenter les dysfonctionnements institutionnels, le mépris de classe, les discriminations qui y sont parfois flagrantes… C’est un outil à la fois sociologique, journalistique mais également politique à mon sens.
C’est aussi un moyen de parler de manière plus accessible des questions juridiques, du fonctionnement des institutions, du recours de plus en plus récurrent à des audiences en visio-conférence qui posent de réels problèmes en termes de procès équitable et de droits de la défense. Il me semble important que l’on se saisisse de nos droits et qu’on ne les laisse pas aux seules mains des dominant·es. Plus on connaît nos droits, et plus on peut faire front, collectivement, face aux pratiques illégales du patronat, de la police, des juges, ou de toute autorité plus généralement, afin d’exiger l’égalité et le respect de nos droits. Le droit peut être un outil politique, on le voit dans les luttes écologiques notamment, mais aussi dans des procédures engagées contre la police ou l’État. Il s’agit d’exiger la fin de l’impunité de certaines personnes et le respect des droits de toutes et tous.
Avez-vous mis en place une méthodologie pour restituer ce que vous observez ?
Il faut le reconnaitre, j’arrive nécessairement avec un parti-pris, une subjectivité : mon histoire, mes convictions politiques… Tout cela influence mes observations, mes retranscriptions, ma manière de dessiner ou encore le choix des audiences que j’observe. Je tente donc au mieux de retranscrire de manière contradictoire les éléments de l’audience, et de manière littérale les phrases prononcées. Mais la sélection des propos retranscrits restera toujours subjective : comme je n’ai pas le droit d’enregistrer, je suis contrainte à une prise de notes manuelle qui ne me permet pas d’écrire absolument tout ce qui est dit.
C’est important d’avoir un regard sur ses propres biais. C’est une des critiques principales que je fais aux magistrat·es : le refus, pour certaines personnes, de reconnaître leurs propres biais, et notamment les représentations sociales racistes et sexistes avec lesquelles nous avons grandi, peu importe notre classe sociale. Il est difficile de reconnaître à quel point elles sont ancrées en nous, malgré nos formations, nos lectures, nos engagements… Je pense qu’il faut être vigilant·es quotidiennement à ses propres pratiques et ses facteurs d’influence.
Vous vous exprimez par le dessin, en illustrant des scènes que vous avez observées. Qu’est-ce que le dessin peut dire de particulier ?
Seul le dessin peut retranscrire visuellement ces audiences dont l’enregistrement audio ou vidéo est interdit. La bande-dessinée a aussi l’intérêt d’attirer le regard, d’être plus compréhensible, accessible. Le dessin permet également de respecter l’anonymat des personnes, qu’elles soient prévenues, victimes, professionnelles de justice.
C’est aussi parfois moins déstabilisant d’être dessiné·e que photographié·e. J’essaye quand même de faire attention à ma manière de dessiner : faire des croquis très rapides sans que ce soit forcément très ressemblant permet d’éviter de fixer les gens pour ne pas avoir un regard trop insistant et les mettre mal à l’aise. Il ne s’agit pas de dessiner comme au parc ou au bar ; là, ce sont des lieux très lourds pour les personnes qui s’y trouvent. Je tiens donc à ne pas trop fixer les gens, à maintenir une attitude neutre, ne pas rire… afin d’éviter une posture voyeuriste, jugeante ou déstabilisante.
Vous n’observez pas que les CI, mais également d’autres audiences publiques. Qu’est-ce qui fait, selon vous, leur spécificité ?
Les CI font malheureusement partie de ces audiences qui intéressent peu la presse car il s’agit d’affaires quotidiennes qui peuvent paraître banales pour beaucoup de personnes : des vols à la sauvette, des dégradations, des bagarres, des outrages et rébellions, des refus d’obtempérer, parfois des violences conjugales… Et il y règne très souvent un mépris de classe terrifiant. Le choix du parquet de déférer en CI concerne d’ailleurs les personnes les plus précaires et isolées, sous prétexte qu’elles ne disposeraient pas de garanties de représentation.
Mais il y a aussi une dimension punitive à ce choix de procédure. Car les juges ont forcément conscience des conditions indignes que supportent les gardé·es à vue, les pratiques policières violentes, les atteintes aux droits de la défense… Juger une personne brisée par la garde à vue, qui n’a pas pu dormir, se nourrir, se laver, qui peut être en rupture de soins ou en sevrage de drogues, d’alcool ou de cigarettes depuis plus de 48 heures, qui n’a pas pu préparer sa défense, en état de désarroi total, qui n’aura ni la posture, ni le discours adapté* : c’est un choix du parquet. Et cela influencera nettement l’écoute, la crédibilité accordée à la personne qui comparaît et le traitement judiciaire qu’elle subira. Le risque d’enfermement avec mandat de dépôt est estimé autour de 70 % en CI !
Les CI reflètent une justice de classe à deux vitesses : elles sont expéditives, violentes, attentatoires à la dignité humaine… Alors que l’on connait, à l’inverse, des affaires judiciaires qui traînent pendant des années ou qui sont classées faute de moyens d’enquête ou de volonté ; des affaires où on permet aux personnes prévenues de comparaître libres, en ayant préparé leur défense, en soignant leur discours et leur tenue. L’appréhension des juges en sera tout autre.
Et au-delà des biais discriminatoires liés à la personnalité des personnes prévenues, d’autres facteurs entrent en jeu : l’absence d’actes d’enquête après deux ou trois jours ; l’avocat·e qui prend connaissance du dossier bien souvent quelques minutes seulement avant l’audience ; des audiences surchargées qui finissent parfois tard dans la nuit, où les juges exténué·es punissent d’autant plus rapidement et durement… Le principe même des CI est une atteinte à tous les principes fondamentaux du procès équitable.
Selon l’étude de Retieres et Gautron publiée en 2013, les personnes étrangères sont trois fois plus susceptibles d’être jugées en CI. Qu’est-ce que vos observations disent de cette statistique ?
Elles confirment effectivement cette statistique. Les personnes étrangères, ou perçues comme telles, sont tout d’abord les plus ciblées par les contrôles policiers dans l’espace public ; elles risquent donc plus d’être interpellées. Et les biais racistes ne s’arrêtent pas à la police : le choix de juger en CI relève du parquet, où les procureur·es sont soumis·es aux orientations pénales du ministère de la Justice. Et on connaît malheureusement les politiques françaises en matière d’accueil et de respect de la dignité des personnes étrangères… Il arrive ainsi souvent qu’à l’audience le parquet évoque le risque de non-représentation pour les personnes qui ont une autre nationalité, pour justifier ses demandes de mandat de dépôt ou de placement en détention provisoire.
Selon vous, peut-on réformer les CI ?
Je pense qu’on ne pourra jamais juger dignement des gens sous cette forme-là. La CI est un symbole brutal de cette justice de classe. Mais le problème est plus large que la seule procédure de comparution immédiate. Des questionnements doivent se poser à tous les niveaux : quant aux contrôles de police ; aux prérogatives du parquet et sa dépendance vis-à-vis de l’exécutif ; aux conditions inhumaines de garde à vue qui biaisent bien souvent la suite de la procédure ; à la crédibilité des enquêtes menées à charge par la police et leur contrôle par des juges indépendant·es ; aux choix des poursuites et leur opportunité ; au fonctionnement à mon sens problématique du service de traitement en temps réel géré par une permanence téléphonique de substituts des procureur·es qui prennent des décisions fondamentales en quelques secondes sur la base d’un appel vocal d’un officier de police judiciaire (OPJ) ; aux biais des juges et à leurs conditions d’exercice qui ne permettent pas un travail impartial et satisfaisant ; au recours constant à l’enfermement comme peine de référence ; aux inégalités criantes ; aux problématiques d’accès aux droits ; à la possibilité de recours ; aux instances de contrôle indépendantes… Et la liste est encore longue !
Nous devons nous questionner plus largement sur la notion de justice, sur le sens de la peine qui est aujourd’hui une punition et non un processus de réflexion et de réinsertion. Une des réflexions essentielles doit se porter sur la prison : le constat de son inutilité est évident, le coût pour la société est immense, humainement, socialement comme financièrement. C’est un non-sens en termes de justice.
Plus généralement, c’est un ensemble d’institutions qui dysfonctionnent : la police, la justice, la prison… Avec la destruction parallèle des services publics, des politiques sociales… On ne peut pas penser la justice sans réfléchir à nos choix de société. Notre système néolibéral et capitaliste est d’ailleurs injuste en soi, et on peut difficilement envisager une justice égalitaire dans un système qui ne l’est pas.
Propos recueillis par Prune Missoffe
Cet article est paru dans la revue de l’Observatoire international des prisons – DEDANS DEHORS n°127 – Une société qui s’enferme : la répression comme seul horizon
*Voir à ce sujet : Ana Pich, Garde à vue : Petit guide pratique pour celles et ceux qui luttent pour leurs droits, Massot Editions, janvier 2025