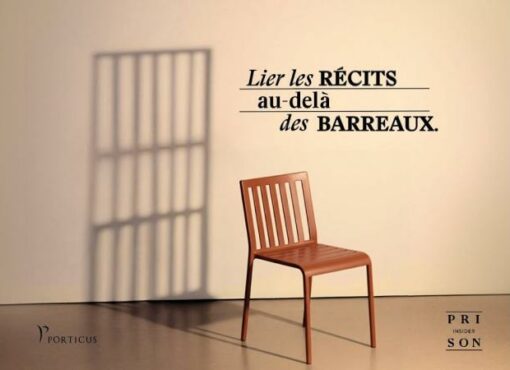En cinq ans de mariage avec Jérôme, détenu pour une longue peine, Christelle a connu huit prisons et autant de types de parloirs. Elle a pu expérimenter les "unités de vie familiale". Une bulle, avec son contrecoup.
« Je me souviens très bien de notre première unité de vie familiale (UVF). C’était il y a quatre ans. On est restés collés l’un à l’autre les six heures! On n’avait pas l’habitude d’avoir autant d’espace : au parloir, on se voit dans un local réduit, fermé. Me déplacer avec lui, pouvoir marcher à côté de lui, c’était nouveau. La première UVF, c’est comme aller à sa première boum, en fait !
L’autre grande différence avec les parloirs, c’est le temps, beaucoup plus long. Sur 48 ou 72 heures, on peut en profiter, se poser. C’est comme passer un week-end chez soi avec son mec : vous n’avez pas accès à l’extérieur, mais vous êtes dans votre cocon. On partage vraiment un quotidien. Quand on retourne aux parloirs ordinaires, on ne peut qu’être frustré. Des fois, j’enchaîne plusieurs parloirs sur un week-end : un premier le samedi après-midi, puis nuit à l’hôtel, un deuxième le dimanche matin, pause-déjeuner à l’extérieur, et j’y retourne à 14h. Ça n’a quand même rien à voir avec les UVF. Je ne suis pas avec lui tout le temps, c’est entrecoupé. Ce n’est pas seulement le fait de ne pas pouvoir dormir avec lui : je ne partage pas non plus ses repas, son quotidien… Le samedi soir, entre deux jours de parloirs, est vraiment déprimant. Jérôme est dans la taule et moi à 200 mètres, dans un hôtel miteux. C’est perdu en pleine campagne, je n’ai rien à faire là-bas, je ne connais personne. De toute façon, à ce moment-là je n’ai envie de rien. Le lendemain matin, je me lève à 7 h pour avoir le temps de me préparer, et je file au parloir.
Je n’arrive pas à prendre des UVF de plus de 48 heures pour l’instant, sauf pendant mes vacances. Mon mari insiste pour que je me mette en arrêt pour des UVF plus longues. Pour lui, ça parait simple : j’ai « juste » à expliquer à mon patron que mon mari est en prison. Mais c’est compliqué pour moi… Ça suppose de prendre une demi-journée de congé, d’avoir préparé la veille les affaires que j’apporte, et donc d’avoir en amont fait les courses, etc. Toute la semaine, je cours. Il ne se rend pas compte, mais c’est seulement lorsque j’arrive à l’UVF que je peux me poser. Quand je ressors à 18 h le dimanche soir, j’ai encore trois heures de route pour rentrer à Paris. J’arrive à 21-22 h. Et le lendemain, je me lève à 6 h 30 pour aller travailler. Ma vie tourne autour de ça en fait. Mais le jeu en vaut la chandelle : quand c’est pour une UVF, je sais pourquoi je cours.
Il y a aussi le contrecoup. C’est comme si vous goûtiez à un semblant de quotidien et puis, stop ! On vous le retire. À la fois, ça ressource, ça fait du bien, et d’un autre côté, vous vous prenez une grosse claque. Ça m’arrive encore de pleurer en sortant. Quand je rentre chez moi, je coupe tout, je ne réponds pas au téléphone, je reste dans ma bulle. Je prends quelqu’un en covoiturage sur le voyage aller, pour les frais d’autoroute. Mais au retour, je ne prends personne. Je ne peux pas, je suis encore avec lui, collée à lui, même si je suis sortie. Au niveau émotionnel, c’est les montagnes russes. Lui est moins expressif. Mais je sais qu’il ne veut voir personne non plus après. C’est pas pour autant que je ne veux plus d’UVF : au contraire, j’en veux plus ! »
Recueilli par François Bès et Laure Anelli