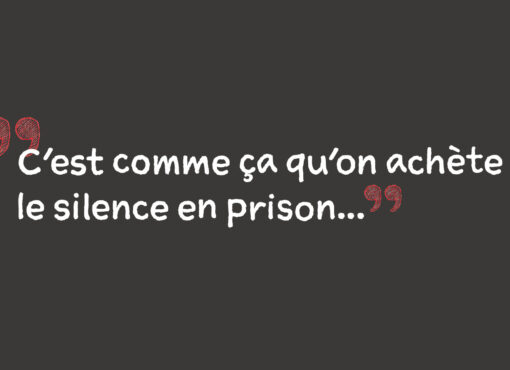Après un décès, les mesures mises en place pour informer les détenus et les accompagner psychologiquement sont dérisoires. Un déficit de prise en charge symptomatique du peu de considération que l’institution porte à ceux dont elle a « la garde ».
Quand quelqu’un meurt en prison, l’administration gère ces drames à sa manière : avec le moins de bruit possible pour éviter les vagues. « Le décès est quelque chose à masquer au plus vite. Le codétenu est sorti très rapidement de la cellule, celle-ci est bouclée pour l’enquête. Il est transféré sans ses effets personnels. D’autres détenus ont souvent entendu du bruit, celui de l’intervention des surveillants puis des pompiers. Et c’est tout. On ne leur dit rien le lendemain, ou presque rien », raconte un soignant. Une impression de chape de plomb partagée par de nombreuses personnes incarcérées ou travaillant en prison. En théorie, des mesures de « postvention » consistant en une communication adaptée et un soutien psychologique devraient être mises en place. Un dispositif qui vise à limiter à la fois la souffrance après un suicide et la circulation de rumeurs. Sauf que dans les faits, qu’elles arrivent par « vagues » ou de manière isolée, les morts, et a fortiori les morts subites, sont suivies d’une information et d’une prise en charge quasi inexistantes.
Une communication à deux vitesses
Du côté des personnels de l’Administration pénitentiaire (AP), une réunion « à chaud » est organisée rapidement, en général le jour même du décès. Cette discussion doit permettre au chef d’établissement de recueillir les premières informations(1) sur les circonstances de la mort, mais aussi d’atténuer le sentiment de culpabilité des agents. « C’est aussi là que l’on peut se mettre d’accord sur une seule version des faits, sur ce que l’on dira aux détenus s’ils nous posent des questions », explique un surveillant.
En ce qui concerne les intervenants et les soignants, malgré le cadre posé par le mémento sur la postvention(2) qui précise qu’« une attention particulière sera portée au fait qu’une information exhaustive devra [leur] être transmise […] dans les plus brefs délais »(3), nombreux sont ceux qui témoignent d’une circulation de l’information trop lente ou trop informelle à leur égard. « Au SMPR, tout ce qu’on apprend sur les décès et les suicides des détenus, c’est généralement de manière accidentelle », rapporte un psychologue d’une grande maison d’arrêt. « Un jour, une collègue a appris qu’un patient avec lequel elle avait rendez- vous ne viendrait pas car il était mort depuis une semaine… Elle a été très choquée. C’est comme si cette vie n’avait pas de valeur. »
Prévenir l’ensemble de la détention devrait être la chose la plus importante. Un discours officiel, c’est au moins une reconnaissance de la personne.
Quant aux prisonniers… S’ils veulent connaître la cause d’un décès ou l’identité du défunt, ils doivent, dans l’immense majorité des cas, se contenter du bouche-à-oreille. « Le jour même, tout le monde en parle, tout le monde essaye de savoir ce qu’il s’est passé. Comme c’est un milieu clos, on est très vite au courant, témoigne un ancien détenu. Dans toutes les prisons que j’ai connues, il n’y a jamais eu d’information officielle de la part de la pénitentiaire. » « La plupart du temps, les décès sont cachés. Sauf quand un détenu a vu le mort. Là, ils sont bien obligés d’en parler », rapporte un autre.
« Après la survenance d’un décès ou d’un suicide, pour mettre fin au développement d’accusations à l’encontre des surveillants qui pourraient germer parmi les codétenus, il appartient au directeur ou au chef d’établissement de réunir les codétenus […] pour leur fournir des informations », peut-on pourtant lire dans une circulaire du 26 avril 2002. En 2017, une note interne de l’AP semble en revanche préconiser une circulation de l’information plus informelle, par le biais des surveillants : « L’information pourra aisément être diffusée aux codétenus les plus proches du suicidé (tels les anciens cocellulaires) lors de moments tels que la distribution des repas, le départ ou la remontée de promenade ou d’activités. » Aucun de ces textes n’étant contraignant, les contours du message à délivrer aux personnes incarcérées est donc à la discrétion des chefs d’établissements et des chefs de détention, sur la forme comme sur le fond. « En cas de décès, on n’a aucune consigne réelle », explique un directeur. « De mon côté, j’informe toujours les détenus de ce qu’il s’est passé, en priorité ceux qui côtoyaient le défunt. Le chef de bâtiment reçoit le ou les cocellulaires, leur propose de voir un psy. On fait aussi une réunion informelle dans la coursive pour dire qu’une personne est décédée. » Une pratique qui semble loin d’être la norme. « Habituellement, l’AP choisit de ne pas donner d’infos au prétexte que “ça ne concerne pas les autres détenus” », soupire une intervenante.
Lorsqu’elle est questionnée sur son manque de transparence, la pénitentiaire se cache parfois derrière le mythe de l’effet Werther. D’après cette théorie élaborée en 1974 par un sociologue américain(4), la médiatisation d’un suicide augmenterait le risque de passage à l’acte dans la communauté informée. « Prévenir l’ensemble de la détention devrait pourtant être la chose la plus importante », réagit une intervenante spécialisée sur la prévention du suicide. Pour une psychologue intervenant en prison, « même s’il nomme les choses de manière inadéquate, un discours officiel, c’est au moins une reconnaissance de la personne et un support de conversation que l’on peut critiquer ». C’est peut-être précisément le but poursuivi par la pénitentiaire : étouffer toute possibilité de critique.
Les conséquences de l’opacité : angoisse et indignation
Une communication sobre et uniforme pourrait pourtant au contraire permettre de limiter le risque d’identification – qui lui est bien réel – et donc de contagion. D’autant que, de l’avis de plusieurs soignants, l’omerta qui entoure les morts soudaines peut alourdir les conséquences psychologiques liées au décès : cauchemars, dépressions, violences contre soi ou contre les autres, etc.
« Une mort en prison, c’est un triste rappel à la réalité, ça te rappelle que ça peut t’arriver à toi. Même celui qui fait le plus le malin ou qui rigole le plus, ça lui fait quelque chose », se rappelle un ancien détenu. « Tous vont penser au suicide à un moment ou un autre, estime un psychologue. Quand ils vont un peu mieux parce qu’ils ont réussi à s’adapter un tant soit peu à l’incarcération et que quelqu’un se suicide, c’est très dur. Parce que ça leur rappelle leur condition de prisonnier. » « Ils ont le sentiment que la vie humaine ne vaut rien ici, qu’on s’en fiche d’eux, de leur santé, appuie une autre intervenante. Il y a aussi un sentiment d’insécurité très fort. Un jeune m’a dit un jour : “Madame, ici la mort est partout, tout le temps. Quelqu’un est mort dans la cellule au-dessus de ma tête, un autre dans la cellule d’à côté. Ces gens allaient bien en arrivant. Si j’ai une appendicite, si j’ai besoin d’une opération, si quelque chose m’arrive la nuit, je risque de mourir.” Et c’est vrai. Alors à l’annonce d’une mort, il va aussi y avoir de la révolte, de l’indignation, du dégoût. »
Les seuls qui savent ce que c’est que d’être enfermé, d’entendre quelqu’un crier, appeler les secours et mourir entre quatre murs, ce sont les détenus.
Sans aller jusqu’à la révolte, il n’est pas rare que des détenus se mobilisent pour obtenir des informations ou exprimer leur douleur. Ils sont alors passibles de sanctions disciplinaires. Plusieurs détenus de la maison d’arrêt de Seysses ont ainsi été transférés suite à un mouvement collectif et à la publication de communiqués de presse demandant la transparence sur la mort de Jaouad, survenue dans la nuit du 14 au 15 avril 2018 et présentée très rapidement comme un suicide par l’administration.
Une prise en charge quasi inexistante
La prise en charge psychologique est l’autre angle mort de la postvention. En théorie, les surveillants doivent se voir proposer un entretien à chaud, puis un suivi, bien que l’application de tels dispositifs ne semble pas systématique : en septembre 2018, le syndicat Force ouvrière demandait ainsi la mise en place d’une cellule psychologique à destination des surveillants de Fleury-Mérogis après une série de suicides dans l’établissement(5). Autre dispositif de postvention prévu dans le cas de suicides : le « Retex », une réunion des personnels co-animée par le chef d’établissement et le référent prévention-suicide de la direction interrégionale de l’administration pénitentiaire. Un mois après le décès, la discussion doit permettre des échanges entre un psychologue et les agents, mais aussi d’autres personnes ayant connu le défunt : soignants, aumôniers, enseignants, etc. Dans un rapport d’audit publié en 2015, un groupe d’inspection note : « Les modalités de mise en place de ces recommandations et la finalité des échanges varient fortement d’un établissement à l’autre. L’absence de formation du chef d’établissement à la conduite d’une séance de débriefing et la crainte de faire apparaître un positionnement visant exclusivement à établir des recherches de responsabilité rendent délicates la tenue de telles réunions. »(6) Un temps d’échange auquel les personnes détenues ne sont quoi qu’il en soit pas conviées. « Après une communication collective et sobre, il faudrait donner aux gens la possibilité de s’exprimer. Mais ça ouvrirait la boîte de Pandore. Et ça serait révolutionnaire pour l’AP, parce que ça reviendrait à considérer les détenus comme des êtres humains égaux aux autres – donc égaux aux surveillants », souligne un psychologue.
Dans l’immense majorité des cas, donc, rien n’est proposé aux prisonniers, qui sont pourtant directement exposés à la mort et aux tentatives de suicide. « À l’extérieur, pas sûr que les gens aient conscience de ce que c’est, être confronté à la mort en prison. Tous ceux qui travaillent dedans pensent le savoir. Mais justement, ils y travaillent : donc ils ont la possibilité de sortir, de prendre un arrêt-maladie si ça ne va pas. Les seuls qui savent ce que c’est que d’être enfermé, d’entendre quelqu’un crier, appeler les secours et mourir entre quatre murs, ce sont les détenus », explique une intervenante.
Dans les faits, une prise en charge psychologique sur la durée est souvent impossible – surtout dans les grandes maisons d’arrêt où l’offre de soins est globalement très insuffisante. Or, les symptômes du stress post-traumatique apparaissent souvent plusieurs jours, voire plusieurs mois après le choc. À défaut de mieux, les unités sanitaires et les services psychiatriques de certaines prisons, comme à Villenauxe-la-Grande ou à Poitiers-Vivonne, choisissent d’assouplir les horaires des consultations les jours qui suivent un décès. Objectif : se rendre disponible dès qu’un détenu décompense ou manifeste le besoin de consulter.
En cas de « suicides répétés en moins de six semaines » dans une même prison, la note relative à la postvention(7) suggère la mise en place de groupes de paroles. Une mesure dont on peut douter de la portée : quinze détenus maximum peuvent être invités à cet échange d’une heure – encadré par des personnels pénitentiaires. Surtout, cette recommandation ne semble pas toujours appliquée. Ainsi, le rapport d’audit de 2015 rapportait que dans un établissement, leur mise en place « n’a[vait] pu avoir lieu, le chef d’établissement craignant que leur organisation ne soit perçue comme une provocation pour les personnels pénitentiaires »(8). Idem pour Fleury-Mérogis où, malgré une accumulation sans précédent de suicides durant la première moitié de l’année 2018, aucun groupe de parole n’a été mis en place pour les détenus.
Dans les consignes officielles(9), le cocellulaire semble faire figure d’exception : après le décès de la personne partageant sa cellule, il doit être reçu une ou plusieurs fois en entretien par un gradé, et ce dernier doit l’inciter à prendre rendezvous avec un psychologue. En pratique, cet entretien, réalisé dans un contexte peu propice à l’expression des émotions, aurait essentiellement une visée informative. « Le gradé prend surtout des renseignements pour son enquête », se rappelle un ex-détenu reçu après la mort d’un de ses amis. « Dans le cadre d’une activité de groupe, j’ai un jour fait la connaissance d’un jeune dont le codétenu était mort. Il avait appelé toute la nuit pour qu’il y ait une intervention, sans succès. Il était alors constamment sollicité par les gradés, mais j’avais l’impression que c’était plus pour cadrer ce qu’il allait dire que pour le débriefer », se désole un soignant.
« Ne pas avoir la possibilité d’avoir des rituels, c’est déshumanisant »
« Finalement, la postvention en prison ne devrait pas être si différente de la gestion de la mort dans une entreprise ou une école », remarque une spécialiste de la prévention du suicide. « Pour ramener de l’humanité et de la dignité, on peut par exemple proposer des rituels collectifs : une collecte pour payer une couronne de fleurs, un livre d’or pour la famille, etc. Mais on a du mal à accepter que la prison soit une communauté comme une autre. » Des rites qui restent dépendants du bon vouloir de l’administration pénitentiaire. Et restreints par les contraintes matérielles : difficulté à communiquer entre détenus, mais aussi et surtout vers l’extérieur. Des initiatives spontanées parviennent pourtant à se concrétiser. « Lorsque j’étais à Loos, un mec que tout le monde appréciait beaucoup est mort. On a décidé de faire une cagnotte pour la famille », se rappelle un ancien détenu. « On a averti le chef de détention pour qu’il transmette à la famille, on a fait tourner une feuille pour recueillir les noms des participants, on a envoyé la feuille à la compta pour qu’ils déduisent les sommes du pécule, et voilà, c’est tout. » Des initiatives qui, si elles ne sont pas indispensables au processus de deuil, permettent de redonner humanité et dignité à la personne décédée. Et à la collectivité.
par Sarah Bosquet
(1) Cf. la circulaire du 26 avril 2002 : « En cas de survenance d’un décès par suicide, il importe que le directeur ou le chef de l’établissement pénitentiaire […] se rende immédiatement sur les lieux du suicide et recueille toutes les informations utiles sur le défunt, les circonstances du décès, les mesures prises, les coordonnées de ses proches, vérifie que les autorités judiciaires ont été avisées, et veille à faire préserver les lieux où le suicide s’est déroulé. »
(2) Mémento « Que faire après un suicide ? », note de la Direction de l’administration pénitentiaire à destination des cadres de l’AP, juin 2017.
(3) Idem.
(4) David P. Phillips, « The influence of suggestion on suicide: Substantive and theoretical implications of the Werther effect », American Sociological Review, vol. 39, juin 1974.
(5) Dans un tract intitulé « Primoaccueil, tentative de suicide » publié le 3 septembre 2018.
(6) Audit interne de la politique de prévention et de lutte contre le suicide en milieu carcéral, rapport réalisé par les inspections générale des services judiciaire (IGSJ), de la protection judiciaire de la jeunesse (IPJJ), des services pénitentiaires (ISP) et des affaires sociales (IGAS), 2015.
(7) Mémento « Que faire après un suicide ? », op.cit.
(8) Audit interne de la politique de prévention et de lutte contre le suicide en milieu carcéral, op.cit. (9) Mémento « Que faire après un suicide ? », op.cit.